La revue de web de Kat
Par Dorian Vidal le 22 février 2024

La mention "Atelier de sculpture" figure encore à l’entrée. Mais sur les hauteurs du Coudon, à plus de 630mètres d’altitude, le fort du Bau Pointu est aujourd’hui à l’abandon. Le portail est entrouvert, des éclats de verre et des vitres brisées jonchent le sol quand, à l’intérieur, seuls du tabac et des bouteilles d’eau rappellent, qu’il n’y a pas si longtemps, un locataire occupait les lieux avec son fidèle chien.
Là, sur l’arrête ouest du mont, au bout d’un sentier qui relie l’ouvrage à la sinueuse route départementale 446, le sculpteur varois Louis Melcky accueillait les promeneurs et curieux. Il va sans dire que le paysage entourant la bâtisse lui donnait de l’inspiration pour, ensuite, exprimer son talent.
Implanté au cœur de la nature, dans la commune de La Valette, le site offre une vue imprenable sur le littoral et une partie de la ville de Toulon. Et, à chaque coucher de soleil, un spectacle formidable. Tout cela représente "un luxe", confiait d’ailleurs le sculpteur à Var-Matin, il y a plus d’une décennie.
Un appui pour le fort Girardon
Mais cet ancien fort militaire est aussi empreint d’histoire. En 1873, le colonel Le Masson, directeur des fortifications, publie un rapport afin de renforcer la défense de Toulon. Il y préconise d’occuper les points hauts principaux entourant la rade. Comme relaté dans une étude historique mise à disposition par la Région Sud, le ministre de la Guerre valide, cinq ans plus tard, le projet définitif de fortification du Coudon.
Celui-ci comprend la construction du fameux fortin en guise de batterie d’appui, achevée en 1884, et succédant à celle du fort Est (aujourd’hui davantage connu). Le coût du chantier, mené à bien en deux ans par l’entreprise Andreoli, est alors de 93.000 francs.
Dans un premier temps, cet ouvrage aux allures d’avant-poste est appelé "fortin de la Bergerie". Quatre canons, deux mortiers et un magasin de munitions composent son artillerie. En temps de paix, 18 hommes peuvent y caserner. Et en temps de guerre, 40.
La guerre, ce modeste fort la connaîtra. À quelques centaines de mètres de là, pendant la Seconde Guerre mondiale, le fort Est est occupé par la marine de guerre allemande: la Kriegsmarine. Le Bau Pointu, lui, est surveillé par un gardien, nous apprend l’étude. Mais en août 1944, il s’avère décisif dans la prise par surprise du fort Girardon, en servant de poste de commandement au 1er commando de choc des Commandos d’Afrique.
Une procédure annoncée en mars prochain
Dès la fin du conflit, à la différence de son grand frère du mont Coudon, le fortin est lâché par l’armée. Appartenant toujours à l’État, il sert par la suite de siège à des associations culturelles, artistiques, et donc d’atelier à Louis Melcky.
Et, alors qu’il fête cette année ses 140 ans d’existence, 2024 pourrait marquer un petit tournant dans son histoire, puisque son propriétaire a décidé de s’en séparer.
L’ouvrage figure actuellement sur le site des cessions immobilières de l’État, qui doit annoncer la procédure de vente au mois de mars 2024. Sollicité, le service de la gestion domaniale n’a pas souhaité faire de commentaire.
Pendant ce temps, le fort du Bau Pointu continue de recevoir occasionnellement les promeneurs. En attendant d’accueillir, peut-être, un nouveau propriétaire.
Une valeur difficile à estimer
Pour tenter de connaître la valeur approximative du bien, nous avons contacté un conseiller immobilier toulonnais. Au vu des rares éléments à disposition, il assure qu’il est aujourd’hui difficile de donner, d’un point de vue extérieur, une fourchette de prix pour le fortin.
« Le fort du Grand Saint-Antoine avait bien été vendu il y a quelques années, mais c’est incomparable. En fait, tout ce qui est atypique, exceptionnel, de manière générale, ce n’est pas tarifé », explique-t-il. Il faudra donc attendre le mois de mars.
Le mot de Kat : Rappel de la Fédération Française de randonnée
- Avons-nous le droit de randonner n’importe où ?
Non. Partout, vous êtes chez quelqu’un, chemin public ou privé.
Vous ne pouvez pas traverser une propriété privée sans autorisation, sous peine de commettre une violation de domicile. Cette infraction est passible de 15.000 € d'amende et d'un an de prison (art. 226-4 du Code pénal).- Randonner sur itinéraire balisé ?
Le balisage indique que le chemin est ouvert à la randonnée.- Randonner sur un itinéraire non balisé ?
La randonnée est tolérée sauf s’il y a mention d’interdiction ou de propriété privée (panneau, chaîne, barrière…)
Début janvier, un propriétaire a fermé un sentier qui passait depuis des décennies sur son terrain, en s’appuyant sur une nouvelle loi qui inquiète les randonneurs.
ENVIRONNEMENT - La montagne appartient-elle à tout le monde ? À Rimbach-prés-Masevaux (Haut-Rhin), dans le massif des Vosges, un cortège impressionnant d’un millier de randonneurs a manifesté, samedi 17 février, contre la fermeture d’un sentier de randonnée par un propriétaire privé, qui s’appuie sur une nouvelle loi qui pénalise le passage sur une propriété rurale ou forestière.
Le 11 janvier dernier, le groupement forestier du Wustkopf, acquéreur de 64 hectares dans la vallée haut-rhinoise de la Doller, a envoyé un mail expéditif au Club Vosgien de Masevaux pour lui annoncer la fermeture d’un chemin et exiger l’enlèvement du balisage. « Aucune tolérance ne sera admise », affirme le propriétaire.
Comme vous pouvez le voir dans notre reportage vidéo en tête d’article, Le HuffPost a suivi sur le terrain cette mobilisation. À notre micro, les randonneurs expliquent leur désarroi face à la fermeture de leur sentier. Des sections de ce dernier ont par ailleurs été obstruées par des arbres déracinés, des talus ou des tranchées, selon les constatations du Club Vosgien, du HuffPost et de nos confrères du journal L’Alsace. Nous avons tenté de joindre le propriétaire à plusieurs reprises, sans succès.
Une tolérance remise en cause
Le groupement forestier s’appuie sur une nouvelle loi, promulguée le 2 février 2023, qui vise à « limiter l’engrillagement des espaces naturels » pour laisser circuler la faune. Une démarche a priori vertueuse, mais le texte inclut, pour rassurer les propriétaires, cette disposition : « dans le cas où le caractère privé du lieu est matérialisé physiquement, pénétrer sans autorisation dans la propriété privée rurale ou forestière d’autrui, sauf les cas où la loi le permet, constitue une contravention de la 4e classe », à savoir un minimum de 135 euros d’amende.
Depuis un an, la loi du 2 février 2023 a mené à la fermeture d’autres sentiers, dans le massif de la Chartreuse ou encore sur la Côte d’Azur. Dans les deux cas, de grands propriétaires terriens ont fermé leur terrain aux randonneurs, avec des panneaux « propriété privée », tout en continuant d’accueillir des chasseurs moyennent un droit d’accès. Les maîtres des lieux se justifient par la surfréquentation des sentiers et les incivilités.
Dans une tribune publiée le 30 décembre dernier par Le Monde, un collectif d’élus écologistes et d’associations environnementales affirme que « se promener dans la nature n’est pas un crime ». « Dans la pratique, une certaine tolérance d’accès aux espaces de nature existe de longue date, qu’elle soit tacite ou formalisée à travers des conventions entre acteurs publics et propriétaires privés. Ce compromis fragile est aujourd’hui remis en cause », écrivent les signataires, qui invitent les parlementaires à revoir la loi.
À l'origine, la tradition du parrainage trouve sa source dans la religion catholique. Lors du baptême, l'enfant se voyait désigner un parrain et une marraine chargés de lui assurer une présence spirituelle et le guider vers la foi. Ces figures intronisées devaient alors assister à tous les événements religieux ponctuant la vie de leur filleul, une pratique encore d'actualité.
«C'est par tradition religieuse et par tradition familiale qu'on a automatiquement pris un parrain et une marraine pour notre enfant, raconte Capucine, 30 ans, catholique et croyante, dont le bébé sera bientôt baptisé. Selon nous, c'est important qu'il soit guidé spirituellement sans que ce soit forcément par le regard de ses parents.»
Peu à peu, le parrainage s'est pourtant décorrélé de la religion. Les personnes non croyantes peuvent désormais organiser un baptême civil au cours duquel un parrain et une marraine sont désignés, ou même choisir de nommer ces figures en dehors de tout cadre officiel.
«Il y a une diversification du parrainage qui correspond à la perte d'importance de la religion chrétienne, analyse le sociologue Gérard Neyrand, spécialisé dans les questions de parentalité et de mutations familiales, et auteur de Le Dialogue familial – Un idéal précaire. Aujourd'hui, les gens sont moins pratiquants, il y a donc une baisse de l'importance du parrainage religieux, qui reste toujours présent quant à sa valeur symbolique mais qui peut désormais être déplacé sur d'autres personnes que sur les membres de la famille.»
Plus besoin d'être catholique, soi-même baptisé ou avec un lien de parenté pour être le mentor de l'enfant. Les critères du parrainage sont devenus plus souples et adaptés à la société actuelle.
Rôle symbolique, rôle concret
Beaucoup pensent toujours que le parrainage implique la garde de son ou sa filleule en cas de décès des parents. Les parrains et marraines ne sont pourtant pas automatiquement tuteurs légaux en cas de problème, sauf si le testament le mentionne explicitement.
«Jusqu'à un temps relativement récent, la mortalité précoce était beaucoup plus importante qu'aujourd'hui, donc les parents avaient effectivement besoin d'être remplacés par le parrain ou la marraine, c'était un réel engagement, retrace Gérard Neyrand. Aujourd'hui, on sait que les enfants élevés dans une famille vont vraisemblablement le rester jusqu'à leur majorité, donc cette fonction a disparu mais sa valeur symbolique demeure.»
«Bien souvent, les parrains et marraines font des cadeaux aux enfants, sont une présence supplémentaire valorisée mais pas beaucoup plus.» Gérard Neyrand, sociologue spécialisé dans les questions de parentalité et de mutations familiales
Si le rôle des parrains et marraines n'est plus (exclusivement) d'accompagner l'enfant dans son éducation religieuse, leur fonction spirituelle traditionnelle reste enracinée. Il s'agit ainsi d'être un guide pour l'enfant, une figure de confiance sur laquelle il peut compter. «Le rôle d'une marraine, selon moi, c'est un accompagnement, un renfort des parents, détaille Maria, 62 ans, que la fille d'une de ses amies a choisie comme marraine après s'être fait baptiser à 16 ans. Je suis là pour elle, on s'appelle, on garde un lien. Je me sens engagée non pas dans un rôle parental mais dans un rôle de conseillère, un référent adulte de confiance.»
Au-delà de ce rôle symbolique, la fonction de parrain et de marraine se double d'une fonction plus concrète dans la vie de l'enfant. Passer du temps avec lui, lui offrir des présents ou se substituer parfois aux parents en cas de défaillance. «On attend d'eux qu'ils rendent aussi bien de menus services pour “remplacer les parents” (garde de leur filleul pendant les vacances, aide scolaire, aide financière) que de grands services si le besoin s'en fait sentir», analyse l'anthropologue et historienne Agnès Fine, l'une des seules à travailler sur le sujet du parrainage, dans un article paru dans la revue Lien social et politiques.
Une mission pratique à remettre en cause selon Gérard Neyrand, qui souligne un rôle dont les contours restent flous. «Bien souvent, les parrains et marraines font des cadeaux aux enfants, sont une présence supplémentaire valorisée mais pas beaucoup plus, précise le professeur émérite à l'Université de Toulouse et responsable du Cimerss (Centre interdisciplinaire méditerranéen d'études et de recherches en sciences sociales). Ils ont rarement une fonction directement concrète, même s'ils peuvent éventuellement apporter un bénéfice à l'enfant par la suite.»
Un constat partagé par Charline, 28 ans, qui n'observe pas une influence tangible de ses mentors: «Plus jeune, c'était le petit plus. Mais aujourd'hui, je ne les vois pas souvent et je suis un peu indifférente au fait d'en avoir.» Ce détachement est notamment induit par le fait que la fonction est occupée par son oncle et sa tante.
Des critères de sélection qui évoluent
Ce choix familial, effectué dans le cadre d'un baptême républicain, est là encore hérité de la religion. «Pendant longtemps, les parrains et les marraines étaient choisis dans le cercle familial, souvent pour faire honneur à un membre de la famille», confirme la psychanalyste Nicole Fabre, interrogée par La Croix.
Si la tradition persiste, de nombreux baptêmes civils sont aujourd'hui célébrés et les parrainages puisés dans un cercle moins restreint. Le choix se porte alors souvent sur quelqu'un de proche géographiquement et affectueusement. «C'est désormais une question de proximité affective, décrypte Gérard Neyrand. On constitue une famille qui serait choisie plutôt que subie, puisque les parrains et les marraines peuvent être des proches, des amis, des personnes de confiance. Cela diverge très nettement du parrainage religieux dont les critères étaient très stricts.»
«Le fait d'estampiller le mot “marraine” a officialisé quelque chose, c'est comme si je faisais partie de la famille désormais.» Maria, 62 ans
D'après le sociologue, le parrainage contemporain implique surtout un suivi bienveillant de la part de personnes avec lesquelles les parents entretiennent un lien positif. «Désigner un parrain ou une marraine est une occasion privilégiée offerte aux parents pour signifier un sentiment d'affection ou d'amitié à l'égard de tel ou tel membre de la parenté. Mais affirmer la prérogative des parents ne veut pas dire pour autant que leur choix se fait sans principes, nuance Agnès Fine. On doit choisir un parent proche en équilibrant les branches paternelle et maternelle.» C'est d'ailleurs le cas de Capucine et son mari, qui ont sélectionné des proches de leurs familles respectives pour assumer cette responsabilité.
Le parrainage, créateur de lien social
La vitalité actuelle du parrainage invite à s'interroger sur ses fonctions dans les relations familiales. Choisir un parrain et une marraine intensifie les liens avec différents cercles de proches. La sociologue Claire Bidart évoque ainsi la thèse d'un mélange entre compérage intensif, c'est-à-dire un choix au sein de la famille permettant de renforcer les relations de parenté, et un compérage extensif, qui quant à lui permettrait d'élargir la parenté aux amis.
«Parce que l'enfant est important, le parrainage occupe une place stratégique dans le jeu des relations que les parents tissent autour de lui, détaille Agnès Fine. Pas de cadeau plus valorisé à leurs yeux que celui de donner symboliquement leur enfant à quelqu'un, de lui proposer de partager un peu leur fonction parentale.»
Cette marque d'honneur constitue historiquement un lien solide. L'objectif était notamment de rapprocher des lignées qui autrement s'éloigneraient. L'anthropologue rappelle par exemple que dans l'Europe médiévale comme dans une grande partie de l'Europe du Sud jusqu'à nos jours, le parrainage permettait d'entériner un lien d'amitié sacrée, «une sorte de fraternité jurée spécifique de la culture chrétienne». Refuser un parrainage pouvait alors porter malheur ou même être considéré comme un péché.
Aujourd'hui, être choisi comme parrain ou marraine permet surtout de valoriser un lien d'amitié et d'intégrer un lien du sang là où il n'y en a pas. Cette dimension a été fortement ressentie par Maria au moment de sa désignation comme marraine il y a cinq ans. «J'ai été honorée, flattée, raconte la sexagénaire. Le fait d'estampiller le mot “marraine” a officialisé quelque chose, c'est comme si je faisais partie de la famille désormais.»
Agnès Fines résume la double efficacité du parrainage ainsi: créer de l'amitié entre parents et de la parenté entre amis. «Elle est si importante qu'on peut se demander pourquoi elle n'est pas si systématiquement “exploitée”», s'interroge d'ailleurs l'historienne, qui met le doigt sur la superficialité de certains de ces liens. De nombreux parrains et marraines n'ont en effet aucune relation particulière avec leur filleul, du fait d'un désintérêt ou d'une relation distendue avec les parents.
La place du parrainage dans la famille contemporaine
C'est pourtant ce qui fait la force du parrainage contemporain selon Agnès Fine. «Les obligations impliquées par le statut de parrain ou de filleul ne sont pas perçues comme véritablement contraignantes de sorte que la relation semble ne dépendre que de la volonté et des sentiments, ce qui ajoute à son pouvoir d'attraction», note l'anthropologue.
C'est comme cela que le conçoit Maria. Puisque sa filleule est désormais fiancée, le temps passé ensemble est restreint, ce qui ne les empêche pas de conserver ce lien spécial. «Elle n'a pas beaucoup de temps libre et moi non plus mais on se voit à des occasions particulières et elle sait que je suis là si besoin», affirme-t-elle.
La popularité du parrainage s'ancre aussi dans un contexte de transformation des relations familiales. Dans une société de plus en plus individualiste, ce lien social tente de contrecarrer le repli sur soi. «La famille s'est de plus en plus nucléarisée, recentrée sur le noyau parents-enfants, tandis que les relations avec la famille élargie sont beaucoup moins fréquentes qu'autrefois, indique Gérard Neyrand. L'ouverture au parrainage permet de desserrer un peu cette logique de restriction de la famille.»
D'autre part, la place centrale occupée par l'enfant dans la société occidentale contemporaine explique également ce phénomène. Le fort investissement sur l'enfance entraîne une volonté de développer des relations affectives autour de lui. «Il y a par exemple beaucoup de familles monoparentales, ce qui favorise la recherche d'un élargissement des personnes susceptibles d'être en lien et d'apporter un confort moral et psychologique aux enfants et aussi aux parents», remarque le sociologue. Dans cette logique, les parents –seuls ou en couple– cherchent à entourer leur progéniture d'une figure de confiance qui pourra assumer ce rôle.
La Grande Randonnée vers Paris, organisée à l’approche des Jeux olympiques, débarque dans l’aire toulonnaise ce mardi. Cap sur Le Revest, puis Ollioules.
C. S. Publié le 26/01/2024 à 20:40, mis à jour le 26/01/2024 à 20:40
La Grande randonnée a commencé le 13 janvier à Nice pour rejoindre la capitale, et ce au travers de nombreuses étapes. Photo doc V-M
Abonnez-vous
Après Méounes, c’est au tour du Revest, d’Ollioules, de Sanary et de La Cadière d’être les villes étapes de la Grande randonnée organisée par la Fédération française de cette discipline. Soutenus par les clubs de randonnée locaux – en partenariat avec les communes – le comité départemental olympique et sportif ainsi que les ambassadeurs de la fédération invitent le public à se lancer un défi personnel ou collectif lors des nombreuses étapes proposées.
Celle prévue au Revest marquera l’entrée dans le territoire de la métropole TPM, le mardi 30 janvier depuis Méounes, avant de prendre la direction d’Ollioules le lendemain.
Des animations "surprises"
"C’est une belle mobilisation collective de notre réseau fédéral, qui va dynamiser nos territoires, explique Marc Peres, vice-président du comité départemental de randonnée. Ça me fait plaisir de préparer l’étape du Revest. C’est toute mon enfance. Et c’est un village qui a gardé son identité provençale."
Sur l’étape du Revest, les préparatifs vont bon train. "L’arrivée du mardi soir se fera à l’école élémentaire Philippe Rocchi et le départ du lendemain depuis le jardin public du centre-ville avec des animations surprises au programme pour les randonneurs. Les enfants des accueils de loisirs sont attendus par cette belle aventure. Durant les étapes prévues dans la métropole, les participants pourront découvrir les belles aiguilles de Valbelle, les îles hyéroises, les monts toulonnais... Cent personnes sont déjà inscrites sur les deux tracés", assurele maire du Revest, Ange Musso.
Rens.: var@ffrandonnee.fr
Pratique
- Mardi 30 janvier : Méounes - Le Revest, 19,7 km. Arrivée à l’école Philippe Rocchi autour d’animations et goûter pour les randonneurs à 16 h 35.
- Mercredi 31 janvier : Le Revest -Ollioules, 12,9 km. Départ à 9 h devant le jardin public autour d’un déjeuner. Arrivée prévue à Ollioules vers 16 h 30 au musée de la fleur.
Ingénieur de formation, Jean-Yves Vanier a travaillé des dizaines d'années dans la pétrochimie, à Edmonton, dans l'Ouest canadien. Ce Québécois d'origine a finalement décidé de tout lâcher pour se lancer dans la généalogie, sa passion, et il fait désormais pousser les branches généalogiques de sa famille, comme de celles de ses clients.
Au premier étage de la Cité Francophone d'Edmonton, une petite porte discrète se cache au bout d'un couloir. Un écriteau indique : « Société généalogique du Nord-Ouest ». Trois ordinateurs, deux grandes tables et des étagères garnies de bouquins remplissent les lieux. Il n'y a pas foule : trois bénévoles passionnés discutent autour d'une table, deux femmes et un homme.
Michèle Fortin, Doriane Vincent et Jean-Yves Vanier pourraient presque dire qu'ils sont de la même famille, car ils ont tous de la famille originaire du Québec. « On se trouve des ancêtres communs entre francophones, facilement. Au Québec, l'endogamie était très importante, à l'origine, il n'y avait que quelques milliers de colons en Nouvelle-France ! En cadeau à mes parents, je leur ai même trouvé un cousin à la 11e génération », s'amuse le généalogiste, 52 ans, de long cheveux gris encadrant des petites lunettes rectangulaires.
Michèle renchérit avec un grand sourire : « On a même des vedettes dans nos arbres généalogiques ! Moi, je suis une cousine très lointaine avec Céline Dion – comme beaucoup de monde, et j'ai même le Premier ministre Justin Trudeau, à quatre générations, ce n'est pas si loin. »
Une passion soudaine
Contrairement à beaucoup de généalogistes, Jean-Yves n'a pas découvert ses origines grâce à sa famille. Originaire de Gatineau, ville limitrophe d'Ottawa, dans l'Est canadien, il suit des études d'ingénierie, en français puis en anglais, et obtient un poste dans la pétrochimie, à Edmonton, en Alberta. « J'avais fait un stage avec une compagnie et ils m'ont offert un poste en 1995. J'étais le premier de la famille sur plusieurs générations à partir pour l'ouest », décrit le généalogiste. Une dizaine d'années plus tard, sa mère reçoit, à la maison familiale de Gatineau, une lettre qu'elle lui transfère. « C'était une lettre qui disait : je suis généalogiste, je m'appelle Noël Vanier de Laval, et si vous me donnez l'information de votre famille immédiate, je vous envoie votre arbre généalogique », se rappelle Jean-Yves.
Curieux, il accepte, transmet des informations sur sa famille et reçoit quelques semaines plus tard une enveloppe bien plus épaisse. Là, Jean-Yves est impressionné : « C'étaient de très grandes feuilles. J'étale tout ça par terre, et ça me donne un arbre avec ma famille, de mon nom, jusqu'au premier Guillaume Vanier, originaire d'Honfleur, arrivé en 1665. J'ai appris que j'étais cousin avec le gouverneur général Georges Vanier, par exemple ! »
Pour remercier ses proches qui l'ont aidé, Jean-Yves décide en 2006 de créer un site internet avec un objectif : retracer l'intégralité de ses ancêtres. « Aujourd'hui, il est énorme, à l'époque, c'était tout petit. Google l'a référencé, puis un autre généalogiste, Vanier m'a contacté pour me dire que je pouvais ajouter une autre branche à son arbre, et encore un autre. C'est devenu un site familial de toute l'Amérique du Nord. » Pendant un temps, quatre Vanier, généalogistes amateurs ou professionnels, travaillent ensemble. Aujourd'hui, l'arbre numérique compte des milliers d'ancêtres.
Du plastique aux racines
Mais Jean-Yves ne s'arrête pas là, il commence à sérieusement se plonger dans le domaine et poursuit des recherches en amateur. Après 25 ans dans la pétrochimie, il craque : « J'ai fait un burn-out et je me suis dit que je devais m'arrêter. J'avais accumulé assez d'argent, et mon épouse, qui travaillait encore, m'a rappelé qu'elle avait eu cinq ans de congés pour faire des études, et que je pouvais le faire à mon tour. » La pandémie de coronavirus le lance définitivement. Il devient professionnel en se formant en ligne, obtient des diplômes en généalogie. « Je suis plus heureux, moins stressé. La rémunération est moins bonne, mais c'est un travail très valorisant : je rends les gens heureux. Avant, tu sais, je fabriquais du plastique », souffle le professionnel.
Depuis trois ans, il a lancé son entreprise, Vos Aïeux. Ce qu'il aime, c'est la diversité des histoires. Les Québécois, souvent, veulent connaître leurs origines en France, qui remontent pour certains au XVIe siècle. Les Acadiens, une population qui a été déportée après la conquête anglaise, veulent plutôt savoir ce qu'ont vécu leurs ancêtres à cette époque. Certaines trajectoires le touchent beaucoup : « J'avais notamment retracé l'histoire de deux Acadiens déportés en France, à Saint-Malo, et qui étaient morts, l'une durant la traversée et l'autre peu de temps après, laissant derrière eux des orphelins. »
Certaines recherches, les plus simples et directes, ne lui prennent que quelques heures, qu'il facture moins de cent dollars canadiens, une soixantaine d'euros. D'autres en revanche… « Un monsieur m'a engagé pour plusieurs années. Il veut tout savoir, toutes les histoires de tous ses ancêtres. Il doit bien dépenser près de 20 000 dollars ! Il dit que c'est un legs pour ses enfants, il veut même que je lui écrive un livre avec toutes les anecdotes que j'aurais trouvées », décrit Jean-Yves, encore étonné.
En tout cas, Jean-Yves Vanier n'est pas près de se lasser. Chaque présentation, qu'il fait devant des familles qui l'ont engagé, lui rappelle pourquoi il a choisi ce métier : « Les gens adorent ça. Quand je fais mes présentations, tout le monde est heureux, ils sont émerveillés par leurs propres histoires, qu'ils ne connaissaient pas. »
Depuis aussi loin que je me souvienne, j’aime les histoires.
Ce goût m’a conduit vers l’Histoire, grâce aux manuels de l’école primaire des années 60 qui nous entraînaient dans ces tentatives de reconstitution de la vie quotidienne des Gaulois et autres Vikings.
Les illustrations étaient sommaires et l’auteur concédait quelques incursions dans les biographies stéréotypées de ces héros qui ont fait la France : Vercingétorix, ce noble perdant, Jeanne d’Arc, cette fille du peuple qui remet son roi sur le trône ou bien ce jeune révolutionnaire de 15 ans qui sera assassiné par ces Vendéens obtus pour avoir clamé avec défi : « vive la République, à bas le Roi ».
Vers l’âge de 14 ans, j’ai accompagné les premiers pas de ma mère dans la généalogie, à travers les registres paroissiaux de la petite mairie du village natal de bon nombre de ses ancêtres.
Je crois que j’aimais à la fois l’enquête poursuivie et le déchiffrage de ces actes d’état civil, me prenant sans doute un peu pour Champollion qui a trouvé les clés pour décrypter un monde lointain d’histoires quotidiennes.
Si loin et si proche, à l’instar de ce que nous racontent les graffitis de Pompéi.
Les actes notariés ont permis ensuite d’entrevoir un peu plus les personnes cachées derrière ces lignées et ces dates et m’ont amené à chasser les singularités au-delà des formules très classiques que l’on y trouve. Cette quête permet parfois de glaner quelques pépites comme cette lettre de Paris d’un orfèvre à sa femme aux fins de l’autoriser à prendre un bail et dans laquelle il se répand sur ses déboires judiciaires.
A partir de ces éléments épars, je trouve passionnant d’échafauder et d’ajuster des hypothèses à partir des éléments rassemblés et confrontés avec la grande histoire, dans un constant va-et-vient.
Dans ce travail, certains détails initialement négligés prennent un sens particulier tandis que d’autres n’ont pas le relief qu’ils promettaient au départ.
Ces très modestes assemblages permettent de donner un peu de chair à ces noms et d’esquisser certaines histoires singulières. C’est ce que je me propose de faire très modestement dans ce blog, tenter d’éclairer des fragments de vie de mes ancêtres, à la lumière de la grande histoire
Le mot de Kat : Les résultats du moteur de recherche Google sont spammés et de mauvaise qualité selon une étude de ... chercheurs allemands. Google répond : On peut rien y faire, c'est la faute au SEO dopé à l'IA qui pourrit notre moteur.
Par Meera Navlakha le 18 janvier 2024 (mis à jour pour intégrer la réponse de Google)
Vous n'êtes pas le seul, la recherche sur Google a vraiment empiré Une nouvelle étude menée par des chercheurs allemands a révélé que la recherche sur Google est infestée de spam SEO. Votre expérience de la recherche sur Google a-t-elle changé pour le pire ? Vous n'êtes peut-être pas le seul.
Cette révélation provient d'une nouvelle étude menée par des chercheurs allemands de l'université de Leipzig, de l'université Bauhaus de Weimar et du Center for Scalable Data Analytics and Artificial Intelligence (Centre pour l'analyse des données évolutives et l'intelligence artificielle). Les chercheurs ont posé la question "Google devient-il pire ?" en examinant 7 392 requêtes d'évaluation de produits sur Google, Bing et DuckDuckGo pendant un an.
Les chercheurs se sont appuyés sur des rapports indiquant qu'"un torrent de contenu de faible qualité, en particulier pour la recherche de produits, continue de noyer tout type d'information utile dans les résultats de recherche". Un nombre important de résultats trouvés en réponse à des requêtes liées à des produits étaient des "spams de référencement de produits".
La recherche a montré que les sites de spam sont très répandus, apparaissant en haut des classements de Google dans ce qui est une "bataille constante" entre les sites et le moteur de recherche. En d'autres termes, écrivent-ils, "les moteurs de recherche semblent perdre le jeu du chat et de la souris qu'est le spam SEO".
"Le référencement est une bataille constante et nous observons des schémas répétés d'entrée et de sortie de spams dans les résultats, alors que les moteurs de recherche et les ingénieurs en référencement ajustent leurs paramètres à tour de rôle", peut-on lire dans le rapport. Bien que Google, Bing et DuckDuckGo éliminent les spams, les chercheurs affirment que cela n'a qu'un "effet positif temporaire".
Un porte-parole de Google a déclaré à Mashable que l'étude "ne reflète pas la qualité et l'utilité globales de la recherche". Il a souligné que l'étude ne portait que sur un ensemble restreint de requêtes, à savoir la recherche de produits.
"Cette étude ne s'intéresse qu'au contenu des critiques de produits et ne reflète pas la qualité et l'utilité globales de la recherche pour les milliards de requêtes que nous recevons chaque jour. Nous avons apporté des améliorations spécifiques pour remédier à ces problèmes, et l'étude elle-même souligne que Google s'est amélioré au cours de l'année écoulée et que ses performances sont supérieures à celles des autres moteurs de recherche. De manière plus générale, de nombreux tiers ont mesuré les résultats des moteurs de recherche pour d'autres types de requêtes et ont constaté que Google était d'une qualité nettement supérieure aux autres", a déclaré le porte-parole.
L'étude en question a montré que les résultats de Google se sont améliorés "dans une certaine mesure" entre le début et la fin de l'expérience des chercheurs. Néanmoins, ils ont constaté "une tendance générale à la baisse de la qualité des textes dans les trois moteurs de recherche". Avec la présence de spam généré par l'IA, la situation ne peut que s'aggraver, prévient l'étude.
"Nous concluons que le spam contradictoire dynamique sous la forme d'un contenu commercial de faible qualité produit en masse mérite plus d'attention", écrivent les chercheurs.
Comme le rapporte 404Media, d'autres chercheurs ont remarqué que Google était inondé de spam. Search Engine Journal, par exemple, a déclaré qu'en décembre 2023, Google a été submergé par une attaque massive de spam qui a duré plusieurs jours.
Mozilla, le développeur de logiciels en difficulté, a accusé les fabricants de navigateurs dominants - Apple, Google et Microsoft - d'utiliser des raccourcis pour gagner plus d'utilisateurs et les éloigner des outils indépendants comme Firefox.
Selon Mozilla, une communauté logicielle fondée en 1998 qui développe exclusivement des logiciels libres, dont le navigateur web Firefox, les "acteurs dominants" cherchent à "contrôler le navigateur que les gens utilisent".
La bonne façon de gagner des utilisateurs est de construire un meilleur produit, mais les raccourcis peuvent être irrésistibles - et il y a une longue histoire d'entreprises qui tirent parti de leur contrôle des appareils et des systèmes d'exploitation pour faire pencher la balance en faveur de leur propre navigateur, A déclaré Moziila dans un billet de blog.
L'entreprise a déclaré que les principaux fabricants de navigateurs compliquent généralement la tâche des utilisateurs qui souhaitent télécharger et utiliser un autre navigateur. Ils ignorent ou réinitialisent également les préférences par défaut du navigateur de l'utilisateur ou, par exemple, exigent l'utilisation du moteur de navigation de la première partie pour les navigateurs tiers.
Dans une démarche qui, en substance, interpelle Google et son Chrome, Edge de Microsoft et Safari d'Apple, Mozilla a lancé un nouvel outil de suivi des problèmes dans lequel l'entreprise a l'intention de documenter les façons dont les plates-formes désavantagent Firefox.
"Nous pensons qu'il est temps de publier ces préoccupations en utilisant le même processus transparent et les mêmes outils que nous utilisons pour développer des positions sur les normes techniques émergentes", a déclaré la société.
Par exemple, Mozilla estime qu'il est injuste qu'Apple interdise les moteurs de navigation tiers et limite la capacité de l'utilisateur à transférer ses données dans un autre navigateur lorsqu'il passe de Safari à un autre.
Certaines fonctionnalités de Windows lancent Microsoft Edge au lieu du navigateur par défaut de l'utilisateur, alors que ce choix devrait être respecté, selon Mozilla. Il en va de même pour Google et son navigateur Chrome : certaines fonctionnalités Android se lancent sur Chrome au lieu du navigateur par défaut de l'utilisateur.
Les gens méritent d'avoir le choix, et le choix nécessite l'existence d'alternatives viables. Les alternatives et la concurrence sont bénéfiques pour tous, mais elles ne peuvent se développer que si les règles du jeu sont équitables. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais il n'est pas difficile d'y remédier si les fournisseurs de plates-formes le souhaitent, a déclaré Mozilla.
Il est difficile pour le navigateur de niche Firefox de rivaliser avec ce que proposent les géants, et cela commence à se voir. À l'été 2010, Firefox a atteint son point culminant avec 34,1 % du marché, mais depuis, c'est la dégringolade : le navigateur de Mozilla ne représente plus que 2,2 % du marché américain.
Publié le 23 Janvier 2024 par Gintaras Radauskas (Cybernews)
<Les féministes d’aujourd’hui sont-elles extrémistes ? Des magazines tels Causeur et Valeurs actuelles font leurs gros titres sur la « terreur féministe » et la radicalité des combats que des militantes « devenues folles » mèneraient contre le genre masculin. Le Rapport annuel 2024 sur l’état des sexismes en France qui met en avant une augmentation des idées machistes chez les jeunes hommes de 24-35 ans déplace le pôle de la radicalité en question.
« Faisons du sexisme de l’histoire ancienne », commente le rapport 2024. Ces débats sur le postulat de l’extrémisme féministe d’aujourd’hui et le constat de la montée concomitante des conservatismes masculins à l’égard des femmes intéressent assurément l’histoire et renvoient aux positionnements des antiféminismes et masculinismes d’hier.
Un exemple édifiant est la loi qui a permis aux jeunes filles d’accéder à l’enseignement secondaire en France. Adoptée le 21 décembre 1880, sous la IIIe République, la « loi Camille Sée » a révélé un masculinisme agitant le chiffon rouge de ce qui était perçu à l’époque comme de l’extrémisme féministe.
Note de Kat : j'ai fait mes études secondaires au Lycée Camille Sée à Paris
Tout à la fois, cette loi républicaine est novatrice et conservatrice.
Novatrice, car elle instaure pour les jeunes filles ce que le Second Empire n’a pas réussi à faire. Soucieux de promouvoir un enseignement secondaire féminin, le ministre de l’Instruction publique Victor Duruy avait posé avec la circulaire du 30 octobre 1867 le projet de la création de Cours d’enseignement secondaire pour les jeunes femmes. Cette initiative avait soulevé une violente opposition de l’Église catholique qui contribuera à l’échec de cette entreprise. La politique scolaire du ministre se situait dans le contexte d’un Second Empire qui avait initié une ébauche d’instruction féminine dans le primaire, avec la loi Falloux qui permettait l’ouverture d’une école primaire pour les filles dans chaque commune de plus de 800 habitants et la loi de Victor Duruy du 10 avril 1867 qui abaissait ce seuil à 500. Ces mesures étaient des avancées au regard de la loi de juin 1833 de François Guizot qui, sous la monarchie de Juillet, avait obligé l’ouverture d’écoles primaires pour les garçons dans chaque commune de plus de 500 habitants, en faisant l’impasse sur l’instruction primaire des filles.
Cette loi républicaine du 21 décembre 1880 est aussi conservatrice car elle crée de façon volontaire un enseignement féminin qui n’a ni le même cursus, ni le même programme, ni le même diplôme que celui des garçons. Il se déroule en cinq ans, au lieu de sept pour eux. Il privilégie un enseignement ménager et de couture pour elles. Et il n’inclut dans son programme aucun cours de philosophie et de langues anciennes. Or, ces matières sont obligatoires au baccalauréat. La fin du cursus donne accès non pas un baccalauréat, mais à un « diplôme de fin d’études secondaires » qui ne permet pas aux filles d’accéder à l’université. Les républicains ont donc profité du revers du Second Empire pour créer un enseignement féminin à leur convenance. Mais s’ils ont œuvré pour que la jeune fille ne soit plus élevée « sur les genoux de l’église », selon la formule chère à leur adversaire clérical, Monseigneur Dupanloup, ils ont aussi agi pour qu’elle soit élevée sur les genoux républicains du foyer familial.
Cet inégalitarisme de scolarisation entre filles et garçons n’est pas le fait du hasard. Dans ce XIXe siècle masculiniste, il résulte d’une peur que les hommes ont que les femmes puissent accéder à autre chose qu’un simple enseignement élémentaire. Cette frayeur tourne autour d’une trilogie que scandent législateurs et autres théoriciens de l’éducation dans les discours, ouvrages et articles dont ils sont les auteurs : les femmes studieuses seraient des femmes orgueilleuses, hideuses, dangereuses. Les délibérations qui se tiennent à la Chambre des députés en décembre 1879 et janvier 1880 ainsi qu’au Sénat en novembre et décembre 1880 permettent de bien rentrer dans le détail de ces émois.
Femmes studieuses, femmes orgueilleuses
Les Femmes savantes de Molière et Les Bas-Bleus de Barbey d’Aurevilly sont dans toutes les têtes lors des débats parlementaires et sénatoriaux. Ces pédantes ridicules sans talent sont des repoussoirs absolus. Dans l’introduction à son projet de loi, le député Camille Sée rassure ses collègues parlementaires :
« Il ne s’agit ni de détourner les femmes de leur véritable vocation, qui est d’élever leurs enfants et de tenir leurs ménages, ni de les transformer en savants, en bas-bleus, en ergoteuses. » (ndlr, « bas-bleu » est expression péjorative pour désigner une femme cultivée)
Pas plus par snobisme hautain que par surcroît d’intellectualité, il leur promet que la femme républicaine n’abandonnera les tâches culinaires qui lui reviennent :
« L’économie domestique leur est indispensable ; Chrysale a raison : il faut songer au pot-au-feu. On le dédaignait par mondanité ; il ne faut pas qu’on le dédaigne par excès de capacité. »
Sur les bancs de ces nobles assemblées, des cris fusent contre les « habits déchirés » que la femme, trop « occupée de hautes études » ne voudra plus recoudre pour son mari. Ils s’indignent aussi du « rôti brulé » et du « pot-au-feu manqué » qu’elle ne manquera pas de lui servir.
Toutes ces admonestations sur les « savantes », les « bas-bleus », les « ergoteuses » avec leur « mondanité », leur « capacité » et leurs « hautes études » sont des doigts sévèrement pointés sur celles qui sont perçues comme de futures orgueilleuses instruites et diplômées qui ne pourront que regarder de haut les tâches subalternes des habits à recoudre et du dîner à préparer. Même après la proclamation de la loi, les recommandations restent tenaces contre « l’orgueil » de la jeune fille instruite.
Tout ce qui relève du scientifique exacerbe particulièrement les élites de l’époque. Le 28 juillet 1882, l’ancien ministre de l’Instruction publique Jules Simon déclare lors d’une remise de prix à de jeunes lycéennes :
« Je soutiens qu’il est parfaitement inutile d’enseigner la chimie et la physique aux filles […] »
Le risque de ces sciences, continue-t-il, est de faire de ces jeunes femmes des mères infatuées qui ne s’abaisseront plus à nourrir leur progéniture. Elles utiliseront un langage châtié pour vérifier que leur servante ait bien mis du sucre dans le bouillon de leur petit. Jules Simon se moque du ridicule qu’aurait leur style ampoulé :
« [Elles] ne manqueront pas […] de s’écrier en molestant la nourrice de leur enfant – car elles ne nourriront certainement plus elles-mêmes – “Avez-vous donné à mon fils son potage sacchariné ?” »
Femmes studieuses, femmes hideuses
La femme hideuse, c’est la « virago », cette mégère autoritaire aux allures masculines que généreront ces études secondaires. Trois jours après la séance sénatoriale du 22 novembre 1880, l’écrivain Octave Mirbeau dans le journal Le Gaulois s’étrangle de colère devant la politique républicaine en cours :
« Qu’est-ce que j’apprends ? Et où allons-nous, mon Dieu ? Ne voila-t-il pas, maintenant, qu’ils veulent prendre nos filles pour en faire des hommes ! »
Après quelques considérations sur « la barbe au menton » qu’elles ne manqueront pas d’avoir, il dénonce le sabotage d’identité qui se trame :
« II s’agit de les déniaiser, de les savantiser, de les bas-bleuiser, de les garçonniser, de les viriliser. »
Tous horizons politiques confondus, le « bas-bleu » n’est donc pas seulement une prétentieuse qui pérore à tout va. C’est aussi une femme qui trahit hideusement sa nature féminine. Un « homme manqué », un « hermaphrodite » qui s’échine à vouloir ressembler à son homologue masculin pour mieux le toiser. Charles Baudelaire, Georges Proudhon ou Jules Barbey d’Aurevilly se déchainent sur les affreuses métamorphoses à venir. En femme de plume célèbre, George Sand est une de leurs cibles favorites. Plus cyniques que jamais, les frères Goncourt s’en prennent aussi à elle pour attester des mutations en cours :
« Si on avait fait l’autopsie des femmes ayant un talent original, comme Mme Sand […] on trouverait chez elles des parties génitales se rapprochant de l’homme, des clitoris un peu parent de nos verges. »
Femmes studieuses, femmes dangereuses
On s’effraie des « bas-bleus » dégénérés autant que des « bas-rouges » révoltés à venir. Le lendemain du vote en première lecture de la loi sur les lycées de jeunes filles, le journal catholique L’Univers fait son miel du péril imminent que préparent les savoirs et diplômes féminins. Les « futures doctoresses et avocates », élevées « sans religion » et « bourrées de cette science-frelatée » ne seront que les répliques des violences de 1848 et 1870 :
« La haine de ces bas-rouges sera d’autant plus féroce que leurs appétits seront plus vastes ; elles voudront réformer une société où elles ne sauraient trouver place, et s’en iront, avec les Hubertine Auclert et les Louise Michel, courir les réunions publiques et réclamer les droits de la femme. »
Lors des débats parlementaires précédant le vote de la loi, le sénateur bonapartiste Georges Poriquet agite également l’épouvantail de l’émeutière communarde. « Même améliorée par la République », il ne veut pas de cette « femme savante, électeur et orateur, la Louise Michel du présent et de l’avenir ».
Dangereuses pour les autres, les femmes studieuses le seraient aussi pour elles-mêmes. Ces littératures prédisent que, désœuvrées par ces nouveaux savoirs, elles se donneront « au premier homme qui passera », « qu’elles se tueront », qu’elles « deviendront folles »…
Les hommes du XIXe siècle ont eu peur des évolutions à venir. Et ils ont fait peur à leurs contemporains pour que ces progrès ne se fassent pas. Leur refus d’un enseignement secondaire à égalité avec celui des garçons a été extrême. Il a rejeté de toutes ses forces ces changements en dramatisant leurs enjeux. Il faudra attendre le décret de Léon Bérard en 1924 pour que les filles puissent commencer à passer un baccalauréat identique à celui des garçons ; soit cent seize ans après le décret impérial du 17 mars 1808 de Napoléon 1er.
Deux siècles plus tard, les conservateurs s’offusquent de l’extrémisme des féminismes d’aujourd’hui. Ces femmes seraient une fois encore orgueilleuses, hideuses, dangereuses… Ce n’est rien de neuf sous le soleil noir des conservatismes sexistes du XXIe siècle.
J'aime la nuit. Pas la nuit blanche des noctambules, ni celle des illuminations de Noël.
Encore que la nuit bleue-diode dont les extra-terrestres ont marqué le village revêtait un charme étrange à Noël passé.
Non, la nuit que j'aime, c'est la nuit noire, la nuit profonde, la nuit vraie.
Celle des quarts en mer où l'on est seul sous les étoiles
Celle du lit tiré sur la terrasse les soirs d'été
Celle des heures passées sur le toit avec le télescope.
Aussi quand l'éclairage public a inondé mon chemin, je me suis battue bec et ongles contre cette invasion.
J'ai argué que mon cadre de vie en était tout révolutionné : à quoi bon choisir la campagne si la nature est refoulée par un progrès indésirable ?
En vain : la civilisation a donc envahi mon chemin (côté lumière, s'entend, car c'est toujours l'âge de pierre côté chaussée, égouts ou telecom)
J'ai donné mon télescope, les lumières de la ville ne sont plus un émerveillement lointain au fond de la vallée, mais une réalité proche, une promiscuité agressive, un éblouissement envahissant.

Je dois étouffer pendant les nuits d'été derrière les volets fermés. Et un supplément de dépenses personnelles pour la climatisation s'ajoute aux suppléments de dépenses mutualisées car le surcoût énergétique de l'éclairage public va peser sur les impôts communaux.
Et là je n'aborde même pas les arguments écologiques. Je vous laisse les réciter tous seuls, vous les connaissez par coeur, de la chasse au gaspi au Grenelle de l'environnement, sauvons la planète et tutti quanti.
Or doncques, j'étais là, enfermée dans la clim et dans une colère maussade, pestant comme une rebelle contre la décision imposée, mais vaguement coupable de nostalgie rétrograde. Car l'Intérêt Public, la Sécurité, le Progrès, la Civilisation, la Responsabilité du Maire sont les contr'arguments avec Majuscules que m'a renvoyés l'autorité quand j'ai tenté de discuter. Je m'en suis sentie toute écrasée, responsabilisée, culpabilisée, sur fond latent de malaise et de mécontentement.
Je ne pouvais demeurer plus longtemps sur la pente savonneuse de cette dépression larvée, j'ai pris le taureau par les cornes, je me suis remise en cause et j'ai donc cherché comment me sortir de ce marasme marécageux. Pour trouver le remède, il faut déjà un bon diagnostic, donc inventorier les symptômes et donner un NOM à cette maladie. Car j'étais sinon coupable, du moins malade. les autorités me l'avaient démontré : je refusais le progrès, j'étais ringarde, rétrograde, réactionnaire, anachronique, obsolète. Bref, je sentais la naphtaline.
Le premier symptôme, celui du nyctophile, de l'adorateur de la nuit noire, l'adepte de l'obscurité profonde, semblait au premier abord relever de la manie, de l'addiction et des comportements sectaires. J'avais empoigné mon clavier, je compulsais sur mon écran les encyclopédies médicales, je consultais tous ces experts qui foisonnent sur le net. Eh bien, il s'est avéré qu'autant la lumière compte parmi les thérapies naturelles émergentes, autant l'alternance de la lumière et de l'obscurité, synchroniseur du cycle veille/sommeil semble essentielle à la qualité du sommeil.
Soyons brièvement techniques : le cycle veille/sommeil est soumis à l'influence de synchroniseurs. l'endormissement est la conséquence de la synchronisation de plusieurs phénomènes :
- externes, comme la baisse de l'intensité lumineuse, le niveau du bruit ambiant, l'activité sociale.
- internes, comme la diminution de la température corporelle, maximale à 17 heures, minimale entre 3 et 5 heures de la nuit.
A l'inverse, le réveil est préparé par l'augmentation de la température corporelle et la sécrétion d'hormones éveillantes, comme le cortisol.
En l'absence de synchroniseur externe (lors d'expériences hors du temps, comme celle de Michel Siffre dans les gouffres ou celle des sous-mariniers.), mon horloge biologique va continuer à rythmer l'alternance veille/sommeil selon des variations circadiennes (autour de 24 heures). Mais la qualité du sommeil en sera altérée : l'alternance lumière/obscurité, la variation du niveau d'activité sociale, le niveau du bruit ambiant sont autant de phénomènes qui influent sur la qualité du sommeil. C'est ainsi que le bruit entraîne une altération subjective et objective du sommeil. La gêne subjective disparait après quelques nuits et l'architecture du sommeil se normalise progressivement. Par contre, la réponse du rythme cardiaque au bruit demeure perturbée : l'esprit s'habitue au bruit, le cœur, jamais.
Qu'en est-il pour le synchroniseur "lumière" ?
Selon le Professeur Olivier Van Reeth, "pendant des millénaires, nous nous sommes levés et couchés avec le soleil, vivant ainsi en parfaite harmonie avec notre horloge biologique. En permettant l’extension artificielle de la durée du « jour », l’avènement de l’éclairage électrique puis l’explosion des nouvelles technologies ont complètement bouleversé l’organisation temporelle de nos sociétés industrialisées. Lorsque nous profitons de l’opportunité qui nous est donnée d’être actifs la nuit (quand notre horloge nous dit de dormir) et de dormir le jour, nous nous mettons alors en conflit avec notre horloge biologique... Les études [des chronobiologistes] montrent qu’une exposition programmée à de la lumière intense sur le lieu de travail (et le maintien d’une obscurité absolue pendant le sommeil) permettent d'améliorer l’adaptation aux conditions de travail [de nuit]. De même, une exposition à une lumière intense pendant les périodes dévolues au sommeil ont un impact sur la qualité du sommeil.
J'en étais là à dériver dans les méandres de la vulgarisation médicale, sans avoir progressé d'un pouce dans la résolution de la quadrature du cercle vicieux : nuit, autorité, lampadaire, insomnie. Quand de la lecture du canard local (Var-Matin - 27 août 2008), vint la lumière, ce qui est un comble. Jugez-en plutôt : le maire de Garéoult, à une trentaine de kilomètres d'ici, vient de signer une charte intitulée : "Préservons le ciel de Garéoult" avec le président de l'Association nationale pour la protection du ciel nocturne (Anpcn) et le président de l'association Cassiopée, observatoire de Rocbaron, au village voisin. Cette charte prévoit de "limiter les effets nocifs de l'éclairage public et privé qui sera limité en intensité et en durée : les appareils extérieurs utiliseront des capuchons réflecteurs vers le bas. En aucun cas, la lumière émise ne sera dirigée vers le ciel où elle constitue une pollution pour la végétation, la faune nocturne, l'astronomie et l'aviation. A vingt-trois heures trente, les éclairages de la commune devront être éteints sauf pour raison de sécurité." Le président de l'observatoire de Rocbaron soulignait qu'ainsi l'équipe municipale de Garéoult s'était engagée dans la promotion de La Provence des Étoiles. Un programme que j'aimerais bien voir soutenu également dans mon village du Revest-les-Eaux.
Kat
Crédit photos : © Cécile Cadel
Le mot de Kat - Votre attention, s'il vous plait : c'est pas faux, ce que raconte ce long article que je viens donc de traduire., mais pensez à le mettre en perspective, sachant qu'il est publié sur et par Proton, qui fournit un service de mail très beaucoup plus sécurisé et respectueux de la vie privée. Le service Proton mail gratuit est très basique, mais devient un petit peu payant si on en veut un peu plus. C'est donc une société commerciale qui, après avoir dézingué Gmail s'en prend à son autre concurrent Outlook. J'ai pas mis les images, ce sont des copies d'écran en anglais. Pas les liens non plus. Si vous y tenez, retrouvez l'article original (en anglais) en cliquant sur le titre.
Publié le 5 janvier2024 par Edward Komenda
Avec le lancement de la nouvelle version d'Outlook pour Windows, Microsoft semble avoir transformé son application de messagerie en un outil de surveillance pour la publicité ciblée.
Tout le monde parle des campagnes de protection de la vie privée de Google et d'Apple, qui exploitent vos données en ligne pour générer des revenus publicitaires. Mais il semble maintenant qu'Outlook ne soit plus simplement un service de courrier électronique ; c'est un mécanisme de collecte de données pour les 772 partenaires externes de Microsoft et un système de diffusion de publicités pour Microsoft elle-même.
Voici comment et pourquoi Microsoft partage vos données avec 772 tierces parties.
Certains utilisateurs européens qui téléchargent le nouveau logiciel Outlook pour Windows verront apparaître une fenêtre modale contenant des informations troublantes sur la manière dont Microsoft et plusieurs centaines de tiers traitent leurs données : la fenêtre informe les utilisateurs que Microsoft et ces 772 tiers utilisent leurs données pour un certain nombre de raisons, notamment pour.. :
Stocker et/ou accéder à des informations sur l'appareil de l'utilisateur
Développer et améliorer les produits
Personnaliser les publicités et le contenu
Mesurer les publicités et le contenu
Obtenir des informations sur l'audience
Obtenir des données de géolocalisation précises
Identifier les utilisateurs grâce à l'analyse des appareilsCette dernière version d'Outlook confirme que les marges de profit des grandes entreprises technologiques dépendent de plus en plus de la collecte de vos données personnelles. Outlook vous invite également à choisir la manière dont les publicités s'affichent sur votre écran, ce qui montre clairement que la publicité est un élément clé de l'accord.
Les utilisateurs de Mac connectés à la nouvelle version d'Outlook verront même des publicités apparaître dans les messages de la boîte de réception. Certaines publicités concernent des applications Microsoft, tandis que d'autres proviennent de tiers qui vendent des produits..
Les "partenaires publicitaires" de Microsoft
Grâce au règlement général sur la protection des données de l'UE, les Européens sont au moins informés qu'un petit village de tiers pourra consulter leurs données. Les Américains, grâce au refus de leur gouvernement d'adopter une législation sur la protection de la vie privée, ne sont même pas informés de ce qui se passe.
Dans les paramètres d'Outlook, les utilisateurs britanniques peuvent explorer une "Liste des partenaires publicitaires", qui indique le nombre inquiétant de sociétés publicitaires travaillant avec Microsoft. Ces sociétés tierces - appelées partenaires - portent des noms tels que "ADMAX" et "ADSOCY". Cette liste n'est pas disponible dans les paramètres pour les utilisateurs américains et suisses.
Dans une certaine mesure, le nouvel Outlook vous permet de choisir comment vos données sont utilisées, mais ce n'est pas aussi simple que de cliquer sur un simple bouton.
"En fonction du type de données qu'ils collectent, utilisent et traitent et ainsi que d'autres facteurs, notamment la protection de la vie privée dès la conception, certains partenaires s'appuient sur votre consentement, tandis que d'autres vous demandent de vous désinscrire", peut-on lire sur la page des préférences destinée aux utilisateurs britanniques. "Cliquez sur chaque société de publicité listée ci-dessous pour consulter sa politique de confidentialité et exercer vos choix."
Tous les partenaires n'ont pas les mêmes règles. Les utilisateurs peuvent lire chaque politique de confidentialité avant de prendre une décision, mais cette lecture n'est pas obligatoire.
Ces politiques sont généralement longues, décousues et notoirement difficiles à comprendre. Mais pour de nombreuses entreprises, c'est justement l'idée. Ces politiques sont intentionnellement rédigées de cette manière afin de donner aux entreprises la plus grande liberté possible pour faire ce qu'elles veulent de vos données. Cela signifie souvent qu'elles vendent vos données personnelles à des annonceurs tiers et à des courtiers en données, tout en vous empêchant de vous y opposer.
Avec le nouvel Outlook, Microsoft oblige les utilisateurs à entrer dans un labyrinthe de déclarations de confidentialité pour reprendre le contrôle de leurs données. Bien entendu, Microsoft sait que presque personne ne lit les politiques de confidentialité. Si tout le monde comprenait ces politiques, les revenus seraient compromis
Le nouvel Outlook vole le mot de passe de votre messagerie
L'intégration par Microsoft d'Outlook dans les services en ligne a déclenché une alarme en matière de protection de la vie privée.
Lorsque vous synchronisez des comptes de messagerie tiers provenant de services tels que Yahoo ou Gmail avec le nouvel Outlook, vous risquez d'accorder à Microsoft l'accès aux identifiants IMAP et SMTP, aux courriels, aux contacts et aux événements associés à ces comptes, selon le blog informatique allemand Heise Online.
"Bien que Microsoft explique qu'il est possible de revenir à tout moment aux applications précédentes, les données seront déjà stockées par l'entreprise", rapporte M. Heise. "Cela permet à Microsoft de lire les courriels.
Il est impossible d'utiliser le nouvel Outlook sans synchroniser toutes ces informations avec Microsoft Cloud - il n'y a qu'une option d'annulation, selon le forum de développeurs XDA. Il est également configuré pour envoyer les données de connexion - y compris les noms d'utilisateur et les mots de passe - directement aux serveurs de Microsoft.
Bien que ce transfert soit sécurisé par Transport Layer Security (TLS), selon Heise Online, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe IMAP et SMTP sont transmis à Microsoft en texte clair. XDA a pu montrer ses identifiants de test pour un fournisseur de services de messagerie tiers sur les serveurs de Microsoft.
Microsoft s'autorise à accéder à votre compte de messagerie à tout moment et à votre insu, ce qui lui permet de scanner et d'analyser vos courriels - et de les partager avec des tiers.
Pour les utilisateurs qui ne sont pas conscients des implications en matière de protection de la vie privée, l'utilisation du nouvel Outlook peut sembler inoffensive. Mais cela pourrait signifier que vous accueillez Microsoft dans votre coffre-fort de données et que vous lui donnez la liberté totale d'en faire l'usage qu'il souhaite.
Le professeur Ulrich Kelber, commissaire fédéral allemand à la protection des données et à la liberté d'information, s'est dit préoccupé par les capacités de traitement des données du nouvel Outlook. Il a annoncé sur Mastodon son intention de demander un rapport au commissaire irlandais à la protection des données, qui est chargé de veiller à ce que des entreprises comme Microsoft respectent les normes en matière de protection des données et de la vie privée.
Microsoft n'a pas répondu publiquement aux critiques concernant sa dernière capture de données. Mais le géant du logiciel a été franc quant à sa volonté d'utiliser la publicité ciblée pour atteindre de nouveaux sommets en termes de revenus. En 2021, Microsoft Advertising a rapporté 10 milliards de dollars. Mais Microsoft veut doubler ce chiffre.
Quel type de données Microsoft recueille-t-il ?
Conformément à sa politique publicitaire, Microsoft n'utilise pas les données personnelles contenues dans les courriers électroniques, les chats ou les documents pour cibler les publicités. En revanche, les publicités qui s'affichent peuvent être sélectionnées en fonction d'autres données qui ont permis à l'entreprise de mieux vous connaître, telles que "vos centres d'intérêt et vos favoris, votre localisation, vos transactions, la manière dont vous utilisez nos produits, vos requêtes de recherche ou le contenu que vous visualisez".
Un examen plus approfondi de la politique de confidentialité de Microsoft montre quelles données personnelles peuvent être extraites :
Nom et coordonnées
Mots de passe
Données démographiques
Données de paiement
Données relatives aux abonnements et aux licences
Requêtes de recherche
Données relatives à l'appareil et à l'utilisation
Rapports d'erreurs et données de performance
Données vocales
Texte, encrage et données dactylographiques
Images
Données de localisation
Contenu
Retour d'information et évaluations
Données sur le traficLes termes du contrat donne un aperçu de l'endroit où vos données peuvent se retrouver:
Fournisseurs de services
Entités gérées par les utilisateurs
Prestataires de services de paiement
Tiers exécutant des services de publicité en ligne pour le compte de MicrosoftMicrosoft s'oriente vers le commerce des données
Lorsque Google a mis en place une politique de confidentialité élargissant ses pouvoirs de collecte de données, l'entreprise s'est attiré les critiques des régulateurs et de ses rivaux, notamment Microsoft, qui a publié des pages entières de publicité dans les journaux pour informer les utilisateurs de Google que l'entreprise ne respectait pas leur vie privée.
Peu de temps après, cependant, Microsoft a dévoilé une politique de confidentialité lui permettant d'utiliser des informations personnelles pour vendre de la publicité ciblée, s'engageant ainsi de manière agressive dans une voie qu'elle avait autrefois décriée.
Depuis, Microsoft a pris des mesures importantes pour générer des revenus de surveillance, suivant les traces de Google, de Facebook et, plus récemment, d'Apple. Comme d'autres grandes entreprises technologiques, Microsoft a compris qu'elle pouvait générer d'importants flux de revenus en collectant et en analysant les données des utilisateurs. Cet état d'esprit centré sur les données s'inscrit dans une tendance plus large d'entreprises établies qui se disputent une part du gâteau de la surveillance.
La nomination de Satya Nadella au poste de PDG en 2014 a marqué un tournant pour Microsoft, qui a fait l'objet d'un examen minutieux la même année après avoir admis avoir lu des courriels provenant du compte Hotmail d'un journaliste, ce qui a contraint l'entreprise à renforcer sa politique de protection de la vie privéey.
Trois mois après sa prise de fonction, M. Nadella a publié une étude d'un cabinet d'intelligence économique qui concluait que "les entreprises qui tirent parti de leurs données ont le potentiel de générer un chiffre d'affaires supplémentaire de 1,6 billion de dollars par rapport aux entreprises qui ne le font pas", écrit l'auteur Shoshana Zuboff dans son livre The Age of Surveillance Capitalism (L'ère du capitalisme de surveillance).
Les développements clés qui ont suivi comprennent le moteur de recherche Bing et l'assistant numérique Cortana, tous deux conçus pour capturer et analyser les données des utilisateurs. La sortie de Windows 10 en 2015 a encore souligné l'engagement de Microsoft dans cette nouvelle direction. Les critiques de la communauté de la protection de la vie privée n'ont pas tardé à fuser.
Windows 10 "est actuellement un marasme en matière de protection de la vie privée qui a grand besoin d'être réformé", écrit l'ingénieur logiciel David Auerbach dans Slate, décrivant comment le nouveau système d'exploitation "se donne le droit de transmettre une grande quantité de vos données aux serveurs de Microsoft, d'utiliser votre bande passante à des fins propres à Microsoft et d'établir un profil de votre utilisation de Windows".
L'orientation de Microsoft vers la publicité s'est poursuivie avec l'achat de Xandr en 2021, mais l'entreprise a ensuite décidé de capitaliser sur la base d'utilisateurs captifs créée par son jardin clos et s'est concentrée sur l'affichage de publicités de première main dans ses services.
Compte tenu de cette orientation, le nouveau format d'Outlook fait sens.
Dans une interview accordée à Business Insider en 2022, Rob Wilk, responsable de la publicité chez Microsoft, a évoqué les possibilités offertes par des propriétés telles que la Xbox, qui comprend une activité liée aux consoles ainsi qu'aux comptes de connexion - "l'un des domaines dans lesquels nous allons jouer", a-t-il déclaré.
"Imaginez un monde, pas si lointain, où toutes ces pièces sont assemblées pour proposer une offre plus claire et plus nette à nos annonceurs", a déclaré M. Wilk. "N'oublions pas que nous disposons également d'informations et de données sur la navigation dans les jeux et sur les activités de Microsoft Windows, avec des milliards d'utilisateurs, ce qui nous donne un avantage unique pour comprendre les intentions.
M. Wilk a qualifié la campagne publicitaire de Microsoft de "nouvelle religion".
La surveillance au nom du profit
Microsoft affirme que la collecte de vos données a pour but de "vous offrir des expériences riches et interactives" Pourtant, dans le domaine de la Big Tech, la publicité et les recettes publicitaires sont devenues des fins en soi, justifiant un modèle commercial fondé sur la surveillance de vos données privées au nom du profit.
En présentant le nouvel Outlook comme un service de collecte de données et de diffusion de publicités, Microsoft a montré qu'elle n'était pas différente des Google et des Meta du monde entier. Pour ces entreprises, faire de la protection de la vie privée une option par défaut signifierait perdre les revenus dont elles sont devenues dépendantes.
Et maintenant un peu de promotion pour Proton
(NDLR : ce titre et ce sous-titre sont de Kat, ce qui vient ensuite est la conclusion de l'article original, je vous avais prévenus, c'est un article de promotion de Proton Mail)
Il existe d'autres modèles commerciaux déployés par des entreprises qui se concentrent avant tout sur la sécurité et la protection de la vie privée en ligne.
Proton est l'un d'entre eux.
Passer à la vraie vie privée
Proton utilise le cryptage de bout en bout pour protéger vos courriels, votre calendrier, vos fichiers stockés dans le nuage, vos mots de passe et vos identifiants de connexion, ainsi que votre connexion internet). Notre architecture de sécurité est conçue pour que vos données restent invisibles, même pour nous, car notre modèle d'entreprise vous offre plus de confidentialité, pas moins.
Proton fournit une technologie gratuite et open-source pour étendre l'accès à la vie privée, à la sécurité et à la liberté en ligne. Mais vous pouvez toujours passer à des plans payants pour accéder à des fonctionnalités supplémentaires, ce qui vous permet de payer avec de l'argent plutôt qu'avec des données sensibles.
Proton facilite le passage à sa plateforme. En quelques étapes simples, vous pouvez migrer vers un service de messagerie en lequel vous pouvez avoir confiance.
Nous croyons en la construction d'un internet qui fonctionne pour les gens et pas seulement pour le profit. La violation de la vie privée à laquelle se livrent régulièrement des entreprises comme Microsoft et Google au nom de leur chiffre d'affaires n'est qu'un obstacle de plus à l'avènement d'un meilleur internet, où la protection de la vie privée serait la règle par défaut.
Dans L'Autre Bataille de Poitiers, l'historien et archéologue Philippe Sénac rappelle quant à lui la différence entre mythe et réalité à travers deux éléments centraux. D'abord, il explique que l'occupation de la Gaule méridionale par les musulmans au VIIIe siècle est beaucoup plus limitée que ce que laisse penser la légende construite a posteriori; ensuite, que la prétendue bataille de Poitiers (732 ou 733) est en fait une simple escarmouche sur le plan militaire. Si, par la suite, l'événement est devenu un haut fait d'armes, c'est notamment au cours de la reconstruction de l'histoire sous la monarchie de Juillet (1830-1848), puis sous la Troisième République (1870-1940).
En fait, cette bataille est venue marquer la fin des conquêtes arabes, qui s'étaient déjà soldées par une série de défaites plus importantes comme celle de Toulouse en 721 ou de Covadonga (Espagne) l'année suivante. Poitiers marque surtout les débuts des succès des Francs et de leur expansion en Europe.
Le récit de l'épisode a été modifié au fil des siècles. En reprenant plusieurs sources, Philippe Sénac souligne que si l'Espagne a bel et bien été occupée, la Narbonnaise (le Gard et l'Aude principalement) a été soumise et est devenue une wilaya dans laquelle les conquérants ont laissé une autonomie interne à l'ancienne province. Elle a servi de point d'appui pour les offensives vers le Nord, qui sont principalement remontées vers la région lyonnaise, alors que l'attaque en direction de Poitiers est venue directement de l'Espagne en passant par Bordeaux.
En outre, cette bataille ne marque pas la fin des tentatives de conquête: ce sont les victoires de Pépin le Bref (714-768) jusqu'en 768 qui stabilisent la région. Et encore, puisque jusqu'au XIe siècle, des raids ont à nouveau eu lieu. La reconstruction mémorielle a directement influencé cette réécriture partielle de l'histoire.
L'Autre Bataille de Poitiers – Quand la Narbonnaise était arabe (VIIIe siècle) par Philippe Sénac chez Armand Colin paru le 18 octobre 2023
Mise en garde : Ce message concerne des vœux.
Si vos croyances ou vos pratiques substitutives vous interdisent d'en recevoir, cessez immédiatement la lecture de ce message.
Le téléchargement de ces vœux est conforme :
- à la Loi n°2009-669 du 12 juin 2009 (et suivantes) favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, autrement appelée loi Hadopi ou loi Création et Internet,
- à la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure autrement appelée Loppsi 2.
-
à la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.
- à la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, version consolidée au 29 décembre 2015.
Il est garanti sans spoiler de Black Mirror ni The Marvelous Mrs. Maisel YOU, The Queen's Gambit.
Cependant, avant de poursuivre, assurez vous qu'il soit conforme aux lois de votre pays si vous lisez ce message via une connexion ne fonctionnant pas avec une adresse IP française, particulièrement si vous utilisez un VPN.
Conditions d'acceptation : En acceptant mes vœux, vous acceptez les termes suivants et ne serez pas autorisés à en réclamer la reprise ou l'échange :
-Ces vœux, personnels et partageables, peuvent être renouvelés à tout moment, à mon initiative ou la vôtre, quelle qu'en soit la raison, ou même sans raison aucune.
-Bien que ces vœux soient sincères, ils ne comportent aucun engagement quant à leur efficacité réelle. Il n'est donc pas recevable d'en exiger une garantie. Si vous en partagez le sens et le contenu, il est vivement recommandé de mettre un peu du vôtre pour leur accomplissement.
-Quoi qu'il arrive, je ne pourrai être tenue responsable pour tout événement (ou absence d'événement, notamment en cas de survenue ou de non survenue de fin du monde avant le terme échu de l'année en cours.) qui ne serait pas conforme aux souhaits suivants.
Dans le contexte de l'émergence d'une nouvelle année - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 sans que cette acceptation puisse être vue comme un manque de respect pour le calendrier de votre religion ou de toute autre calendrier de substitution, veuillez accepter, sans aucune obligation, mes meilleurs vœux pour une bonne santé, votre accomplissement personnel et votre succès professionnel, dans le respect des coutumes et des traditions de votre choix - ou de vos pratiques substitutives, dans le respect des pratiques et des traditions ou des pratiques substitutives des autres, ou même l'absence de traditions ou pratiques des deux côtés.
Ces vœux concernent également un environnement plus sain, plus de solidarité, et une plus longue et heureuse vie.
Ces vœux sont adressés sans distinction de race, de religion (ou son absence), d'âge, de nationalité, de sexe, de couleur (de peau ou politique), d'orientation sexuelle, de physique ou de choix musicaux (que vous appréciez ou non Benjamin Biolay Zaz le Gangnam Style de Psy les Daft Punk David Guetta, Adèle, Jul, Despacito, MadameMonsieur Meercy, Big Flow et Oli, Gims, Clara Luciani), pour une période d'un an, ou l'avènement d'une autre période de vœux, au plus tôt des deux.
Veuillez également recevoir, si cela vous est autorisé, le nombre de baisers de nouvel an approprié - sous le gui ou sans gui, en fonction de votre région, de vos pratiques, rites, traditions et coutumes ou absence de règles en la matière, sans pour autant que cela puisse être considéré comme une marque d'irrespect ou une incitation perverse de quelque nature que ce soit.
Somehow, Bonne Moins pire Belle Pas trop mauvaise pas pire moins terrible année que 2021 à toutes et tous !
Note : Toutes les références à 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 ont été remplacées par l'année 2022 et seront remplacées par 2023 après une période de 12 mois courant à partir de ce jour.
Merci de votre participation à cette politique de recyclage.
Dans quelle mesure les différentes générations sont-elles plus ou moins sensibles à la notion de surveillance ? Un regard sur les personnes nées au tournant des années 80 et 90 montre que ces dernières abandonnent probablement plus facilement une part de contrôle sur les données personnelles et n’ont sans doute pas eu totalement conscience de leur grande valeur.
Peut-être qu’à l’approche des Jeux olympiques de Paris, avez-vous vaguement protesté lors de la mise en place d’un fichier vidéo algorithmique ? Et puis avez-vous haussé les épaules : un fichier de plus. Peut-être par résignation ou par habitude ? Comme d’autres, vous avez peut-être aussi renseigné sans trop vous poser de questions votre profil MySpace ou donné votre « ASV » (âge, sexe, ville) sur les chats Caramail au tournant des années 1990-2000 et encore aujourd’hui vous cliquez quotidiennement sur « valider les CGU » (conditions générales d'utilisation) sans les lire ou sur « accepter les cookies » sans savoir précisément ce que c’est.
En effet, peut-être, faites-vous partie de ce nombre important d’individus nés entre 1979 et 1994 et avez-vous saisi au vol le développement de l’informatique et des nouvelles technologies. Et ce, sans forcément vous attarder sur ce que cela impliquait sur le plan de la surveillance des données que vous avez accepté de partager avec le reste du monde…
World Wide Web
Pour se convaincre de l’existence de cette habitude rapidement acquise, il suffit d’avoir en tête les grandes dates de l’histoire récente de l’informatique et d’Internet : Apple met en 1983 sur le marché le premier ordinateur utilisant une souris et une interface graphique, c’est le Lisa.
Puis le World Wide Web est inventé par Tim Berners-Lee en 1989, 36 millions d’ordinateurs sont connectés à Internet en 1996, Google est fondé en 1998 et Facebook est lancé en 2004. L’accélération exponentielle d’abord des machines elles-mêmes, puis des réseaux et enfin du partage de données et de la mobilité a suivi de très près les millennials.
La génération précédente, plus âgée, a parfois moins l’habitude de ces outils ou s’est battue contre certaines dérives initiales, notamment sécuritaires. La suivante, qui a été plongée immédiatement dans un monde déjà régi par l’omniprésence d’Internet et des réseaux, en connaît plus spontanément les risques (même si elle n’est pas nécessairement plus prudente).
Un certain optimisme face à l’informatique
Probablement du fait de ce contexte, la génération née entre le début des années 1980 et le milieu des années 1990 est aussi celle qui est la plus optimiste face au développement des technologies.
Cet état de fait apparaît d’autant plus clairement que la « génération Z », plus jeune, est marquée généralement par une plus grande apathie voire un certain pessimisme notamment quant au devenir des données personnelles.
En effet, aujourd’hui, les plus jeunes, déjà très habitués à l’usage permanent des réseaux sociaux et aux surveillances de toute part, se trouvent très conscients de ses enjeux mais font montre d’une forme de résignation. Celle-ci se traduit notamment par le « privacy paradox » mis en lumière par certains sociologues et qui se traduit par une tendance paradoxale à se réclamer d’une défense de la vie privée tout en exposant très largement celle-ci volontairement par l’utilisation des réseaux sociaux.
A contrario, cette confiance en la technologie se manifeste spécialement par une forme de techno-optimisme, y compris lorsqu’il s’agit de l’usage de données personnelles. Cet état d’esprit se traduit dans de nombreux domaines : lorsqu’il s’agit de l’usage des données de santé par exemple ou plus généralement quant à l’utilisation des technologies pour régler des problèmes sociaux ou humains comme le réchauffement climatique.
La priorisation de valeurs différentes
Cet optimisme est aussi visible lorsqu’il s’agit d’évoquer les fichiers policiers ou administratifs. S’il n’existe pas de données précises sur l’acceptation des bases de données sécuritaires par chaque tranche d’âge, il n’en demeure pas moins que la génération des 30-45 ans n’est plus celle de l’affaire Safari dont l’éclatement, après la révélation d’un projet de méga-fichier par le ministère de l’Intérieur, a permis la naissance de la CNIL.
Cette génération a, au contraire, été marquée par des événements clés tels que les attentats du 11 septembre 2001 ou la crise économique de 2009.
Ces événements, et plus généralement le climat dans lequel cette génération a grandi et vit aujourd’hui, la conduisent à être, d’après les études d’opinion récentes, plus sensible aux questions de sécurité que d’autres. Elle entretient ainsi un rapport différent à la sécurité, moins encline à subir des contrôles d’identité répétés (qui sont bien plus fréquents chez les plus jeunes) mais plus inquiète pour l’avenir et plus sensible aux arguments sécuritaires.
Cet état d’esprit favorise en conséquence une plus grande acceptation encore des fichiers et aux dispositifs de sécurité qui sont perçus comme des outils nécessaires à l’adaptation aux nouvelles formes de délinquance et de criminalité, par exemple à l’occasion de l’organisation des futurs Jeux olympiques et paralympiques en France ou rendus utiles pour permettre la gestion d’une pandémie comme celle du Covid-19.
De l’acceptation à l’accoutumance
Les deux phénomènes – optimisme face au développement des technologies et sensibilité à la question sécuritaire – sont d’autant plus inextricables qu’il existe un lien important entre usages individuels et commerciaux des technologies d’une part et usages technosécuritaires d’autre part. En effet, les expériences en apparence inoffensives de l’utilisation récréative ou domestique des technologies de surveillance (caméras de surveillance, objets connectés, etc.) favorisent l’acceptabilité voire l’accoutumance à ces outils qui renforcent le sentiment de confort tant personnel que sécuritaire.
La génération des trentenaires et quadra actuelle, très habituée au développement des technologies dans tous les cadres (individuels, familiaux, professionnels, collectifs, etc.) et encore très empreinte du techno-optimisme de l’explosion des possibilités offertes par ces outils depuis les années 1990 est ainsi plus encline encore que d’autres à accepter leur présence dans un contexte de surveillance de masse.
Cet état d’esprit favorise en conséquence une plus grande acceptation encore des fichiers et aux dispositifs de sécurité qui sont perçus comme des outils nécessaires à l’adaptation aux nouvelles formes de délinquance et de criminalité. Maxim Hopman/Unsplash, CC BY-NC-ND
La pénétration très importante de ces dispositifs dans notre quotidien est telle que le recours aux technologies même les plus débattues comme l’intelligence artificielle peut sembler à certains comme le cours normal du progrès technique. Comme pour toutes les autres générations, l’habituation est d’autant plus importante que l’effet cliquet conduit à ne jamais – ou presque – remettre en cause des dispositifs adoptés.
L’existence de facteurs explicatifs
Partant, la génération des 30-45 ans, sans doute bien davantage que celle qui la précède (encore marquée par certains excès ou trop peu familiarisée à ces questions) que celle qui la suit (davantage pessimiste) développe une forte acceptabilité des dispositifs de surveillance de tous horizons. En cela, elle abandonne aussi probablement une part de contrôle sur les données personnelles dont beaucoup n’ont sans doute pas totalement conscience de la grande valeur.
Au contraire, les réglementations (à l’image du Règlement général sur la protection des données adopté en 2016 et appliqué en 2018) tentant de limiter ces phénomènes sont parfois perçues comme une source d’agacement au quotidien voire comme un frein à l’innovation.
Sur le plan sécuritaire, l’acceptabilité de ces fichages, perçus comme nécessaires pour assurer la sécurité et la gestion efficace de la société, pose la question de la confiance accordée aux institutions. Or, là encore, il semble que la génération étudiée soit moins à même de présenter une défiance importante envers la sphère politique comme le fait la plus jeune génération.
Demeurent très probablement encore d’autres facteurs explicatifs qu’il reste à explorer au regard d’une génération dont l’état d’esprit relativement aux données personnelles est d’autant plus essentiel que cette génération est en partie celle qui construit le droit applicable aujourd’hui et demain en ces matières.
Comme chaque année, des millions de Français profitent du Black Friday pour faire de supers affaires. Lucie V., elle, a fait l’affaire du siècle. Rencontre.
Publié le 24 Nov 2023 à 10h00 Par La Rédaction
Black Friday, c’est une tradition venue tout droit des Etats-Unis pour faire de supers affaires et contribuer à développer notre société consumériste. Comme chaque année donc, c’est l’occasion de faire des “good deals” comme a pu le faire Lucie V., étudiante, qui nous explique :
“Comme chaque année, je me suis connectée au site amazon et sans surprise y avait de supers deals. J’ai donc sélectionné un aspirateur avec fil à -60% au cas où mon aspirateur sans fil tombe en panne. J’ai aussi pris un tapis de yoga à -20% pour le jour où je me motive à faire du yoga, et des jeux vidéos à – 50%. Bon j’ai pas encore la console, mais peut-être l’année prochaine”.
Une fois son panier plein de bonnes affaires et de grosses ristournes, l’étudiante s’apprêtait à payer quand soudain elle a découvert un bouton qu’elle n’avait jamais vu auparavant. “J’ai vu un petit logo amusant et j’ai cliqué dessus. Tout d’un coup mon panier s’est vidé et le montant de mes achats est passé à 0€, j’ai ha-llu-ci-né. Meilleur deal !”.
La flemme de recréer un nouveau panier et de faire de nouvelles emplettes l’a emporté et Lucie n’a finalement rien acheté lors du Black Friday. Aujourd’hui, elle donne des formations de suppression de panier à d’autres acheteurs compulsifs.
Sous l’ancien régime les morts étaient enterrés dans le sol des églises. Comment cela se passait-il ? Avez-vous les références d’un livre sur cette question ?
Depuis le Moyen âge, dans un contexte d’ignorance et de superstition, l’âme d’un corps placé dans l’église était supposée aller plus vite et plus prés de dieu au paradis ; ceci moyennant finance, les places les plus proches du chœur étant les plus chères ; les familles achetaient un caveau à tel emplacement ; leurs enfants et descendants, dans leur testament, “élisaient leur sépulture dans telle tombe où sont enterrés leurs prédécesseurs”, parfois en précisant l’emplacement à l’intérieur de l’église par exemple “à côté de la chapelle Ste Catherine” (trouvé dans un testament).
Les corps étaient enterrés sous les dalles du pavement de l’église, dalles soulevées à l’occasion d’un enterrement ; les familles aisées pouvaient faire construire une chapelle sur les côtés de l’église, à l’intérieur d’une église, chapelle dédiée à un saint protecteur, et où étaient ensevelis les membres de la famille ; l’ornement de ces chapelles reflétait la gloire et la richesse des familles.
Un édit de 1776 interdit les inhumations dans les églises pour des raisons de salubrité, mais cet édit n’est pas totalement respecté ; depuis 1950 seuls les archevêques ont eu le droit d’être enterrés dans une église ou cathédrale, par exemple la Cathédrale Saint Sauveur d’Aix en Provence.
Au Moyen âge et sous l’Ancien régime, avec l’évolution de la population et des villes, se développent les cimetières, à la fois lieu béni et sacré, mais aussi lieux de marché ou pâturage pour le petit bétail. Un édit de 1695 fait obligation aux habitants de clôturer le cimetière paroissial. En 1715, la plupart des cimetières de campagne étaient clôturés. D’abord situés dans les villes, à partir de 1730, les cimetières sont transférés à la périphérie des villes pour raison d’infection. Cette coutume n’est définitivement adoptée qu’à partir des années 1780.
Certains actes de sépulture mentionnent l’endroit exact où le corps a été inhumé dans l’église. Il peut s’agir d’une localisation géographique : à main droite en entrant dans l’église ou d’une localisation familiale. Ainsi le jeune Noël Marie est enterré dans l’église, à côté de ses frères, sous le banc de son père… En 1776, une ordonnance de Louis XVI interdit, pour des raisons sanitaires d’ensevelir dans les églises.
Vous pouvez retrouver une description des “pompes funèbres” dans le livre de Gabriel Audisio, des Paysans XVe-XIXe siècles chez Armand Colin.
Pour le SYGENE,
Chantal Cosnay, généalogiste professionnelle à Aix en Provence (13)
& Christine Lescène, généalogiste professionnelle à Blois (41)
Les arbres remarquables sont des survivants. Ils ont échappé aux flammes, aux guerres et aux ravages du temps. Ils ont sauvé leur vénérable ramure de l'urbanisation galopante et des grandes réformes agricoles. En Bretagne, avec une centaine de ces monuments naturels par département, leur densité est beaucoup plus importante que dans toutes les autres régions françaises. Pourquoi ? Parce que, contrairement à ce que l'on pense, c'est quand ils s'enracinent dans le patrimoine des hommes, parfois loin des bois, que les arbres sauvent leurs feuilles d'un hiver définitif.
2.000 arbres signalés
Leurs noeuds incongrus et leurs branches tordues racontent notre histoire. Mais encore faut-il dénicher ces ouvrages muets. C'est le travail patient qu'a mené Mickaël Jézégou. Ce technicien forestier au conseil départemental des Côtes-d'Armor arrive au terme d'un recensement minutieux, entamé en 2008. Avec lui, des associations, mais aussi des particuliers, mobilisés pour signaler quelque 2.000 candidats potentiels. « Cet inventaire régional est le fruit d'un travail participatif, avec des centaines de bénévoles ». Mickaël Jézégou, de son côté, coordonne et écrit le plus gros d'un beau livre qui sortira en septembre prochain, sur la base de cette collecte passionnée.
Ce que les arbres disent de nous
« Il n'y a pas de statut juridique pour ces arbres. Nous avons retenu ceux, qui, par leur sacralité, leur essence, leur esthétique, présentaient un caractère remarquable ». L'âge, évidemment, est essentiel. Mais surtout « leur sens, dans une histoire locale, régionale ou nationale, ce qu'ils disent de nous ». « L'arbre a longtemps été au coeur du hameau, c'était un bien en commun », analyse Mickaël Jézégou. Peu importe que l'essence soit noble. Il suffit que, sous son ombre, se soient accumulés quelques siècles de palabres. À Plumaugat (22), une vieille carte postale désigne ainsi un « arbre aux commères ». Avec le banc qui va bien dessous.
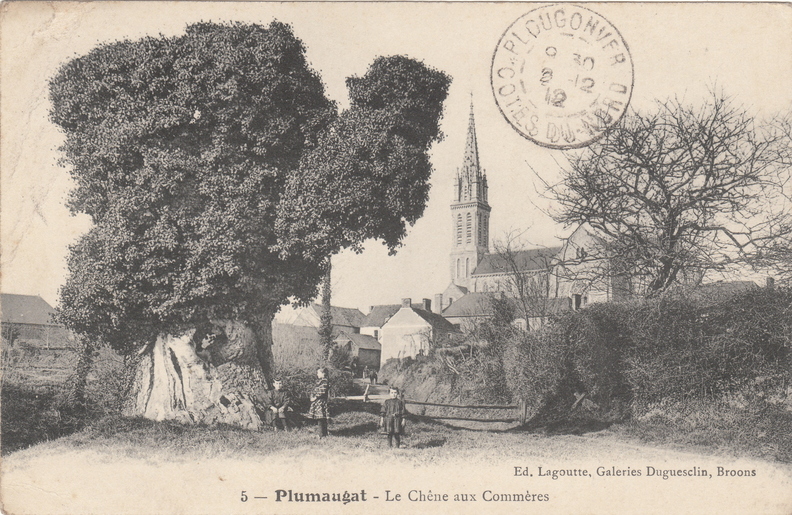 L'arbre aux commères de Plugaumat
L'arbre aux commères de Plugaumat
Dans les cimetières, les ifs millénaires gardent les morts. La Bretagne est parsemée d'ancêtres guérisseurs : à Camors, on vient encore déposer les petits chaussons des enfants près du vieux chêne, pour qu'ils marchent bien. À Langourla (22), les dames viennent confier leurs problèmes de fertilité à un centenaire.
Il n'en reste qu'un
Et puis « Tous ces arbres sont des témoins de l'Histoire ». Des 60.000 arbres plantés en France à la Révolution, il n'en reste qu'un seul, dans la plus petite commune du Finistère, à Locquénolé. « Tous les autres ont été arasés lors de la Restauration ». Dans les Côtes-d'Armor, à Trébry, en 1982, un vétéran américain est revenu voir l'arbre qui l'avait caché, des journées durant, des soldats allemands. Les arbres racontent aussi la mer et les grands voyages. « Il y a beaucoup plus d'espèces exotiques très anciennes, détaille Mickaël Jézégou. Par exemple les araucarias. Les premiers ont été introduits par l'amiral de Kersauson, à Brest ». À Bulat-Pestivien (22), se trouve un des chênes les plus colossaux d'Europe. Entre 900 et 1.200 ans au compteur. Les Égyptiens ont les pyramides : les Bretons, eux, n'ont jamais scié les vieilles branches sur lesquelles leur histoire est assise.
Vous avez aimé les Rectifications orthographiques de 1990 ? Vous allez adorer celles de 2030 ! C’est bien connu : quand une mayonnaise ne prend pas, on y ajoute quelques gouttes de vinaigre et on ressort le fouet.
Vous pensez vous aussi que mieux vaudrait la jeter ? ne pas singer l’entêtement de ces docteurs des sciences de l’éducation qui, à force de fuites en avant, ont plongé notre école dans le désarroi ? Ce serait compter sans nos linguistes, lesquels, dans une récente tribune hébergée par Le Monde, entendent bien ne rien changer à une formule qui perd, préférant rejeter la responsabilité de l’échec sur éditeurs et médias de la presse écrite.
Repoussé sine die, l’engagement de s’en remettre à l’usage ! Celui-ci n’avait été invoqué que pour fléchir une Académie réticente. Reniée, la promesse inaugurale de « laisser du temps au temps » ! Quand ledit temps vous désavoue, il n’est plus temps de l’écouter. Retoqué, le « toilettage » qui n’osait s’appeler réforme ! On piaffe à présent aux seules idées d’en découdre avec l’accord du participe passé et de « republier nos classiques », entendez par là – fi des euphémismes ! – les récrire.
Et ne nous avisons pas, manants de l’expression, sans-dents de l’écriture, ratés de l’évolution linguistique que nous sommes, d’émettre la moindre objection : elle serait aussitôt, et non sans morgue, jugée « folklorique » par ces juges suprêmes qu’a au contraire touchés la grâce. Nous ne voudrions pour rien au monde les « atterrer » davantage ! Remercions plutôt ces héros du quotidien d’avoir le « courage » d’agir, de pourfendre cet obscurantisme qui, à les en croire, étouffe notre langue depuis des lustres.
Il est pourtant à craindre que, pour nombre d’entre nous, ce courage-là consiste surtout… à n’en plus exiger des « apprenants » à venir. Encore si cette démission pure et simple pouvait influer sur les performances d’iceux aux classements PISA ! Le hic, c’est qu’elles sont tout aussi calamiteuses, sinon plus, en… mathématiques. En sera-t-on bientôt réduit à dénoncer également l’illogisme et les incohérences de ces dernières ?
Mais voilà qu’à notre tour nous donnons dans le folklore au lieu de nous incliner devant tant de science et de dévouement. Hâtons-nous au contraire de déconstruire notre langue comme le reste : il eût été étonnant qu’elle fût la seule à résister à cette frénésie ambiante qui nous porte à brûler ce que nous avons adoré…
Bruno Dewaele
Les passionnés de l'association Généa 50 de Fermanville (Manche) ont retrouvé un album de photos historiques, couvrant la période de 1896 à 1906, exposé en cette fin 2023.
 L’exposition de photos inédites de Fermanville et de communes voisine est à découvrir dans les locaux de l’ancien office de tourisme.
L’exposition de photos inédites de Fermanville et de communes voisine est à découvrir dans les locaux de l’ancien office de tourisme.
(©Nathalie BONNEMAINS)
Un album de photos historiques vient d’être exhumé par les passionnés de l’association Généa 50 de Fermanville (Manche). Il est actuellement visible dans le cadre d’une exposition organisée dans les locaux de l’ancien office de tourisme situé sur la place Marie-Ravenel.
Pour les passionnés de Généa 50, qui s’attachent à transmettre le passé au travers de recherches incessantes et d’un travail de fourmi à partir d’archives locales, c’est un véritable bonheur que de mettre la main sur des photos ou des documents historiques qui mettent en lumière le passé.
Cette exposition fait suite à la découverte d’un ancien album, riche de vieilles photos de Fermanville et de communes voisines. Cet album appartenait au petit-neveu de l’abbé Boudet, ancien vicaire de Saint-Vaast-la-Hougue, devenu par la suite curé de Carneville jusqu’en 1903. Nous avons eu l’autorisation de les présenter et d’en vendre des reproductions de grande qualité.
Le grand intérêt de ces photos repose sur le fait qu’elles couvrent la période de 1896 à 1906 et qu’elles sont ainsi antérieures à celles du fond Legoubey. Les communes de Fermanville et de Carneville y sont majoritairement représentées, ainsi que celles de Gonneville-Le Theil, de Maupertus-sur-Mer et de Saint-Pierre-Église
Une revue à découvrir
« Ces clichés sont saisissants et plongent les visiteurs dans un passé en même temps si proche et si lointain. Ils donnent lieu à des rencontres et des échanges riches qui nous permettent de nous immerger encore un peu plus dans le passé de nos aînés », souligne Pascal Levieux.
Cette exposition est également l’occasion de découvrir et d’acquérir la revue n° 7 des cahiers de Généa 50 qui vient d’être publiée et qui évoque entre autres la toponymie dans le Val de Saire.
De notre correspondante Nathalie BONNEMAINS-GEISMAR
Exposition de photos anciennes inédites de Fermanville et ses environs, local de l’ancien Office de tourisme, place Marie Ravenel, le mercredi de 14 h à 17 h et le samedi de 10 à 12 h et de 14 h à 17 h, jusqu’à la fin de l’année.
Dans une vidéo virale, un universitaire nationaliste chinois a mis en doute l’existence d’Aristote. Si ses arguments sont jugés fallacieux, leur écho témoigne de la volonté de certains intellectuels de contester l’histoire de l’Occident et les fondements de sa civilisation, explique à Hong Kong le “South China Morning Post”.
“Aristote a-t-il réellement existé ? Cette question provocatrice, sujet d’une vidéo virale de l’universitaire nationaliste chinois Jin Canrong, a lancé une nouvelle bataille dans la guerre des récits entre la Chine et l’Occident”, raconte le South China Morning Post.
“Jin n’est pas un historien”, précise d’emblée le quotidien de Hong Kong, mais un politologue, un conseiller de Pékin et un influenceur sur Douyin, version chinoise de TikTok, où il a publié sa vidéo devenue virale en octobre. Il y affirme “qu’il n’y a aucune trace attestant l’existence d’Aristote avant le XIIIe siècle et que le philosophe antique […] n’aurait pas pu écrire des centaines de livres, contenant des millions de mots, avant l’arrivée du papier en Europe au XIe siècle”.
Lire aussi : La pilule philosophique. Les vieux ont-ils à se soucier des générations futures ?
Des arguments que les historiens dénoncent comme “superficiels et fallacieux”, précise le journal, qui les déconstruit ensuite méthodiquement.
“Reste que ces affirmations reflètent une tendance de plus en plus forte parmi certains intellectuels nationalistes, pour qui le monde a besoin d’une version nouvelle et moins occidentalo-centrée de l’histoire”, poursuit le titre hongkongais.
La “pseudo-histoire” des civilisations de l’Antiquité
La Grèce antique, “considérée comme le berceau de la démocratie et de la civilisation occidentale moderne”, est une cible privilégiée, alors que les dirigeants chinois mettent en avant l’ancienneté de leur propre civilisation, “la seule au monde à ne pas avoir connu d’interruption”, déclarait en juin dernier Xi Jinping, cité par le South China Morning Post.
“Depuis une décennie au moins, la Grèce, Rome et l’Égypte antiques sont visées par des universitaires nationalistes en Chine”, rappelle le journal. En 2013, “He Xin, ancien chercheur de l’Académie chinoise des sciences sociales, a publié son livre Recherches sur la pseudo-histoire de la Grèce. Il y affirme que plusieurs classiques de la littérature grecque, comme les épopées d’Homère, sont l’œuvre de faussaires de la Renaissance. Comme Jin, il suggère aussi qu’Aristote n’a jamais existé.”
La vidéo de Jin Canrong a suscité “une avalanche de débats publics sur la fiabilité de l’histoire occidentale”, selon le South China Morning Post, qui conclut en citant une réponse révélatrice d’un internaute sur le réseau social Weibo. “Que ces opinions soient justes ou non, c’est secondaire : l’essentiel, c’est que nous osons mettre en doute les origines de la civilisation occidentale.”

