La revue de web de Kat
Ce 10 décembre marque le 74e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée en 1948 lors de l’Assemblée générale des Nations unies tenue à Paris (50 votes pour, 8 abstentions). Pour Salvatore Saguès, spécialiste des droits de l’homme à l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), ancien chercheur d’Amnesty International, cette déclaration a eu des effets considérables, mais elle ne pourrait probablement pas être adoptée comme telle aujourd'hui. Entretien.
Première publication le 06/12/2018
RFI : D’abord, quels sont les pays qui, à l’heure actuelle, n’ont pas encore adopté ou ratifié la Déclaration universelle des droits de l’homme ? D’ailleurs, est-ce qu’on l’adopte ou est-ce qu’on la ratifie la Déclaration universelle des droits de l’homme ?
Salvatore Saguès : Ni l’un ni l’autre, car cette déclaration n’a pas de valeur contraignante puisque, comme son nom l’indique, c’est une déclaration. Personne ne l’adopte ou personne ne la ratifie, contrairement aux instruments comme les conventions ou comme les pactes. Mais les principes de cette déclaration ont été repris dans de très nombreux instruments internationaux qui, eux, ont été ratifiés à la fois à l’échelle universelle et régionale. Donc, on peut dire qu’il y a quand même un consensus général sur les principes. La déclaration a une valeur déclarative, mais n’est pas soumise à ratification ni à adhésion.
C’est donc plutôt une source d’inspiration et un modèle…
Exactement. C’est une source d’inspiration qui a directement mené à l’adoption, en 1966, des deux grands pactes relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels qui, eux, ont été pour la première fois des instruments contraignants qui ont posé des normes dans ces domaines, qui font obligation aux États de les respecter.
Mais contraignants jusqu’à quel point ?
C’est tout le problème du droit international. Ces deux pactes, comme d’autres instruments – comme la Convention contre la torture, la Convention contre les disparitions forcées – mettent en place un comité. Et donc, les États doivent régulièrement envoyer des rapports pour préciser la nature de leur respect de ces droits de l’homme. Et, pour certains de ces comités, il y a la possibilité que des individus déposent plainte contre l’État. Mais évidemment, ce n’est contraignant que dans la mesure où l’État accepte de s’y plier, bien sûr. D’où le rôle des ONG [Organisations non gouvernementales, NDLR], des journalistes, des militants qui font pression avec également le poids de l’opinion publique pour que ces droits soient respectés. C’est toujours un rapport de force entre d’une part le droit qui impose, d’autre part les États qui, parfois et souvent, rechignent et enfin les ONG de défense des droits humains, ou de simples citoyens, qui militent pour faire pencher la balance du bon côté.
Si l’on remonte dans le temps, est-ce que l’on peut cibler les principaux textes et documents dont s’est inspirée cette déclaration ? On parle, par exemple, du cylindre de Cyrus, qui date du VIe siècle avant Jésus-Christ, comme de la plus ancienne déclaration des droits de l’homme. Est-ce exact ?
Oui tout à fait. Il est considéré comme le premier texte de cette nature. Il a été salué comme la première charte des droits de l'homme et l'ONU en a publié une traduction dans toutes les langues onusiennes en 1971. Mais je ne suis pas un spécialiste de cette époque précise. [Découvert en 1879 à Babylone, site qui se trouve dans l'Irak actuel, ce cylindre en argile en forme de tonneau décrit, en écriture cunéiforme, un certain nombre de thèmes évoqués par Cyrus le Grand, l'empereur de Perse, comme la liberté de culte, l'abolition de l'esclavage et la liberté de choix de profession, NDLR]
Un artéfact babylonien, parfois décrit comme la première charte des droits de l'homme au monde, sera exposé en Iran après que le gouvernement a menacé de couper les liens avec le British Museum si celui-ci ne prêtait pas l'objet. Le cylindre de Cyrus est un objet en argile datant du VIe siècle avant J.-C., sur lequel est inscrit en cunéiforme le récit de la conquête de Babylone par le roi perse Cyrus le Grand. Il est arrivé en Iran le 10 septembre et sera exposé au Musée national d'Iran pendant quatre mois, rapporte alors la télévision d'État.
Le cylindre de Cyrus, exposé au Musée national d'Iran, à Téhéran, le dimanche 12 septembre 2010. Un artéfact babylonien, parfois décrit comme la première charte des droits de l'homme au monde, sera exposé en Iran après que le gouvernement a menacé de couper les liens avec le British Museum si celui-ci ne prêtait pas l'objet. Le cylindre de Cyrus est un objet en argile datant du VIe siècle avant J.-C., sur lequel est inscrit en cunéiforme le récit de la conquête de Babylone par le roi perse Cyrus le Grand. Il est arrivé en Iran le 10 septembre et sera exposé au Musée national d'Iran pendant quatre mois, rapporte alors la télévision d'État. AP - Vahid Salemi
Ensuite, en remontant le temps jusqu’à la Grèce et la Rome antique, est-ce que l’on peut trouver des textes et des hommes qui se sont saisis de cette idée des droits de l’homme ?
Bien sûr. La Grèce d’abord, qui a inventé la démocratie, tout en gardant à l’esprit que cette démocratie ne concernait que les hommes et pas les femmes. Et uniquement les citoyens libres, pas les métèques [étrangers résidant à Athènes sans avoir les droits d’un citoyen dans le sens premier du terme, NDLR] ou les esclaves. Les Romains aussi ont adopté des droits, mais seulement pour eux. Et c’est d’ailleurs pourquoi la déclaration de 1948 est si importante parce que, pour la première fois, c’est au niveau universel ! Mais tout au long de ces 2 000 ans effectivement, il y a eu des dispositions qui ont visé à assurer les droits de certaines catégories de la population et, évidemment, des individus qui étaient au pouvoir, à savoir en Occident, les hommes blancs et libres. Cela a exclu les esclaves durant des millénaires et les femmes jusqu’au début du XXe siècle. Mais il y a eu, en effet, des règles qui, peu à peu, ont été adoptées.
La première Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, c’est celle signée le 26 août 1789 à Paris par l’Assemblée constituante. Mais elle-même, où a-t-elle trouvé son inspiration ?
L’une des principales inspirations, c’est Jean-Jacques Rousseau qui, l’un des premiers, a dit que la souveraineté de l’État repose sur le peuple, sur la nation et non sur les aristocrates ni sur une monarchie de droit divin qui, parce qu’elle se prétend choisie par Dieu, peut décider pour elle seule du bien de la nation. La déclaration de 1789 découle des Lumières et du fait que l’autorité ne découle plus de Dieu ni de son représentant sur terre, le roi, mais qu’elle est l’émanation de la volonté générale.
La Constitution américaine de 1787 est également citée comme source d’inspiration. Plusieurs députés de l’Assemblée constituante, comme Lafayette ou Talleyrand, avaient d’ailleurs voyagé en Amérique. La Déclaration des droits de l’homme a donc aussi une filiation anglo-saxonne ?
Oui tout à fait. Il y a déjà la Magna carta, la Grande Charte de 1215 qui, pour la première fois, a limité les droits du roi en Angleterre même si, à nouveau, c’étaient les nobles qui défendaient leurs droits. Mais tout cela vient de cette même idée que le pouvoir ne peut pas être imposé d’en haut, au nom de Dieu ou au nom du roi. Et donc, les droits de l’homme ont rogné peu à peu dans cet absolutisme soit religieux, soit royal, pour installer des droits qui appartiennent à un grand nombre et au nom de la raison.
Est-ce que l’Habeas Corpus adopté en Angleterre en 1679 et qui impose que tout prisonnier soit déféré devant un juge fait également partie de cette filiation ?
Absolument. L’Habeas Corpus, c’est essentiel puisque c’est la première limitation à la détention arbitraire. En France, malheureusement, on a eu les lettres de cachet où l’on pouvait envoyer quelqu’un à la Bastille de manière illimitée sans rien justifier. L’Habeas Corpus, c’est la première fois qu’il y a une règle qui dit qu’on ne peut pas détenir quelqu’un de manière arbitraire. Il faut qu’il y ait un motif qui soit vérifié et validé par un juge. Cela part à nouveau de l’idée de limiter le pouvoir absolu.
Comment expliquer, sur le plan philosophique, que la Constitution américaine, souvent citée comme modèle, se soit accommodée si facilement de l’esclavagisme aux États-Unis ?
Parce que cette Constitution a été adoptée sur un mode consensuel. Cette Constitution de 1787 est un texte très, très, court qui résumait le consensus des treize colonies qui ont fondé les États-Unis. Peu à peu, ils ont adopté les célèbres amendements – il y en a maintenant vingt-sept – et chaque amendement est venu préciser quelque chose. Par exemple, le 1er amendement, c’est celui concernant la liberté d’expression et ce n’est que le 13e amendement, après la guerre de Sécession en 1865, qui a aboli l’esclavage. Les amendements ont été ajoutés de manière très pragmatique. Alors évidemment, comme tous les États du Sud étaient esclavagistes et que pour modifier la Constitution américaine il faut une majorité des deux tiers au Congrès ou bien une proposition émanant des deux tiers des États [cette deuxième possibilité n'a jamais été utilisée dans l'Histoire américaine, NDLR], c’était impossible avant la guerre de Sécession de faire adopter ce type d’amendement contre l’esclavage.
Vous avez cité Jean-Jacques Rousseau comme l’un des inspirateurs de la Déclaration des droits de l’homme. Du côté des philosophes allemands, par exemple, y a-t-il eu également des chantres des droits de l’homme ?
Oui bien sûr, et en particulier Emmanuel Kant. Kant a été un homme très important. Ce philosophe allemand était très admiratif de la Révolution française. C’est celui qui, pour la première fois dans le domaine philosophique, a dit : « Je ne sais pas si Dieu existe ou s’il n’existe pas, mais je ne peux pas le connaître par ma raison. » Cela veut dire « donc je ne peux pas imposer quelque chose à autrui au nom d’une autorité que je ne peux pas expliquer ». Il a écrit un très beau texte qui s’appelle Qu’est-ce que les Lumières ? où il dit que l’arrivée des Lumières, c’est l’affranchissement de l’homme, que c’est l’arrivée de l’homme à l’âge adulte. Il a été un très grand inspirateur de tout cet élan vers l’idée qu’il faut remplacer l’autorité sans contestation par la raison.
Image d'artiste non datée montrant le philosophe allemand Emmanuel Kant. Kant, mort le 12 février 1804 à Koenigsberg, aujourd'hui Kaliningrad, en Russie occidentale.
Image d'artiste non datée montrant le philosophe allemand Emmanuel Kant. Kant, mort le 12 février 1804 à Koenigsberg, aujourd'hui Kaliningrad, en Russie occidentale. ASSOCIATED PRESS
Vous citez Dieu. Est-ce que le fait religieux, souvent porteur de dogmes, et les droits de l’homme peuvent être conciliables ?
C’est une grande question. Il est évident que dans la Bible et dans le Coran, il y a des règles qui ont été reprises par les droits de l’homme : tu ne tueras point, tu ne voleras point…
Je vous coupe : les Dix Commandements, par exemple, peuvent être aussi considérés comme les « ancêtres » de la déclaration des droits de l’homme ?
Oui, bien sûr. On peut le dire comme ça, tout en sachant que les Dix Commandements sont un texte tellement court et tellement ouvert à interprétation… Par exemple, le « Tu ne tueras point » n’a pas empêché les religions de justifier la peine de mort. Dans cette optique, il faut tuer celui qui a tué. Lus de manière progressiste, les Dix Commandements peuvent être une source pour les droits de l’homme et justifier le premier droit de l’homme, le droit à la vie, principal argument des militants de l’abolition de la peine de mort. À l’inverse, ce même texte, lu au pied de la lettre, peut justifier les pires choses.
Les dogmes religieux peuvent parfois être contraignants, voire priver de certaines libertés…
C’est tout le pari des droits de l’homme. Les droits de l’homme sont, en fait, une sécularisation de certains principes intangibles. C’est vrai que les Dix Commandements, ou les principes de la Bible, avaient comme légitimité le fait que c’était Dieu qui les avait donnés aux hommes alors que les droits de l’homme, c’est l’homme qui se les donne lui-même en tant que souverain. C’est à la fois une sécularisation et une sacralisation, parce que maintenant, on peut dire que le droit à la vie, que le droit à ne pas être discriminé, que le droit à l’éducation ou à la santé, par exemple, sont des droits intangibles. Il n’y a personne qui nie ces droits même si, après, les modes de mise en œuvre de ces droits peuvent grandement varier. Mais ce sont des droits qui ne souffrent d’aucune contestation. Nulle part, il y a un État qui peut oser dire : « On n’a pas le droit d’être soigné de manière égale quelle que soit l’origine ethnique ou l’origine économique de la personne. »
Est-ce que le droit à l’avortement peut être considéré comme un droit de l'homme ?
Alors ça, c’est une très grande question. Elle a divisé beaucoup d’ONG, y compris Amnesty International. Certains ont opté pour une voie de compromis en s’abstenant de réclamer le droit à l’avortement de manière absolue tout en mettant l’accent sur les cas où le fait de refuser l’avortement met en danger la santé mentale ou physique d’une personne. C’est évidemment le cas en cas de viol, et c’est évidemment le cas en cas d’inceste. Mais, comme vous le savez, il y a des pays – notamment en Amérique latine – où même des jeunes filles qui ont été violées ou bien qui ont été victimes d’inceste et sont tombées enceintes peuvent être poursuivies pour avoir tenté d’interrompre leur grossesse. L’évolution récente, aux États-Unis, est à cet égard très inquiétante. Car au-delà de la question de principe sur laquelle on peut débattre, il est incontestable que l’interdiction de l’avortement a une portée discriminatoire évidente. Une femme américaine qui dispose de moyens financiers pourra toujours se rendre à New York ou en Californie pour y effectuer une interruption de grossesse dans des conditions sanitaires sûres. Je crois que le grand défi des droits de l’homme, c’est d’éviter le piège des débats philosophiques. Les débats philosophiques, c’est fait pour les philosophes. Je prends le cas très important des droits LGBT [Lesbienne-Gay-Trans et Bi, NDLR] sur lesquels j’ai beaucoup travaillé. Évidemment qu’il y a des pays, en Afrique notamment mais aussi en Asie et en Amérique latine où, à cause de la religion ou de pesanteurs sociologiques, certains vont dire : « Les homosexuels sont des gens anormaux ; donner des droits aux homosexuels, cela va remettre en cause la famille et caetera ». L’approche par les droits signifie que l’on va dire : un homosexuel est une personne comme les autres. Donc, les droits fondamentaux de cette personne ne peuvent pas être remis en cause ; cette personne ne peut pas être arrêtée de manière arbitraire, ou condamnée à mort de manière arbitraire, ou frappée de manière arbitraire. Donc, on va essayer ne de ne pas tomber dans le piège du débat philosophique sur la conception de la famille ou sur la morale mais plutôt de dire qu’il y a des droits qui sont intangibles. Moi, je vais souvent en Afrique parler avec des États qui criminalisent encore les relations homosexuelles et je leur dis : « Voilà, est-ce que vous estimez normal d’arrêter quelqu’un, de le tabasser, de le torturer, de le maintenir en prison de manière arbitraire pour quelque raison que ce soit ? » Évidemment, les autorités vont dire : « Non ». Et parmi les « quelque raison que ce soit », il y a l’orientation sexuelle. C’est une manière d’éviter le piège qu’on peut nous tendre en disant : « Ce que vous voulez, en fait, c’est introduire partout le mariage pour tous ou des choses comme ça ». On dit : « Non, ça c’est un problème de morale, c’est un problème de société et c’est au gouvernement de décider cela ; mais il y a des droits intangibles sur lesquels personne ne peut revenir. » Et ces droits, ce sont l’interdiction absolue de la torture, c’est le droit absolu à avoir un procès équitable, à ne pas être détenu de manière arbitraire, à ne pas être tabassé, etc.
L’abolition de la peine de mort est l’une des plus grandes avancées en matière de droits de l’homme, mais elle est assez récente. Est-ce que, par le passé, des civilisations avaient aboli la peine de mort ?
À ma connaissance, non. Comme vous le savez, la torture est interdite dans tous les cas, mais la peine de mort n’est pas interdite par le droit international dans tous les cas. Dans le Pacte international des droits civils et politiques, il est dit : « On ne privera pas quelqu’un de la vie de manière arbitraire, sauf lorsque des sanctions légales sont prévues. » Pourquoi y a-t-il eu cette disposition ? Parce que, sans cette disposition, tous les États qui pratiquent la peine de mort – comme les États-Unis, l’Arabie saoudite, l’Iran – n’auraient pas ratifié ce pacte. Cela permet aux pays qui n’ont pas aboli la peine de mort de dire : « On pratique la peine de mort, mais on respecte le droit international dans la mesure où nous ne tuons qu’en fonction de sanctions légales. » C’est un combat qui est mené au jour le jour. Plus des deux tiers des États à travers le monde ont aboli la peine de mort et le mouvement abolitionniste ne cesse de connaître des avancées, même aux États-Unis, mais, contrairement à la torture, on ne peut pas dire que la peine de mort est interdite par le droit international.
Les droits de l’homme, c’est aussi les droits des femmes. Or, en anglais, on parle des « human rights », littéralement les « droits humains », alors qu’en français, on a gardé l’expression « droits de l’homme ». Même si c’est au sens large du terme, est-ce que cela ne pose pas problème, encore plus dans le contexte actuel ?
C’est un très grand débat. De plus en plus d’organisations internationales comme Amnesty, par exemple, parlent de « droits humains ». Les Canadiens parlent des « droits de la personne » ou des « droits humains ». Je sais que la France, les Nations unies et l’OIF où je travaille actuellement, gardent pour le moment « droits de l’homme », mais même dans ces enceintes, cela aussi est en train de changer. À l’OIF, nous gardons pour le moment « droits de l’Homme » avec un H majuscule. En fait, ceux qui défendent cette optique disent que, en latin, « homo », c’est homme et femme, comme dans « Homo sapiens ». En latin, le mot « homme » se dit « vir » et pas « homo ». Et donc ils disent que, à l’origine, le mot « homme » ne désignait pas les hommes au masculin mais les hommes et les femmes. C’est effectivement un débat, mais je pense qu’il ne faut pas attribuer trop d’importance à cela, parce que les défis sont tellement grands que perdre du temps là-dessus… Moi, je préfère « droits humains » à titre personnel. Mais je préfère consacrer mon énergie à défendre les droits qu’à discuter longuement entre « droits de l’homme » et « droits humains ».
On a quand même l’impression que le respect des droits de l’homme s’applique surtout pour le moment aux sociétés occidentales. On a tort ?
Non, on ne peut pas dire cela. Moi, cela fait trente ans que je travaille sur l’Afrique et, en trente ans, le degré de la liberté d’expression et d’association dans ce continent a connu des avancées inimaginables.
Pas dans les pays où la charia est appliquée cependant….
Même dans ces pays, les droits de l’Homme servent de fer de lance à la contestation et peuvent secouer des régimes forts. Regardez ce qui se passe actuellement en Iran. Des hommes et des femmes jeunes sont prêts à mourir pour la liberté, pour des droits qui ont été consacrés de manière universelle, pour la première fois en 1948. Toutes les demandes de liberté et de respect des droits dans le monde découlent directement de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Ce texte repose sur un postulat et un pari. Il affirme l’universalité, l’indivisibilité et l’interdépendance des droits de l’Homme. Et cette affirmation demeure révolutionnaire et pour beaucoup d’États difficile à accepter. Beaucoup d’observateurs affirment que la Déclaration universelle des droits de l’Homme ne pourrait pas être adoptée aujourd’hui par les États, parce que ce texte va très loin. Cette déclaration, si on la relit maintenant, quasiment tous les droits y sont consacrés. On peut imaginer que de nombreux États refuseraient actuellement d’adopter cette déclaration pour des raisons idéologiques ou religieuses.
Vous avez dit que la Déclaration de 1948 couvrait tout le droit. Or, depuis 1948, l’humanité a évolué. Et il y a des problématiques qui ne figurent pas dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 : la bioéthique, la génétique, l’environnement, l’espace, etc. Est-ce qu’il ne serait pas opportun d’ajouter des chapitres comme on ajoute des amendements à une Constitution ?
Comme je vous l’ai dit, parvenir au consensus de 1948 était relativement facile pour deux raisons : d’abord, il y avait beaucoup moins d’États qu’aujourd’hui. Il n’y avait quasiment pas d’États indépendants en Afrique, il y avait très peu d’États en Asie qui étaient indépendants, on sortait de la Deuxième Guerre mondiale… Même les Russes, par exemple, qui pouvaient ne pas être tout à fait d’accord avec des principes tels que la liberté d’expression qu’ils bafouaient tranquillement chez eux, n’ont pas osé s’y opposer. Donc, je pense que toucher à la déclaration maintenant me semblerait très dangereux. En revanche, là où vous avez tout à fait raison, c’est que ces nouveaux droits, qui n’étaient pas envisagés à l’époque, doivent faire l‘objet de nouvelles conventions. L’Accord de Paris sur le climat, par exemple, ou sur la bioéthique : il faut faire de nouvelles conventions pour intégrer ces droits. Mais au-delà de la conclusion d’accords, il y a le problème de la mise en œuvre et là, je ne peux qu’être pessimiste. La polarisation actuelle dans le monde, sans précédent depuis la fin de la guerre froide, la désastreuse présidence de Donald Trump, la fuite en avant du président Poutine, l’autisme des autorités chinoises, cela ne porte à l’optimisme. Sauf à agir en brandissant à nouveau l’arme des droits de l’Homme. Les Russes coupables de crimes de guerre pourraient un jour se retrouver à La Haye devant la CPI, comme cela a été le cas pour Milosevic. C’est ce que demandent et recherchent déjà des ONG de défense des droits de l’Homme, comme la FIDH.
On peut garder espoir quand même ?
Oui, parce que nous n’avons pas d’autre choix et parce que, malgré tout, il y a des signes d’espérance. Malgré tout leur pouvoir, Trump ou Bolsonaro ont été chassés par les urnes. Le pouvoir théocratique en Iran vacille sous les cris de jeunes femmes et de jeunes hommes qui n’ont plus peur. En Ukraine, un peuple s’est levé contre un envahisseur beaucoup plus puissant que lui et il tient bon. Vous pourrez, bien entendu, m’opposer des dizaines de contre-exemples, que je ne pourrai pas nier. Mais quel que soit le point de vue que l’on adopte, il est incontestable que la défense des droits de l’Homme, de la démocratie et de l’État de droit demeure une arme redoutable et crainte des tyrans.
Pour conclure, vous diriez qu’elle a laissé quel héritage, cette Déclaration universelle des droits de l’homme ?
Je crois qu’elle a laissé le plus beaux des héritage ; pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, des droits s’appliquent à tous. C’est la première fois dans l’histoire de l’humanité que des États ont lancé un signal : celui de dire qu’il y a des droits qui concernent tout le monde. Jusque-là, certains de ces droits avaient concerné des personnes, dans le Nord, des personnes éduquées et avaient exclu d’autres. Pour la première fois, le principe de l’universalité et de l’indivisibilité des droits de l’Homme a été proclamé. Et puis le deuxième héritage, c’est que ce texte a permis ensuite l’adoption de textes contraignants. Il y a, à l’heure actuelle, neuf grands traités contraignants : les deux pactes dont je vous ai parlé en début d’entretien mais aussi la convention contre la torture, contre les disparitions forcées, sur les droits de l’enfant, etc., qui, eux, sont des pactes contraignants. Malgré tous les retards, malgré toutes les marches arrière, pour la première fois dans l’humanité, des États ont accepté de limiter leur propre pouvoir. Mes étudiants à Sciences Po me disent : « Est-ce qu’il y a des raisons d’être optimistes dans un monde aussi grave ? ». Je leur réponds que j’ai travaillé vingt-cinq ans pour Amnesty International, que j’ai rencontré les pires tortionnaires, que j’ai rencontré les chefs d’État les plus cyniques qui soient, en Afrique, et qu’aucun ne m’a dit : « Moi ? Eh bien, je torture ! Moi, je tue ! » Ils ont menti, ils ont caché, ils ont nié, ils ont même affirmé être de grands défenseurs des droits de l’Homme. Est-ce qu’on peut imaginer Gengis Khan ou, plus près de nous, Hitler ou Staline prendre de telles précautions ? Donc, malgré tout, même chez les pires tortionnaires, il y a désormais un surmoi qui impose le respect de ces normes. Même lorsqu’elles sont violées. Malgré tout, il y a eu, dans la conscience universelle, un bond en avant inimaginable. Et cela, nous le devons en grande partie à la Déclaration universelle des droits de l’Homme.
Les États-Unis et 55 autres pays ont lancé, ce 28 avril, une initiative commune pour garantir un internet sûr et libre. Avec la signature de cette charte baptisée « Déclaration pour l’avenir d’internet », l’administration Biden veut réunir le plus de pays possibles autour d’une vision commune sur ce que doit être la toile de demain.
La « Déclaration pour l’avenir d’internet » contient plus de 20 « principes ». Dans cette charte, les signataires s’engagent, entre autres, à renforcer la démocratie en ligne en acceptant de ne pas fermer l'accès à l'internet. Les plus de 60 pays participants – dont la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, le Japon, ou encore le Kenya et l'Ukraine – promettent de ne pas utiliser d’algorithmes pour espionner illégalement les citoyens et de ne pas mener de campagnes de désinformation pour influer sur des élections.
« Aux côtés de + de 50 partenaires, les États-Unis ont lancé aujourd'hui la déclaration pour l'avenir d'internet, un engagement à promouvoir un internet ouvert, au profit des peuples du monde entier. » - Le @SecBlinken #FutureoftheInternet pic.twitter.com/FwLtGCIXZg
La Russie et la Chine pointées du doigt
Cette initiative se veut un contrepoids face à l’inquiétante montée de grandes puissances autoritaires, où l’accès à l’information numérique est restreint. L’enjeu est majeur, explique la Maison Blanche. Puisqu’il s’agit de repousser « l’autoritarisme numérique croissant », dont font preuve notamment la Chine et la Russie. Les équipes de Joe Biden ont travaillé pendant plusieurs mois à l'élaboration de cette charte.
Depuis l'invasion de l'Ukraine, le 24 février dernier, « la Russie a promu de manière agressive la désinformation dans son pays et à l'étranger, censuré les sources d'information sur internet, bloqué ou fermé des sites légitimes et est allée jusqu'à attaquer physiquement l'infrastructure internet en Ukraine », a dénoncé un haut responsable de l'administration Biden auprès de journalistes.
La nouvelle charte concoctée par Washington montre pourtant déjà ses limites : elle est non contraignante et des pays comme l’Inde, l’Indonésie ou le Brésil ne l’ont pas signée. Les défenseurs américains d’un internet libre attendent de Joe Biden surtout qu’il revienne sur la décision, prise sous la présidence de Donald Trump, de mettre fin à la neutralité du net. Le président s’y est engagé. Mais ses nominations pour les postes à la Commission fédérale des communications sont toujours bloquées au Sénat.
Il y a cent quarante ans, était promulguée une législation majeure pour la démocratie : la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, encore en vigueur de nos jours à part quelques modifications de détail.
Cette loi s’inscrivait dans une séquence historique d’extension de la démocratie et des libertés impulsée par les gouvernements républicains « opportunistes » des années 1880 : loi du 30 juin 1881 permettant de tenir les réunions publiques sans autorisation, sur simple déclaration préalable, loi du 4 mars 1882 donnant à tous les conseils municipaux le droit d’élire leur maire, ou bien encore loi du 21 mars 1884 instaurant la liberté syndicale.
La presse et l’imprimerie sous haute surveillance
Le texte du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse apparaît comme une consécration. Car si cette liberté était déjà reconnue dans l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, elle avait été bien souvent mise à mal depuis la Révolution.
La législation votée sous le ministère de Jules Ferry impose un cadre légal à toute publication, ainsi qu’à l’affichage public, au colportage et à la vente sur la voie publique. Son article 1 stipule que « l’imprimerie et la librairie sont libres ». Pour en arriver là, le chemin a été long et jalonné par des flux et des reflux.
La liberté d’expression a été perçue comme un danger par tous les régimes politiques et par l’Église, depuis que l’invention de l’imprimerie par Gutenberg multiplia les ouvrages, journaux, libelles et illustrations de toutes sortes...
Dès le règne de Louis XIII, le cardinal Richelieu organise une surveillance systématique de l'écrit afin d’interdire ou freiner la multiplication des écrits hostiles au pouvoir.
Sous le nom de Librairie, un service d'une centaine de censeurs va jusqu'à la Révolution veiller à ce que la religion, la moralité, l’État, le roi, le gouvernement ou des compatriotes ne soient pas bafoués.
Avec plus ou moins d’efficacité car les auteurs faisaient souvent éditer leurs œuvres à l’étranger et les diffusaient sous le manteau. Les censeurs eux-mêmes procédaient à des arrangements. Le plus célèbre directeur de la Librairie (1750-1763), Malesherbes, pensait d'ailleurs « qu’un homme qui n’aurait lu que des livres parus avec l’attache expresse du gouvernement, comme la loi le prescrit, serait en arrière de ses contemporains presque d’un siècle ».
Tout change avec la Révolution. Plus de 1300 journaux et gazettes apparaissent, de façon souvent éphémère. Mais la liberté de la presse a beau être proclamée, elle n’est pas toujours respectée comme le montre la saisie du Vieux Cordelier de Camille Desmoulins ou celle du Tribun du peuple de Gracchus Babeuf, ainsi que l’emprisonnement ou l’exécution de journalistes.
Après dix ans de révolution, le Premier Consul Bonaparte rétablit la censure le 17 janvier 1800. Le nombre de journaux est limité à onze et sera encore réduit à quatre en 1811.
La surveillance des journaux ne se relâche pas avec la chute de Napoléon Ier malgré l’article 8 de la Charte constitutionnelle de 1814 qui reconnaît la liberté de la presse et malgré Chateaubriand : « Plus vous prétendez comprimer la presse, plus l’explosion sera forte. Il faut donc vous résoudre à vivre avec. »
Sans liberté de presse, une révolution !
Le point d’orgue de la répression intervient lorsqu’en 1830, Charles X signe les quatre ordonnances de Saint-Cloud, dont la première suspend une nouvelle fois la liberté de la presse. Cette mesure constitue le déclencheur de la révolution des Trois Glorieuses.
La révolution aboutit à remplacer le très autoritaire Charles X par son cousin, le libéral Louis-Philippe. La nouvelle Charte constitutionnelle stipule que « les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois » et restaure la liberté de la presse.
Mais cette embellie s’avère de courte durée car l’attentat de Fieschi contre Louis-Philippe, le 28 juillet 1835, donne l’occasion au pouvoir de porter le fer contre la presse à travers la « loi scélérate » du 9 septembre 1835 qui soumet les dessins et gravures à l’autorisation préalable.
Avec l’élection de Louis-Napoléon Bonaparte à la présidence de la République le 10 décembre 1848 puis avec la proclamation du Second Empire, s’ouvre une période sombre pour la presse (cautionnement, timbres, avertissements, etc.).
C’est à cette époque que des satiristes représentent la censure en une vieille femme tenant d’énormes ciseaux et surnommée Anastasie.
La presse n’est pas la seule forme d’expression victime de la censure. Des œuvres littéraires sont aussi dans le viseur de la police et de la justice. En 1857, trois écrivains, Gustave Flaubert, Charles Baudelaire et Eugène Sue sont traînés devant les tribunaux. Ce qui fera dire à Flaubert : « La censure quelle qu’elle soit, me paraît une monstruosité, une chose pire que l’homicide : l’attentat contre la pensée est un crime de lèse-âme. »
La libéralisation du régime à partir des années 1860 conduit à l’Âge d’or de la presse sous la Troisième République qu’amplifiera la loi du 29 juillet 1881.
Précaire liberté, nouveaux défis
Les aléas de la politique et de l’Histoire vont conduire toutefois au retour de la censure. C’est le « bourrage de crâne » que dénonce le Canard Enchaîné lors de la Première Guerre mondiale. La censure revient aussi, plus gravement, sous l’Occupation allemande, enfin encore pendant la guerre d’Algérie.
Méfiant malgré tout à l’égard des citoyens, surtout quand ils disposent d’une plume, d’un micro ou d’un clavier, le législateur nes manque pas d’amender régulièrement la loi de 1881.
La loi Pleven du 1er juillet 1972, relative à la lutte contre le racisme crée un nouveau délit et permet à des associations de se porter partie civile, ce qui va susciter nombre d’abus. La loi Gayssot du 13 juillet 1990 sanctionne quant à elle la négation de la Shoah.
L’émergence d’Internet et des réseaux sociaux suscite enfin de nouvelles « adaptations » de la loi...
Quelques centaines de milliers de Français sont dans la rue pour protester contre l’obligation d’un « passe sanitaire ». Il ne s’agit plus simplement d’un mouvement d’humeur mais d’une révolte populaire qui n’est pas sans rappeler le mouvement des Gilets jaunes (2019) et celui des Bonnets rouges (2013).
Pas question ici de prendre position sur l’obligation du passe sanitaire. Nous ne nous demanderons pas s’il s’agit d’une mesure de salut public ou d’une atteinte insupportable à la liberté. Mais nous nous interrogerons sur la notion de liberté et le respect des procédures démocratiques par le gouvernement français...
Dans le droit fil de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, nous tendons à penser que la liberté « consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » (Article IV de la Déclaration). Ainsi puis-je revendiquer le droit de ne pas me vacciner, ne pas attacher ma ceinture de sécurité, ne pas inscrire mes enfants à l'école, mais aussi porter un voile (si je suis une femme) ou encore payer une femme pour qu'elle porte un enfant conçu à partir de mes gamètes.
L'application stricte de cette définition conduit à une impasse. Il faut beaucoup de contorsions en effet pour justifier d'un côté le refus de se faire vacciner, d'autre part l'acceptation de la ceinture de sécurité. Si j’accepte l’obligation de porter la ceinture de sécurité en voiture ou encore de me faire vacciner contre la fièvre jaune quand je vais dans certains pays, pourquoi devrais-je contester l’obligation du passe sanitaire dans les magasins et les lieux de spectacle ?
On pourra rétorquer que le vaccin contre la fièvre jaune a été validé par l’expérience, ce qui n’est pas le cas du vaccin contre le covid. C’est affaire de débat et c’est là le nœud de l’affaire. Qui peut juger du bien-fondé d’une contrainte ? Face à un enjeu collectif, chacun est-il habilité à agir selon son opinion personnelle, ce qui revient à supprimer toute contrainte ?
La loi, garante de la liberté
Chaque société, pour conserver sa cohésion, doit imposer des règles de conduite communes, comme par exemple, en France, inscrire ses enfants au cursus scolaire commun, respecter le code de la route, ne pas dissimuler son visage, ne pas faire commerce de ses organes, etc. Toutes ces obligations et bien d’autres, qui limitent de fait la liberté individuelle, sont admises par l’ensemble des citoyens. Pourtant, elles ne coulent pas de source et plusieurs d’entre elles sont ignorées par des pays tout aussi démocratiques que la France.
Les députés de l’Assemblée nationale de 1789 ont eux-mêmes convenu de la nécessité d’imposer des bornes à la liberté individuelle. Ils ont pris soin de souligner que « ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi » (Article IV) en précisant : « La loi est l'expression de la volonté générale » (Article VI). En d’autres termes, la loi doit émaner du Peuple souverain (j'aime bien cette formule qui nous vient de Rousseau). C'est essentiel pour l'acceptabilité de la loi car toute loi contient des obligations susceptibles d'affecter telle ou telle catégorie de citoyens. Une loi qui ne gênerait personne et ne contiendrait que des obligations consensuelles serait inutile.
Si une loi est promulguée sans débat comme il est de règle dans les régimes despotiques, les catégories affectées par cette loi vont tendre à s’y opposer de toutes les façons possibles (révolte ou désobéissance massive) en arguant de son illégitimité. Le gouvernement n’aura d’autre solution que de mettre au pas les récalcitrants par la répression et les tribunaux.
Si par contre une loi est véritablement débattue au Parlement, alors les citoyens auront le loisir de peser les termes de l’enjeu et d’en discuter entre eux s’il en est besoin. Au final, ils seront portés à accepter le vote de leurs députés et il ne sera pas nécessaire de mobiliser policiers et juges pour faire appliquer la loi. C’est tout l’avantage de la démocratie (étymologiquement, le « gouvernement par le peuple ») sur le despotisme (le « pouvoir d’un seul »)... Et c'est d'évidence ce qui a manqué à la loi sur le passe sanitaire, dont le vote, acquis d'avance, n'a pas fait l'objet d'un débat approfondi et contradictoire.
L'arbitraire, ennemi de la liberté
Dès lors que les gouvernants jouent le jeu de la démocratie, dès lors que les citoyens connaissent et comprennent les règles sociales qui s'appliquent à chacun et les limites qui s’appliquent à leurs pulsions et leurs désirs, chacun peut vivre dans la sérénité. L'ennemi de la liberté, ce ne sont pas les limites à cette liberté, sous réserve qu'elles aient fait l’objet d’un vote démocratique, mais c'est l'arbitraire et l'opacité.
Parions que si le gouvernement français avait laissé les parlementaires dé-battre du passe sanitaire sans leur forcer la main, nous n'en serions pas venus à nous battre dans la rue à son propos ! Dès le début de la pandémie, notons-le, il a requis l’état d’urgence. En s'appuyant sur une majorité de députés « godillots », il a pu faire passer des mesures coercitives d’une rare violence (confinement général) et parfois ubuesques (auto-attestations de sortie, limitation à 30 du nombre de fidèles dans les lieux de culte, cathédrale ou chapelle, etc.).
Les manifestations contre l’obligation du passe sanitaire traduisent l’exaspération de citoyens privés d’un débat démocratique et ouvert sur ces questions comme sur bien d'autres. Cette exaspération a des racines profondes. Elle vient en premier lieu de la judiciarisation de la loi, qui a débuté avec l’extension du droit de saisine du Conseil Constitutionnel en 1974, sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing. Depuis lors, les magistrats français et européens, sans autre légitimité que d’avoir été nommés à leur poste par des homologues bienveillants, n’ont de cesse de grignoter des parcelles de pouvoir. Ils en viennent à encadrer la loi sans que les représentants du Peuple souverain aient leur mot à dire.
La classe politique a accepté cette judiciarisation parce qu’elle sert son dessein, qui est de déléguer aux instances européennes les instruments de la souveraineté nationale : monnaie, maîtrise des frontières, droit de la citoyenneté, etc. Chaque fois qu’émerge une tentative de renforcer la souveraineté nationale, autrement dit la maîtrise de leur destin par les citoyens, il se trouve un tribunal (Conseil Constitutionnel, Conseil d’État, Cour de justice européenne) pour y faire obstacle avec les meilleures intentions du monde.
Si les députés s’inclinent si facilement, c’est que depuis l’introduction du quinquennat en 2000 et l’alignement du mandat présidentiel sur la législature, il n’y a plus de débat véritable au Parlement. Les élections législatives suivant de quelques semaines l’élection présidentielle, les électeurs sont naturellement portés à donner une majorité très confortable à l’hôte de l’Élysée, lequel se trouve dès lors assuré pendant cinq ans d’un pouvoir quasi-absolu, plus important que celui dont pouvait jouir Louis XIV !
L’illustration la plus percutante de cette dérive antidémocratique nous a été fournie en 2005 (16 ans déjà !) par le référendum sur le traité constitutionnel européen. Au terme d’une campagne intense et richement argumentée, ce texte a été clairement rejeté par les citoyens et malgré cela imposé par la classe politique, tous bords confondus, sous le nom de traité de Lisbonne.
Sauf sursaut démocratique comme nos cousins britanniques en ont donné l’exemple en restaurant leur souveraineté, il est à craindre que nous nous éloignions de l'idéal démocratique avec un pouvoir qui ne laisse aucune chance au vote populaire chaque fois que celui-ci cherche à exprimer sa différence ou ses inquiétudes, que ce soit sur les institutions européennes, l'écotaxe ou le passe sanitaire.
André Larané
Nous avons besoin de vous. De votre mobilisation. Du rempart de vos consciences.
Il n’est jamais arrivé que des médias, qui défendent souvent des points de vue divergents et dont le manifeste n’est pas la forme usuelle d’expression, décident ensemble de s’adresser à leurs publics et à leurs concitoyens d’une manière aussi solennelle.
Si nous le faisons, c’est parce qu’il nous a paru crucial de vous alerter au sujet d’une des valeurs les plus fondamentales de notre démocratie: votre liberté d’expression.
Aujourd’hui, en 2020, certains d’entre vous sont menacés de mort sur les réseaux sociaux quand ils exposent des opinions singulières. Des médias sont ouvertement désignés comme cibles par des organisations terroristes internationales. Des États exercent des pressions sur des journalistes français “coupables” d’avoir publié des articles critiques.
La violence des mots s’est peu à peu transformée en violence physique.
Ces cinq dernières années, des femmes et des hommes de notre pays ont été assassinés par des fanatiques, en raison de leurs origines ou de leurs opinions. Des journalistes et des dessinateurs ont été exécutés pour qu’ils cessent à tout jamais d’écrire et de dessiner librement.
“Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi”,
proclame l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, intégrée à notre Constitution. Cet article est immédiatement complété par le suivant: “La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.”
Pourtant, c’est tout l’édifice juridique élaboré pendant plus de deux siècles pour protéger votre liberté d’expression qui est attaqué, comme jamais depuis soixante-quinze ans. Et cette fois par des idéologies totalitaires nouvelles, prétendant parfois s’inspirer de textes religieux.
Rappelons ici, en solidarité avec Charlie Hebdo, qui a payé sa liberté du sang de ses collaborateurs, qu’en France, le délit de blasphème n’existe pas.
Bien sûr, nous attendons des pouvoirs publics qu’ils déploient les moyens policiers nécessaires pour assurer la défense de ces libertés et qu’ils condamnent fermement les États qui violent les traités garants de vos droits. Mais nous redoutons que la crainte légitime de la mort n’étende son emprise et n’étouffe inexorablement les derniers esprits libres.
Que restera-t-il alors de ce dont les rédacteurs de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 avaient rêvé? Ces libertés nous sont tellement naturelles qu’il nous arrive d’oublier le privilège et le confort qu’elles constituent pour chacun d’entre nous. Elles sont comme l’air que l’on respire et cet air se raréfie. Pour être dignes de nos ancêtres qui les ont arrachées et de ce qu’ils nous ont transmis, nous devons prendre la résolution de ne plus rien céder à ces idéologies mortifères.
Les lois de notre pays offrent à chacun d’entre vous un cadre qui vous autorise à parler, écrire et dessiner comme dans peu d’autres endroits dans le monde. Il n’appartient qu’à vous de vous en emparer. Oui, vous avez le droit d’exprimer vos opinions et de critiquer celles des autres, qu’elles soient politiques, philosophiques ou religieuses pourvu que cela reste dans les limites fixées par la loi. Rappelons ici, en solidarité avec Charlie Hebdo, qui a payé sa liberté du sang de ses collaborateurs, qu’en France, le délit de blasphème n’existe pas. Certains d’entre nous sont croyants et peuvent naturellement être choqués par le blasphème. Pour autant ils s’associent sans réserve à notre démarche. Parce qu’en défendant la liberté de blasphémer, ce n’est pas le blasphème que nous défendons mais la liberté.
Nous avons besoin de vous. De votre mobilisation. Du rempart de vos consciences. Il faut que les ennemis de la liberté comprennent que nous sommes tous ensemble leurs adversaires résolus, quelles que soient par ailleurs nos différences d’opinions ou de croyances. Citoyens, élus locaux, responsables politiques, journalistes, militants de tous les partis et de toutes les associations, plus que jamais dans cette époque incertaine, nous devons réunir nos forces pour chasser la peur et faire triompher notre amour indestructible de la Liberté.
DéfendonsLaLiberté
Alliance de la presse d’information générale, BFMTV, Canal+, Challenges, Charlie Hebdo, Cnews, Courrier International, Europe1, France Médias Monde, France Télévisions, L’Alsace, L’Angérien Libre, L’Avenir de l’Artois, L’Echo de l’Ouest, L’Echo de la Lys, L’Equipe, L’Essor Savoyard, L’Est-Eclair, L’Est républicain, L’Express, L’Hebdo de Charente-Maritime, L’Humanité, L’Humanité Dimanche, L’indicateur des Flandres, L’informateur Corse nouvelle, L’Obs, L’Opinion, L’Union, La Charente Libre, La Croix, La Dépêche du Midi, La Nouvelle République, La Renaissance du Loir-et-Cher, La Renaissance Lochoise, La Savoie, La Semaine dans le Boulonnais, La Tribune Républicaine, La Vie, La Vie Corrézienne, La Voix du Nord, Le Bien public, Le Canard Enchaîné, Le Courrier français, Le Courrier de Gironde, Le Courrier de Guadeloupe, Le Courrier de l’Ouest, Le Courrier Picard, Le Dauphiné libéré, Le Figaro, Le Figaro Magazine, Le HuffPost, Le Journal d’Ici, Le Journal des Flandres, Le Journal du Dimanche, Le Journal du Médoc, Le Journal de Montreuil, Le Journal de Saône-et-Loire, Le Maine Libre, Le Messager, Le Monde, Le Parisien / Aujourd’hui en France, Le Parisien Week-end, Le Pays Gessien, Le Phare Dunkerquois, Le Point, Le Progrès, Le Républicain Lorrain, Le Réveil de Berck, Le Semeur hebdo, Le Télégramme, Les Dernières Nouvelles d’Alsace, Les Echos, Les Echos du Touquet, LCI, Libération, Libération Champagne, M6, Marianne, Midi Libre, Monaco Matin, Nice Matin, Nord Eclair, Nord Littoral, Ouest France, Paris Match, Paris Normandie, Presse Océan, Radio France, RMC, RTL, Sud Ouest, TF1, Télérama, Var Matin, Vosges Matin.
Le Premier ministre s'en est pris à l'anonymat sur Internet, qui permet selon lui au pire de se déverser. Mais Jean Castex se trompe : il n'y a pas d'anonymat en ligne. La loi offre tous les outils adéquats pour remonter jusqu'à l'identité des internautes, si nécessaire. Encore faut-il donner les moyens à la justice de le faire rapidement.
Faut-il en finir avec l’anonymat en ligne ? La question n’est pas nouvelle : voilà bien vingt ans qu’elle revient de temps à autre dans le débat public, à gauche comme à droite, comme si elle n’avait jamais été vraiment tranchée. Elle vient de connaître un rebond le 15 juillet, avec l’interview de Jean Castex par Le Parisien. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le nouveau Premier ministre ne mâche pas ses mots.
Car le nouveau chef du gouvernement est allé puiser dans ce qu’il y a de pire dans l’histoire contemporaine française pour se livrer un réquisitoire sévère contre les réseaux sociaux et leur mode de fonctionnement actuel. « Les réseaux sociaux c’est le régime de Vichy : personne ne sait qui c’est ! », dénonce Jean Castex. « On peut vous traiter de tous les noms, de tous les vices, en se cachant derrière des pseudonymes. »
Si l’intéressé se dit « pour la liberté d’expression », il considère que l’anonymat « a quelque chose de choquant. […] si on se cache, les conditions du débat sont faussées ». D’ailleurs, la nouvelle tête de l’exécutif met en garde : la loi en la matière pourrait bouger d’ici la fin du quinquennat. , juge-t-il. « C’est un sujet dont il va falloir que l’on s’empare », a-t-il fait savoir, car à ses yeux, « il faudrait réglementer un peu tout ça ».
Il reste toutefois à savoir si le geste sera joint à la parole, ce qui s’avère moins certain qu’il n’y paraît. Jean Castex l’admet d’ailleurs : le gouvernement a déjà fort à faire sur le front de l’emploi, de la crise sanitaire et de la reprise économique pour ne pas se disperser. « Si on commence à dire aux gens que l’on va tout faire, ils ne nous croiront pas. Il faut choisir ses priorités ». Et l’anonymat n’en est pas forcément une.
L’anonymat sur Internet n’existe pas
Surtout qu’en réalité, l’anonymat sur Internet n’existe pas. Ce qui se manifeste en ligne, c’est du pseudonymat — le recours aux pseudonymes, pour le dire autrement. Et depuis 2004, la France sait très bien gérer l’identification des internautes qui franchissent les limites de la loi, grâce à un texte qui a fait depuis longtemps ses preuves la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), et plus particulièrement son fameux article 6.
Car l’anonymat supposerait que l’on n’ait aucune information sur l’internaute pour pouvoir remonter jusqu’à lui. Or, c’est faux : le fournisseur d’accès à Internet sait très bien qui sont ses clients (il a leur identité réelle, leur adresse postale, leurs coordonnées bancaires, leur numéro de téléphone, etc.). Et du côté des réseaux sociaux, justement, on a aussi accès à diverses données de connexion, dont l’adresse IP.
Même avec leur vraie identité, les internautes ne se comportent pas forcément de la meilleure des façons. // Source : Facebook
L’adresse IP agit un peu comme une plaque d’immatriculation sur le net. Avec elle, il est possible de remonter jusqu’à l’abonné d’un opérateur télécom pour savoir depuis quel accès à Internet tel ou tel contenu illicite a été publié. Et bien entendu, les sites comme Facebook, Twitter, YouTube ou Twitch, ont l’obligation légale de conserver un temps ces éléments pour les transmettre à la justice, en cas de demande.
Bien sûr, il peut y avoir ponctuellement des difficultés : l’utilisation d’un VPN ne facilite pas la tâche d’identification d’un internaute. Et ce n’est pas parce que l’on a une adresse IP que l’on sait avec exactitude qui a publié tel ou tel message incriminé (l’adresse IP est partagée par exemple par toutes les personnes se connectant à la même box Internet). Mais c’est là que l’enquête judiciaire prend le relais.
Évidemment, cela peut prendre du temps. Cela requiert des moyens. Mais cette levée du pseudonymat n’est jamais hors de portée. Il suffit pour s’en convaincre de regarder les faits divers qui peuplent les colonnes des médias. Il est fréquent d’apprendre que tel ou tel internaute hors des clous de la loi s’est fait pincer par les enquêteurs. Ceux qui ont harcelé et menacé la journaliste Nadia Daam pourraient l’attester.
Le pseudonymat, utile pour la vie privée et la liberté d’expression
Est-ce donc au pseudonymat qu’il faut mettre un terme ? Certainement pas : d’abord, car l’utilisation de l’identité réelle n’est pas systématiquement gage de civilité. Il n’est pas rare de voir des internautes apparaissant de toute évidence sous leur vrai nom déverser des injures dès que quelqu’un a le malheur de leur déplaire : il suffit de lire les réactions sous certains sites de presse ou sur les réseaux sociaux.
Ensuite, le pseudonymat est indispensable pour préserver sa vie privée tout en ayant un moyen d’exercer sa liberté d’expression. Aurait-on la même facilité à parler d’une maladie, de son employeur, de sa vie sexuelle, de son mal être à « visage » découvert ? Certains, peut-être. D’autres, en aucune façon. Et les cas de figure peuvent être multipliés : religion, politique, syndicalisme, fantasmes.
Loi haine internet
Le gouvernement et la majorité présidentielle ont tenté de faire passer une loi contre la haine en ligne. Si l’intention est louable, le texte a été jugé justement excessif et bancal juridiquement. Source : Commission des lois.
Il faut aussi imaginer l’enfer que cela pourrait être en matière de droit à l’oubli : en principe, celui-ci doit concilier l’intérêt du public et le respect de la vie privée. Or, on peut supposer que dans de nombreux cas de figure, les demandes de droit à l’oubli impliqueront des personnes n’ayant aucune surface médiatique et, donc, seront éligibles à bénéficier au droit à l’oubli. Or, vu le volume de demandes et de pages concernées, des pans entiers du web seraient désindexés.
Le pseudonymat sert aussi à se protéger contre des représailles (comme de son patron si l’on a envie de vider son sac) ou d’autres internautes, en utilisant une fausse identité ou, plus exactement, une identité numérique. Les personnes LGBT y ont recours, par exemple. Et vous aussi, certainement : vous jonglez probablement entre différentes identités, selon les communautés que vous fréquentez sur la toile.
Faire disparaître le pseudonymat aura une conséquence immédiate et d’ampleur sur la liberté d’expression : elle reculera. Plus personne ne voudra prendre la parole sur tout un tas de sujets. De façon imperceptible, une certaine auto-censure s’installera, surtout chez les personnes qui ne se rallient pas à l’opinion majoritaire sur tel ou tel sujet. Si Jean Castex est pour la liberté d’expression, il lui faut être pour le pseudonymat.
Une justice qui a trop peu de moyens
Le gouvernement veut rendre plus efficace la levée du pseudonymat pour que cessent les injures et les « vices » ? Qu’il flèche davantage de moyens à la justice ! Car aujourd’hui, la justice est l’un des ministères les moins bien pourvus. Et c’est le gouvernement qui le dit lui-même : sur 1 000 euros de dépenses publiques, la justice n’a droit qu’à 4 euros. 0,4 %, en clair. Et il s’agit pourtant d’une mission régalienne.
À quoi servent mes impôts
À quoi servent vos impôts ? Pas tant à financer la justice que ça.
Si Jean Castex veut faire émerger plus de civilité en ligne, sans saper les bénéfices réels que peut fournir le pseudonymat, c’est en donnant aux autorités judiciaires les outils pour agir vite et bien. Et les internautes seraient certainement moins enclins à se dépasser les bornes si les décisions de justice étaient prononcées en quelques heures ou quelques jours, en fonction du caractère d’urgence.
Le problème, c’est le sentiment d’impunité sur la toile parce que les décisions de justice arrivent trop tard par rapport à la commission des faits. Ce n’est pas le pseudonymat en tant quel le souci, mais bien l’enveloppe financière allouée à la justice. Appliquer la loi en lui accordant que 0,4 % sur 1000 euros de dépense publique, c’est laisser croire que l’on peut être intouchable sur le net.
Tout comme le personnel soignant n’a ni besoin d’applaudissements, de médailles, ni de parades aériennes, les autorités judiciaires n’ont pas besoin d’un empilement législatif toujours plus sévère pour réguler la haine en ligne. Ce dont elles ont besoin, c’est de moyens humains et judiciaires conséquents, sans avoir besoin ni de transférer leurs missions à des tiers privés, ni de nuire aux libertés des autres.
Après plusieurs années de combat, une loi vient de passer en France, autorisant la vente de semences paysannes à des jardiniers amateurs, selon une information révélée par France inter.
Désormais, les agriculteurs pourront vendre les semences issues de leur production. Une pratique ancestrale pourtant interdite depuis les années 1930. Jusque là les semences ne pouvaient être cédées que gratuitement.
Qu’est-ce donc les semences paysannes ?
Les semences paysannes c’est une pratique qui consiste pour un agriculteur à puiser une partie de ses graines dans sa récolte afin de replanter ensuite. Une pratique séculaire qui permettait aux agriculteurs de rester autonome financièrement. Logique aussi, on considérait que les semences étaient par nature le fruit du travail de l’agriculteur, rappelle France inter. Sauf que dans les années 1930 une loi établit que chaque nouvelle variété doit être inscrite au catalogue officiel pour être vendue, la semence tombe alors sous la protection réglementaire de la propriété des brevets, indique consoglobe.
Résultat, de grandes multinationales telles que Monsanto sont devenues leader sur le marché du "brevet" de la semence paysanne. En résumé, il s’agit de donner une "carte d’identité" en établissant une liste de critères d’homogénéité et de stabilité. Mais ce sont des critères qui ont été pensés pour les industries agroalimentaires. Les semences paysannes étant, par nature, ni stables, ni homogènes. Les paysans se sont retrouvés en situation de dépendance, obligés de racheter des semences puisque l’échange de semence était devenu illégal. Et des multinationales telles que Monsanto se sont retrouvées leader sur le marché, indique à nouveau France inter.
A travers ce procédé ce sont finalement près de "90% de variétés agricoles traditionnelles (qui) ne sont plus cultivées. La culture de semences paysannes permet aussi de lutter contre la standardisation des formes, des goûts et des saveurs", expliquait la députée Frédérique Tuffnell (LREM).
Un nouveau cadre légal
Désormais en France la vente de "semences traditionnelles ou nouvellement élaborées relevant du domaine public plus rares et garantes de la biodiversité", sera autorisée explique Barbara Pompili, présidente LREM de la commission développement durable à l’Assemblée nationale. C'est un combat qui dure depuis 2016.
Dans la pratique c’était déjà le cas, "il existait un usage amateur basé sur le don et l’échange de semences paysannes non inscrites au catalogue officiel", explique Mathieu Vidard, dans l’édito carré. Les jardiniers amateurs pouvaient donc déjà avoir accès à des semences paysannes, mais cette fois c’est officiel. "Un grand pas pour la biodiversité", annonce Barbara Pompili qui souhaite désormais se lancer dans la bataille d’un plan européen autorisant la commercialisation de ces semences au sein de l’agriculture.
Mercredi 22 janvier, la majorité LREM a adopté en seconde lecture la proposition de loi Avia visant soi-disant à lutter contre la haine sur internet. En juillet dernier, j’avais défendu une motion de rejet contre ce texte. En effet, derrière des intentions apparement louables, il ouvre la possibilité de pratiques dangereuses sur les réseaux sociaux, notamment la censure privée. Déjà, l’intervention des multinationales du numérique dans la vie politique est une réalité. En 2019, Facebook avait coupé la canal WhatsApp de Podemos en pleines élections générales en Espagne. En 2018, un changement dans l’algorithme de recherche de Google aux Etats-Unis avait pénalisé grossièrement les sites internet de gauche et anti-impérialistes.
Mais la seconde version de ce texte comporte une disposition plus grave encore. Le gouvernement a utilisé ce texte pour donner à la police un pouvoir arbitraire et absolu de censure sur internet. Et cela sans crier gare et en dernière minute ; il a proposé un amendement incroyable. Celui-ci oblige les plateformes numériques à retirer un contenu en moins d’une heure si la police française le demande au nom de la lutte anti-terroriste. Si elle ne le fait pas, la plateforme pourra être fermée administrativement. Evidemment, il revient entièrement à la police de déterminer ce qui est inclus dans la définition du « terrorisme ». On a l’habitude maintenant que ce prétexte soit utilisé pour réprimer des opposants sociaux et politiques. Les dispositions de l’état d’urgence avaient par exemple été largement utilisées pour maintenir assignés à résidence des militants écologistes et syndicalistes.
Avec cette nouvelle disposition adoptée en catimini, la police pourra très facilement faire fermer des sites internets alternatifs. En effet, pour pouvoir répondre en moins d’une heure à ses injonctions à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, il faut une équipe de modérateurs importante. Ce n’est souvent pas le cas pour des petits sites qui n’ont pas de but lucratif. Le régime rétablit donc une forme de censure royale, à travers laquelle le monarque peut du jour au lendemain faire fermer un journal. Tout le monde sait désormais que de tels abus seront vite monnaie courante.
Car sous Macron, l’utilisation de la police à des fins de répression politique est devenu la norme. 10 000 gilets jaunes ont été placés en garde à vue en un an, le plus souvent de manière arbitraire. Des avocats et un bâtonnier ont été arrêtés à l’occasion du mouvement contre la réforme des retraites. Les leaders syndicaux sont harcelés par d’interminables procédures judiciaires.
Comme souvent, le gouvernement a présenté cet amendement en pleine nuit, et sans en avoir parlé à personne avant. Il n’avait pas dévoilé cette intention lors du passage du texte en commission. Heureusement, les députés insoumis Danièle Obono et Alexis Corbière, présents pour étudier le texte ont immédiatement compris et se sont opposés à cet amendement. Les quelques macronistes présents, comme d’habitude, ont adopté sans y réfléchir. La proposition de loi doit encore revenir à l’Assemblée nationale pour son adoption définitive. Elle doit être combattue avec encore plus de force qu’avant. C’est de la défense des libertés publiques fondatrice de la République dont il est question désormais.
Est-on tous surveillés ? Le gouvernement veut mettre en place deux mesures qui vont dans ce sens. Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, aimerait bien que le fisc puisse surveiller les réseaux sociaux pour scruter votre train de vie. Quant au secrétaire d’État au numérique, Cédric O, il voudrait faciliter les expérimentations de reconnaissance faciale pour la vidéo-surveillance.
L’État s’immisce un peu trop dans nos vies privées. Quand on vous dit que Google lit vos mails, pour y détecter vos envies d’achats ou de voyages, que Facebook stocke tous vos échanges à jamais, est-ce plus choquant que lorsqu’on vous dit que l’État français veut aller espionner vos activités sur les réseaux sociaux et qu’il veut surveiller vos allers et venues partout ?
Dire les choses comme ça peut apparaître comme caricatural, totalement exagéré, mais rien de ce qui vient d'être décrit n’est aujourd’hui de la science-fiction. Que veut exactement autoriser le gouvernement ?
Industrialiser des contrôles fiscaux d'un nouveau genre
Concrètement, si vous postez des selfies au bord d’une piscine dans une grande villa alors que vous gagnez 1.000 euros par mois, c’est suspect. Avec des capacités de calculs toujours plus grandes et l’intelligence artificielle, on peut industrialiser ces contrôles fiscaux d’un nouveau genre. Ce n’est plus votre voisin qui vous dénonce, c’est vous-même, avec votre propre vie numérique.
Se dirige-t-on vers une surveillance généralisée ?
Le gouvernement voudrait aussi expérimenter une autre technologie en plein boom : la reconnaissance faciale. Pour s’identifier dans des démarches administratives, il suffit d’enregistrer votre visage. Comme toutes les innovations ça doit vous simplifier la vie sauf que derrière ça ouvre des questions vertigineuses notamment la possibilité d’une surveillance généralisée, à portée de technologie.
Le gouvernement voudrait aussi ouvrir un peu plus les expérimentations de reconnaissance faciale dans la vidéo surveillance. Si on possède votre profil, on peut vous identifier dans une foule ou dans les transports. Dans une ville comme Nice, qui détient le record de caméra au mètre carré, tous vos mouvements pourront être suivis en temps réel et enregistrés. Que vous soyez d’accord ou pas, honnête ou pas.
Quelles sont les raisons du gouvernement ?
La première raison est économique et stratégique. Nous avons des champions de la reconnaissance faciale comme Idemia, leader mondial de la biométrie inconnu du grand public, ou le groupe Thales. Leurs concurrents sont des entreprises chinoises. Cet argument de la compétitivité de nos entreprises est toujours un peu bizarre. Nos derniers champions de l’espionnage de masse ont vendu à des pays comme la Libye ou l’Égypte des moyens de surveillance pour traquer leurs opposants politiques. C’est une drôle de compétitivité.
La deuxième raison qui pousse le gouvernement à vouloir autoriser la reconnaissance faciale c’est la pression de la police et de la gendarmerie, qui rêvent à voix haute "d’un contrôle d’identité permanent et général." Circulez, on vous surveille sans rien vous demander.
Est-ce un progrès pour la sécurité ?
On ne passe pas d’une société de liberté à une société totalitaire forcément du jour au lendemain. Mais dans l’époque un peu agitée dans laquelle nous sommes, il faut faire attention et toujours penser à après-demain. Si on se rapproche d’un régime illibéral, comme on dit aujourd’hui, entre les mains de qui aurons-nous mis demain tous ces outils de fichage généralisé ultra puissants ? Le gouvernement a compris qu’il fallait en débattre. Est-ce pour limiter ces technologies ou les rendre acceptables ? C’est déjà un premier débat.
En novembre, la France veut lancer son dispositif ALICEM de reconnaissance faciale pour accéder eux services publics en ligne. Pour la Quadrature du net, mais aussi la CNIL, ce dispositif n’est pas compatible avec le règlement général sur les données personnelles. Nos libertés sont-elles en danger ? Martin Drago, juriste et membre de la Quadrature du Net, est l’invité de #LaMidinale.
Sur l’usage des technologies à reconnaissance faciale
« Il y en a déjà dans les aéroports et l y a eu une expérience lors du carnaval de Nice pendant trois jours - première expérimentation de reconnaissance faciale sur la voie publique ! La police peut accéder et faire de la reconnaissance faciale avec un fichier… et il y a cette expérimentation dans les lycées qui arrive. »
« Ce qui a motivé notre recours, c’est qu’il faut commencer à réfléchir à l’interdiction, voire à un moratoire sur le développement de cette technologie. »
Sur les motivations liées au développement de cette technologie
« On entend beaucoup, de la part de la gendarmerie et de la police, qu’on serait en train de perdre la course à l’armement par rapport à la Chine ou aux Etats-Unis et qu’il nous faut un champion français. »
« [La gendarmerie et la police] nous expliquent qu’on a déjà des champions français mais qu’ils ne peuvent pas expérimenter leur technologie en France et qu’ils doivent aller l’expérimenter dans des pays étrangers ou le cadre des libertés va être un peu moins stricte. »
« Ce qui motive ces expérimentations, c’est de faire de la France l’une des pionnières de ces technologies. »
Sur la fiabilité de ces technologies
« Un des premiers problèmes des dispositifs de reconnaissance faciale, c’est que ça ne marche pas très bien. Comme tous les dispositifs d’intelligence artificielle, il y a des biais. »
« Il faut aller au-delà de la critique de ces biais et s’interroger intrinsèquement sur la technologie elle-même : est-ce qu’elle n’est pas trop dangereuse pour exister ? »
« Que cette technologie marche ou pas ? On s’en fout, on n’en veut pas. »
Sur le projet ALICEM qui pourrait se déployer dès novembre en France
« ALICEM n’est pas une expérimentation, c’est un dispositif finalisé. »
« ALICEM sert à créer une identité numérique sur Internet pour accéder à certains services publics (…) et quand vous voulez créer cette identité numérique, vous êtes obligé de passer par un dispositif de reconnaissance faciale. »
« Pour l’instant, ça n’est que pour les gens qui disposent d’un téléphone Androïd et un passeport biométrique : il faut scanner avec le téléphone la puce du passeport biométrique et ensuite il faut prendre une vidéo de soi. »
« Le problème, c’est que le gouvernement nous explique que pour le faire, on a le consentement des gens (…), ce qui n’est pas le cas parce que vous êtes obligé de passer par un dispositif de reconnaissance faciale. »
Sur les dérives possibles du dispositif
« Le problème, c’est ce que veut faire le gouvernement des données liées à la reconnaissance faciale : le gouvernement ne respecte pas le RGPD [règlement général sur les données personnelles] sur cette notion de “consentement libre” car on ne peut pas contraindre les gens à utiliser leurs données personnelles. »
« Il y a le discours du gouvernement, notamment celui de Christophe Castaner qui fait le lien entre la haine, l’anonymat en ligne et le dispositif ALICEM. »
« Aujourd’hui, ALICEM n’est pas encore obligatoire pour tout le monde mais le risque c’est : que se passe-t-il demain ? »
« Avec ALICEM, la CNIL dit que le gouvernement ne respecter par le RGPD. Le gouvernement n’en a pas tenu compte et a publié le décret d’application ce qui nous a motivés à l’attaquer. »
Sur les libertés individuelles
« La reconnaissance faciale, telle qu’elle est voulue, c’est l’outil final de reconnaissance et de surveillance de masse dans la rue. »
« Contrairement l’ADN ou les empreintes, on sait quand on vous les prend. S’agissant du visage, on ne sait pas quand une caméra va vous repérer ou vous identifier. »
« C’est un dispositif qui peut être partout dans la rue et c’est une possibilité notamment dans le cadre des Jeux Olympiques de 2024 que le gouvernement voudrait mettre en place. »
« Ce dispositif a un effet énorme sur les libertés d’aller et venir, sur notre vie privée et aussi sur notre liberté d’expression et de manifester : si vous savez qu’en allant manifester, vous aller être identifié, vous n’allez peut-être pas manifester de la même façon. »
« Cette technologie est un normalisme : elle existe déjà sur certains téléphone portable et si vous l’utilisez pour accéder aux services publics ou pour entrer dans votre établissement scolaire, ça normalise la technologie et quand ça va arriver dans l’espace public, vous n’allez plus tellement réfléchir aux dangers pour les libertés. »
Sur l’acceptation sociale de cette technologie face à l’insécurité
« Le gouvernement va utiliser l’argument de la peur et du terrorisme pour pousser ces technologies. »
« On parle de reconnaissance faciale mais il y existe aussi une assemblée de nouveaux outils, de nouvelles technologies de surveillance qui se développent, comme la vidéo de surveillance intelligente - qui va repérer certains comportements dans la foule - ou des micros - comme à Saint-Etienne qui vont repérer certains bruits. »
« On a lancé le mouvement Technopolis qui permet de se renseigner, de bien comprendre ces technologies, de les analyser, de voir les dangers sur les libertés. »
« C’est pas parce qu’on est frappé par un attentat qu’on a envie d’avoir ces technologies. »
Sur le modèle chinois
« Il ne faut pas faire la comparaison avec le modèle chinois parce qu’en France, il se passe déjà des choses assez graves : la vidéo surveillance intelligente a déjà lieu à Valenciennes et à Toulouse. La reconnaissance faciale ainsi que des micros sont déjà en place dans certaines rues. »
« On a tendance à dire qu’en France, on n’en est pas encore comme en Chine. Alors que si, en France, il se passe des choses très graves. »
Que ce soit pour circuler, consommer ou accéder à des données, le visage sert de plus en plus de passeport. Or, la reconnaissance faciale ne s'arrête pas à l'authentification : elle peut aussi servir à contrôler les gens à distance et même à décrypter leur caractère ou leur orientation sexuelle. Une "inquisition" qui inquiète jusqu'aux chercheurs en I.A.
TROIS DATES CLÉS
3 nov. 2017
Apple sort un iPhone doté d'un système de reconnaissance faciale (Face ID) permettant de le déverrouiller, d'authentifier des achats, d'accéder à des applis… Cette fonction pose des questions de sécurité et de respect de la vie privée - notamment sur le lieu de stockage des visages numérisés…
14 mai 2019
Le conseil municipal de San Francisco vote l'interdiction de l'utilisation de la reconnaissance faciale dans ses rues par les forces de police. Motif : "La propension de cette technologie à mettre en danger les libertés civiles surpasse substantiellement ses bénéfices supposés. "
Sept. 2019
Deux lycées de la région Paca, Ampère à Marseille et Les Eucalyptus à Nice, filtrent désormais l'entrée des élèves avec un système d'authentification faciale - le consentement des parents étant nécessaire pour chaque élève. Une initiative très critiquée, qui fait l'objet de recours en justice.
626 millions
Le nombre de caméras de vidéosurveillance que devrait compter la Chine en 2020 - contre moins de 2 millions en France. Le marché chinois de la reconnaissance faciale croît de 20 % par an.
Lire la suite sur Science et vie
De l'authentification…
DANS LES SMARTPHONES, À LA DOUANE, À LA CAISSE…
Partout, la reconnaissance faciale est en train de remplacer - ou de compléter - nos codes secrets et nos empreintes digitales. Cette technique désormais très fiable nécessite le consentement de la personne… Mais il arrive parfois qu'aucune alternative ne soit proposée.
Seule l’erreur a besoin du soutien du gouvernement. La vérité peut se débrouiller toute seule.
—Thomas Jefferson, Notes on Virginia
Gouvernements du monde industriel, vous géants fatigués de chair et d’acier, je viens du Cyberespace, le nouveau domicile de l’esprit. Au nom du futur, je vous demande à vous du passé de nous laisser tranquilles. Vous n’êtes pas les bienvenus parmi nous. Vous n’avez pas de souveraineté où nous nous rassemblons.
Nous n’avons pas de gouvernement élu, et il est improbable que nous en ayons un jour, aussi je ne m’adresse à vous avec aucune autre autorité que celle avec laquelle la liberté s’exprime. Je déclare l’espace social global que nous construisons naturellement indépendant des tyrannies que vous cherchez à nous imposer. Vous n’avez aucun droit moral de dicter chez nous votre loi et vous ne possédez aucun moyen de nous contraindre que nous ayons à redouter.
Les gouvernements tiennent leur juste pouvoir du consentement de ceux qu’ils gouvernent. Vous n’avez ni sollicité ni reçu le nôtre. Nous ne vous avons pas invités. Vous ne nous connaissez pas, et vous ne connaissez pas notre monde. Le Cyberespace ne se situe pas dans vos frontières. Ne pensez pas que vous pouvez le construire, comme si c’était un projet de construction publique. Vous ne le pouvez pas. C’est un produit naturel, et il croît par notre action collective.
Vous n’avez pas participé à notre grande conversation, vous n’avez pas non plus créé la richesse de notre marché. Vous ne connaissez pas notre culture, notre éthique, ni les règles tacites qui suscitent plus d’ordre que ce qui pourrait être obtenu par aucune de vos ingérences.
Vous prétendez qu’il y a chez nous des problèmes que vous devez résoudre. Vous utilisez ce prétexte pour envahir notre enceinte. Beaucoup de ces problèmes n’existent pas. Où il y a des conflits réels, où des dommages sont injustement causés, nous les identifierons et les traiterons avec nos propres moyens. Nous sommes en train de former notre propre Contrat Social. Cette manière de gouverner émergera selon les conditions de notre monde, pas du vôtre. Notre monde est différent.
Le Cyberespace est fait de transactions, de relations, et de la pensée elle-même, formant comme une onde stationnaire dans la toile de nos communications. Notre monde est à la fois partout et nulle part, mais il n’est pas où vivent les corps.
Nous sommes en train de créer un monde où tous peuvent entrer sans privilège et sans être victimes de préjugés découlant de la race, du pouvoir économique, de la force militaire ou de la naissance.
Nous sommes en train de créer un monde où n’importe qui, n’importe où, peut exprimer ses croyances, aussi singulières qu’elles soient, sans peur d’être réduit au silence ou à la conformité.
Vos concepts légaux de propriété, d’expression, d’identité, de mouvement, de contexte, ne s’appliquent pas à nous. Ils sont basés sur la matière, et il n’y a pas ici de matière.
Nos identités n’ont pas de corps, c’est pourquoi, contrairement à ce qui se passe chez vous, il ne peut pas, chez nous, y avoir d’ordre accompagné de contrainte physique. Nous croyons que c’est de l’éthique, de la défense éclairée de l’intérêt propre et de l’intérêt commun, que notre ordre émergera. Nos identités peuvent être distribuées à travers beaucoup de vos juridictions. La seule loi que toute nos cultures constituantes pourraient reconnaître généralement est la règle d’or [« Ne fais pas aux autres ce que tu n’aimerais pas qu’ils te fassent », NdT]. Nous espérons pouvoir bâtir nos solutions particulières sur cette base. Mais nous ne pouvons pas accepter les solutions que vous tentez de nous imposer.
Aux Etats-Unis, vous avez aujourd’hui créé une loi, le Telecommunications Reform Act, qui répudie votre propre Constitution et insulte les rêves de Jefferson, Washington, Mill, Madison, Tocqueville et Brandeis. Ces rêves doivent maintenant renaître en nous.
Vous êtes terrifiés par vos propres enfants, parce qu’ils sont natifs dans un monde où vous serez toujours des immigrants. Parce que vous les craignez, vous confiez à vos bureaucraties les responsabilités de parents auxquelles vous êtes trop lâches pour faire face. Dans notre monde, tous les sentiments et expressions d’humanité, dégradants ou angéliques, font partie d’un monde unique, sans discontinuité, d’une conversation globale de bits. Nous ne pouvons pas séparer l’air qui étouffe de l’air où battent les ailes.
En Chine, en Allemagne, en France, à Singapour, en Italie et aux Etats-Unis, vous essayez de confiner le virus de la liberté en érigeant des postes de garde aux frontières du Cyberespace. Il se peut que ceux-ci contiennent la contagion quelque temps, mais ils ne fonctionneront pas dans un monde qui sera bientôt couvert de médias numériques.
Vos industries de plus en plus obsolètes se perpétueraient en proposant des lois, en Amérique et ailleurs, qui prétendent décider de la parole elle-même dans le monde entier… Ces lois déclareraient que les idées sont un produit industriel comme un autre, pas plus noble que de la fonte brute… Dans notre monde, quoi que l’esprit humain crée peut être reproduit et distribué à l’infini pour un coût nul. L’acheminement global de la pensée n’a plus besoin de vos usines.
Ces mesures de plus en plus hostiles et coloniales nous placent dans la même situation que ces amoureux de la liberté et de l’autodétermination qui durent rejeter les autorités de pouvoirs éloignés et mal informés. Nous devons déclarer nos personnalités virtuelles exemptes de votre souveraineté, même lorsque nous continuons à accepter votre loi pour ce qui est de notre corps. Nous nous répandrons à travers la planète de façon à ce que personne puisse stopper nos pensées.
Nous créerons une civilisation de l’esprit dans le Cyberespace. Puisse-t-elle être plus humaine et plus juste que le monde issu de vos gouvernements.
Davos, Suisse
8 février 1996
Mural in downtown Las Vegas by British artist Izaac Zevalking meant to draw attention to America’s founding by immigrants.
Edward Helmore ed 14 Aug 2019 14.42 BST
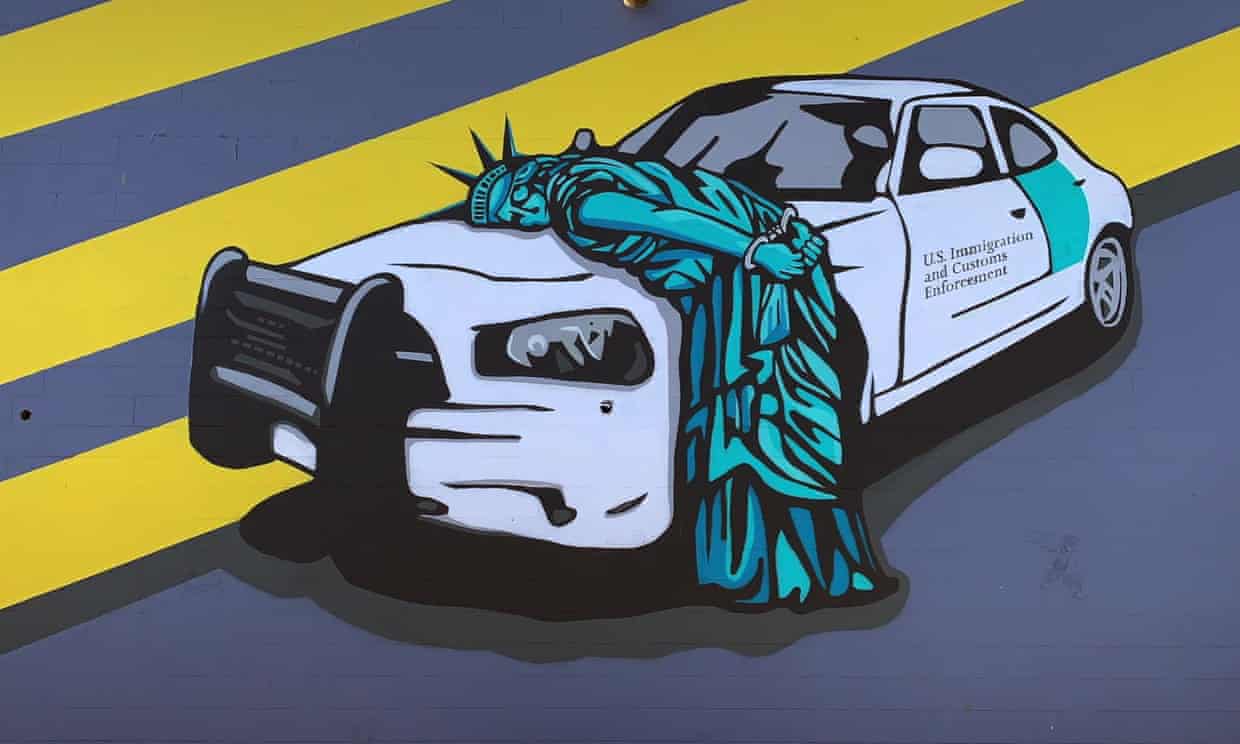
A mural of the Statue of Liberty, handcuffed and slammed on the hood of a police cruiser, is drawing attention in downtown Las Vegas, a day after a top Trump administration official in charge of immigration suggested the statue’s famous inscription be amended to include a test of means.
Under the pseudonym Recycled Propaganda, artist and British immigrant Izaac Zevalking painted the image on a wall late last month, before citizenship and immigration services director Ken Cuccinelli – jokingly – suggested amending Emma Lazarus’s sonnet inscribed on the statue to read: “Give me your tired and your poor who can stand on their own two feet and who will not become a public charge.”
Zevalking told Las Vegas station KTNV: “My purpose of doing what I did with the Statue of Liberty is to try and draw analogies with America’s past and how it was founded and how it was largely built by immigrants, to really make an analogy out of that so that people can apply that to contemporary society and contemporary issues a little bit more.”
Since Cuccinelli made his suggestion to NPR, administration officials have sought to play down its significance.
The White House adviser Stephen Miller said he wouldn’t “get off into a whole thing about history here”. But he added: “The Statue of Liberty is a symbol of American liberty lighting the world. The poem that you’re referring to was added later and is not actually part of the original Statue of Liberty.”
Still, the exchange underscores the change last week in administration policy toward immigrants applying for permanent residency status or green card. Under the new rules, immigration services will be able to reject applicants who have spent more than a year on food stamps, Medicaid or other public benefits.
Asked which immigrants will now be welcome to the US, Cuccinelli said: “All immigrants who can stand on their own two feet, self-sufficient, pull themselves up by their boot straps – as in the American tradition.”
But critics of the rule fear it will be used to prevent poorer immigrants from ever setting foot in the US.
“Aliens will be barred from entering the United States if they are found likely to become public charges,” revealed a White House fact sheet. “Aliens in the United States who are found likely to become public charges will also be barred from adjusting their immigration status.”
The Migration Policy Institute estimated the change could result in more than half of all family-based green card applicants being denied. About 800,000 green cards were issued in 2016.
À Londres, en Angleterre, un homme a été arrêté après avoir tenté d'échapper aux caméras de reconnaissance faciale. La police avait pourtant indiqué dans un communiqué que "quiconque refusera d'être scanné ne sera pas nécessairement considéré comme suspect".
L'homme en question se serait couvert le visage lorsqu'il passait devant les caméras déployées par la ville, rapporte le journal britannique The Independant. Alerté par un homme qui avait vu des pancartes avertissant le public que des caméras les filmaient, il aurait alors relevé le haut de son pull afin de camoufler son identité. Arrêté par la police, il a été condamné à payer une amende de 90 livres, soit un peu plus de 100 euros.
Selon un porte-parole de la police, "des policiers ont arrêté un homme soupçonné d’agir dans le centre-ville de Romford lors du déploiement de la technologie de reconnaissance faciale. Après avoir été arrêté, l’homme est devenu agressif et a menacé les agents. En conséquence, un avis de pénalité pour désordre public lui a été délivré".
Considérant que la reconnaissance faciale était une atteinte à la liberté individuelle et la vie privée des gens, certaines villes ont décidé de la bannir. C'est le cas de San Francisco, première ville d'Amérique du Nord, à interdire à la police et autres agences gouvernementales de se servir de ce système. Le Conseil municipal entend ainsi garantir les droits civils des habitants.
Le Défenseur des droits s'inquiète d'un "affaissement" des libertés dans son rapport annuel.
FRANCE - Des étrangers aux gilets jaunes en passant par la lutte antiterroriste, le Défenseur des droits pointe un "renforcement (...) de la répression" en France et s'inquiète d'un "affaissement" des libertés inspiré par l'état d'urgence de 2015, selon son rapport annuel publié ce mardi 12 mars.
"En France, (...) s'est implantée une politique de renforcement de la sécurité et de la répression face à la menace terroriste, aux troubles sociaux et à la crainte d'une crise migratoire alimentée par le repli sur soi", pointe cette autorité indépendante chargée notamment de défendre les citoyens face à l'administration. "Nous sommes dans un pays crispé", dit-il aussi dans une interview au Parisien.
Dans son rapport 2018, qui couvre la période d'éclosion du mouvement des gilets jaunes, l'institution présidée par l'ancien ministre de droite Jacques Toubon s'interroge notamment sur "le nombre 'jamais vu' d'interpellations et de gardes à vue intervenues 'de manière préventive'" lors de certaines manifestations.
Selon ce document, les directives des autorités pour gérer la contestation sociale "semblent s'inscrire dans la continuité des mesures de l'état d'urgence", décrété après les attentats du 13 novembre 2015.
Ce régime d'exception, resté en vigueur pendant deux ans et dont certaines dispositions ont été conservées dans la loi, a agi comme une "pilule empoisonnée" venue "contaminer progressivement le droit commun, fragilisant l'État de droit", estime le rapport.
"Un nouvel ordre juridique, fondé sur la suspicion"
Pour le Défenseur, il a "contribué à poser les bases d'un nouvel ordre juridique, fondé sur la suspicion, au sein duquel les droits et libertés fondamentales connaissent une certaine forme d'affaissement".
Cette logique sécuritaire imprègne également le droit des étrangers, selon le rapport du Défenseur qui estime que la France mène "une politique essentiellement fondée sur la 'police des étrangers', reflétant une forme de 'criminalisation des migrations'".
En 2018, ce sont toutefois les réclamations liées aux services publics qui ont le plus occupé le Défenseur des droits: elles représentent 93% des dossiers traités par une institution toujours plus sollicitée. Avec 96.000 dossiers en 2018, le Défenseur des droits a vu les réclamations augmenter de 6,1% en un an.
Retards dans le versement de certaines retraites, suppression du guichet dans les préfectures pour délivrer le permis de conduire, "déserts médicaux"... Le rapport s'alarme d'un "repli des services publics".
Un tableau noir que le Défenseur relie au ras-le-bol fiscal exprimé par les gilets jaunes. Selon lui, "en s'effaçant peu à peu, les services publics qui, en France, constituent un élément essentiel du consentement à l'impôt, hypothèquent la redistribution des richesses et le sentiment de solidarité, sapant progressivement la cohésion sociale".

