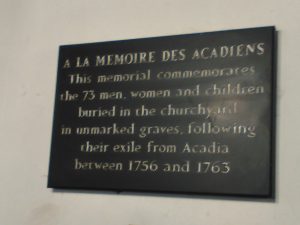La revue de web de Kat
Historique du canton d’Entremont : toponyme et son origine au Québec
Le canton inhabité d’Entremont, de forme rectangulaire, se situe dans la réserve faunique La Vérendrye, en Abitibi-Témiscamingue, un peu au nord du lac Cocôwan, une des composantes du réservoir Dozoi, et à environ 20 km à l’est de la baie Kawastaguta du Grand lac Victoria. Son territoire, au relief plutôt accidenté, contient bon nombre de petits plans d’eau, dont le lac Tesserie. Il est également irrigué par deux rivières importantes, la Canimiti et la Chochoucouane, qui créent un confluent au centre du territoire. Depuis le 20 décembre 1955, il porte le nom d’un gentilhomme normand, Philippe Moius d’Entremont, dont les origines se trouveraient toutefois en Savoie. Les titres de noblesse de la famille d’Entremont, ayant émigré en Normandie au XVIe siècle, remonteraient, selon certains, au XIe siècle. D’autres affirment cependant que c’est Louis XIV (1638-1715) qui fit de Philippe Mius le sieur d’Entremont. Quoi qu’il en soit, il existe aujourd’hui en France deux communes appelées Entremont, et toutes deux se trouvent dans l’ancienne province de Savoie, définitivement incorporée à la France en 1860 ; les deux tiennent leur nom de leur situation géographique entre de hautes montagnes. L’une d’entre elles, à 791 m d’altitude au cœur des Alpe françaises, s’étend sur le Borne, dans le département de la Haute-Savoie, à quelque 25 km au nord-est d’Annecy, et à environ 40 km au sud-est de Genève, en Suisse. Les touristes y découvriront notamment les ruines d’un monastère du XIIe siècle, érigé en Abbaye en 1154 mais supprimé en 1772, ainsi qu’une église, construite également au XIIe siècle, mais profondément modifiée jusqu’au XIXe siècle.
L’autre commune, Entremont-le-Vieux, sise à 840 mètres d’altitude, se situe sur le Cozon, dans la partie ouest de la Savoie, à une quinzaine de kilomètres au sud de Chambéry, préfecture de département. Là, on peut y voir les ruines d’un château. Le sieur d’Entremont naquit vers 1609, probablement à Cherbourg, en Normandie. En 1650 ou 1651, il fut amené en Acadie par son ami, le nouveau gouverneur Charles de Saint-Étienne de La Tour, comme lieutenant-major et commandant des troupes du roi. Deux ou trois ans plus tard, Entremont reçut, en récompense pour ses services, le fief Pobomcoup (aujourd’hui Pubnico, en Nouvelle-Écosse) à titre de baronnie.
Il assuma plusieurs fonctions dans la colonie, devenant même, vers 1670, procureur du roi, puis il s’occupa du développement des terres qui lui avaient été attribuées. Il mourut en Acadie au début du XVIIIe siècle. Sa descendance demeure nombreuse en Nouvelle-Écosse, et tout particulièrement, à Pubnico.
Au Québec, en plus d’un canton, le toponyme Entremont désigne un lac, situé précisément dans le canton d’Entremont, sur le cours de la rivière Canimiti, et des voies de circulation, à Sainte-Foy, Saint-Marc-des-Carrières et Amos.
Entremont
Proclamé en 1966, le canton d’Entremont est situé au nord du réservoir Dozois, dans la réserve faunique La Vérendrye. Ce canton de présente comme un ensemble hydrographique compliqué où l’on distingue à peine la rivière Chochoucouane et la rivière Canimiti, au sein de très nombreuses étendues d’eau. Son relief, accidenté et brisé, varie entre 350 et 537 mètres d’altitude. En dénommant ainsi cette unité géographique en 1955, on a voulu honorer la mémoire du Normand Philippe Mius ou Muis (né vers 1609 et mort vers 1700). En 1650 ou 1651, il est amené en Acadie par le nouveau gouverneur Charles de Saint-Étienne de La Tour comme lieutenant-major et commandant des troupes du roi. Deux ou trois ans plus tard, il reçoit en récompense le fief Pobomcoup (Pubnico, Nouvelle-Écosse), à titre de baronnie, et y construit son château. Cette baronnie est demeurée un bien familial jusqu’à la dispersion des Acadiens, en 1755. Les descendants qui portent ce nom d’Entremont sont encore nombreux.
Noms et lieux du Québec, ouvrage de la Commission de toponymie paru en 1994 et 1996 sous la forme d’un dictionnaire illustré imprimé, et sous celle d’un cédérom réalisé par la société Micro-Intel, en 1997, à partir de ce dictionnaire.
(Source : La France et le Québec. Des noms de lieux en partage. Commission de toponymie du Québec, les Publications du Québec, l’Association française pour l’information géographique, 1999).
A small plaque in St Gluvias church, Penryn, reads:
A LA MEMOIRE DES ACADIENS This memorial commemorates the 73 men, women and children buried in the churchyard in unmarked graves, following their exile from Acadia between 1756 and 1763
This is the only indication of the presence of a group of Acadians who were housed on the outskirts of the town in the mid C18.
Who were the Acadians?
(The British spelling is Acadians. The French use Acadiens or Acadiennes)
The Acadians were a group of French Catholic settlers of the early C17 who became caught up in the struggle between France and Britain for control of Canada, a conflict that started around 1688 and ended with the fall of Montreal in 1760.
They founded a colony in the Nova Scotia/New Brunswick area, bordering the British province of Maine, which they called Acadia. It appears that they established good relations with the indigenous peoples with some inter-marriage.
The Acadian capital of Port Royal fell in 1710 but much of Acadia remained under French control. After each territorial advance, the British invited the Acadians to swear unconditional oaths of allegiance to the British crown: an offer many refused because of their Catholic faith and ancestry.
The Acadian expulsions
Although many Acadians were neutral, others continued to work for the French and, with members of the Wabanaki Confederacy indigenous communities, raided British-held territory. Finally, the British lost patience and decided to expel the Acadians where they could.
There were two waves of expulsion. Together they are called the Great Upheaval, the Great Expulsion, or the Great Deportation.
The first wave came after the successful 1745 siege of the strategic port of Louisbourg. Under the Treaty of Aix-la-Chapelle (1748) at the end of the War of Austrian Succession, Louisbourg was handed back to the French in exchange for Madras.
Different sources quoting different figures but it seems that between six and seven thousand Acadians were expelled from Nova Scotia to American colonies and Britain in the first wave. Some 1,226 Acadians survived the ocean crossing to Britain in 1755, being separated into four groups: 336 (243) were sent to Liverpool; 340 to Southampton (Portsmouth); 300 to Bristol; 250 (220/204) to Falmouth. (The sources vary quite markedly on the numbers)
Falmouth, June 17: arriv’d, the Fanny, (Captained by) Bovey, from Virginia, with 204 Neutral French on board, being sent by the Governor of Virginia, he apprehending they would go and join their Countrymen and the Indians in their Interest.
Boston Evening Post, September 20, 1756
Many Acadians who were sent to Britain were housed in crowded warehouses and subject to plagues due to the close conditions, while others were allowed to join communities and live normal lives. They received a small payment each day and were treated as if they were prisoners of war.
The Falmouth/Penryn contingent was housed in a large barn at Upper Kergilliac Farm on the edge of Penryn. This had been used to hold prisoners of war a few years earlier during the War of the Austrian Succession (1740-1748). These Acadians are the ones commemorated on the plaque in St Gluvias church.
The north and west view of the L-shaped barn at Upper Kergilliac Farm on the outskirts of Penryn and Falmouth. Could these be the barn in which the Acadians were held? They seem very modest.


The second wave of expulsions
The second wave of expulsions came after the 1758 siege of Louisbourg which was more decisive and was followed by the advance on Quebec and Montreal. In this wave the Acadians were deported to France and Britain.
The sinking of the Duke William
Almost 1,000 Acadians died on their way to France when the transport ships Duke William, Violet, and Ruby sank in 1758. So significant was the sinking of the Duke William that the date of its sinking, 13 December, became the Acadian Remembrance Day.
On board was Noël Doiron (1684–1758), a regional leader. He was widely celebrated and places have been named after him in Nova Scotia.
The rather self-serving account of Captain Nicholls, the Commander of the Duke William survives in an account which was published in the Naval Chronicle of 1807. He deserted the sinking ship and managed to make his way to Penzance.
The fate of the deported Acadians
In 1763, the Treaty of Paris brought an end to the Anglo-French struggles of the Seven Years’ War. Canada was to be under British control. The Acadians were at last free to move around.
After 1764, they were allowed to return in small isolated groups to British territories in Canada provided that they took an unqualified oath of allegiance. A significant number migrated to Spanish Louisiana, where their name was Anglicised to ‘Cajuns’. Others returned to France, particularly Belle-Île-en-Mer off the western coast of Brittany.
By January 1763, after seven years in exile, only about 866 of the 1,266 Acadians originally deported to Britain had survived. Some 159 people, the remnants of the Falmouth/Penryn contingent, sailed for France on La Fauvette sent by King Louis XV to Falmouth.
Très prolifiques et résilients face à l'adversité, les pionniers acadiens ont aujourd'hui une très vaste descendance : nous serions environ 3 millions, parmi lesquels de nombreuses personnes connues...
J'ai déjà évoqué Matt LEBLANC. Je me contenterai de quelques autres exemples.
En 1785, l'un des Acadiens passés par la Virginie, l'Angleterre, Morlaix et Belle-Isle, Joachim TRAHAN, tout juste veuf de Marie DUON, embarque à Nantes avec ses quatre enfants sur le Saint Rémi qui part pour la Louisiane. Il s'installe à Saint Martinville, et son fils Auguste, âgé de 7 ans quand il quitte la France, va s'y marier en 1793, et mourra à 33 ans, sans savoir qu'une de ses futures petites-filles, Marie Virginie TRAHAN, connaîtra une vie incroyable, épousant tout d'abord Claude Vincent de TERNANT, héritier d'une plantation près du Mississipi. A la mort de son mari, elle se remarie avec le colonel Charles PARLANGE, qui donnera son nom à ladite plantation, puis, devenue de nouveau veuve, elle défendra grâce à son charme et sa diplomatie sa terre et sa demeure pendant la guerre de Sécession.Cette plantation existe toujours et est tenue aujourd'hui par les descendants de Marie-Virginie, qui deviendra dans les années 70 l'une des héroïnes de la série de romans de Maurice Denuzière intitulée Louisiane - Fausse-Rivière - Bagatelle, sous le nom de Virginie TREGAN.
Une petite-fille de Marie Virginie, Virginie Amélie AVEGNO GAUTREAU, née en 1859 à La Nouvelle Orléans, deviendra une personnalité bien connue du Tout-Paris de la fin 19°-début 20°. Son portrait, exécuté par John Singer Sargent et intitulé Portrait de Madame X, est aujourd'hui exposé au Metropolitan Museum of Art in New York City. Elle est également un personnage des romans de Denuzière.
Virginie TRAHAN et Virginie AVEGNO, devenues héroïnes de romans, inattendues descendantes du maréchal de tranchant de Bourgueil, du passementier transfuge, et de l'un des malheureux déportés errants de Virginie en Angleterre, partis plein d'espoir de Belle-Isle-en-Mer pour se créer une nouvelle vie en Louisiane...
Dans un tout autre genre, le lexicographe Paul ROBERT, l'auteur du fameux dictionnaire, oui oui!, avait des origines acadiennes par sa branche maternelle, et nous partageons nos ancêtres BOUDROT, BOURG, LANDRY, BOURGEOIS...
Mais on retrouve également Jean CHRETIEN, premier ministre du Canada de 1993 à 2003, Pierre Elliott TRUDEAU, également ancien premier ministre du Canada, et logiquement le fils de celui-ci, Justin TRUDEAU, premier ministre actuel (depuis 2005).
Justin TRUDEAU était d'ailleurs présent au Tintamarre de 2019 à Dieppe, au Nouveau Brunswick. Le Tintamarre est une manifestation de la fierté acadienne qui a lieu le 15 août (date de la fête "nationale" acadienne) : il s'agit d'un défilé aux couleurs de l'Acadie dans lequel on fait le plus de bruit possible pour rappeler au monde la présence et la vitalité des Acadiens.
Et enfin, peut-être la "cousine" la plus inattendue : Beyoncé !
En effet, Gisèle BEYONCE est l'arrière-petite-fille d'Odilia BROUSSARD (patronyme bien acadien), elle-même arrière-petite-fille de Marie-Françoise TRAHAN, née à ... Belle Isle en Mer, paroisse de Bangor, le 17 janvier 1774!!!
Et Marie Françoise était l'une des filles de Pierre TRAHAN et Marguerite DUON, Marguerite elle-même nièce de "mon" Cyprien... Quant à Pierre, je n'ai pas creusé le détail, mais c'est forcément un descendant de "'mon" Guillaume...
Pierre et Marguerite, mariés le 9 mai 1758 à Liverpool puis installés à Belle Isle, embarquèrent en 1785 avec leurs enfants - dont la petite Marie Françoise âgée de 11 ans et demi - en direction de la Louisiane sur Le Saint Rémi, et arrivèrent à la Nouvelle Orléans le 10 septembre. (Sur le bateau se trouvait également Joachim TRAHAN, cité plus haut, l'arrière grand-père de la future propriétaire de la Plantation Parlange).
En tout cas, connu ou inconnu, pour l'instant je n'ai trouvé aucun descendant d'Acadien avec lequel je ne cousine pas (lointainement) d'une façon ou d'une autre.
Voici venu le moment d'aborder la Déportation, ce grand traumatisme historique qu'un sens aigu de la litote amena les Acadiens à appeler pudiquement "le Grand Dérangement"...
En 1713, par le traité d'Utrecht, les Français avaient perdu Terre-Neuve, la baie d'Hudson et la presqu'île de l'Acadie (qui devenait la Nouvelle-Ecosse -Nova Scotia-), dont les frontières étaient toutefois restées floues. Ils avaient conservé l'Ile Royale (aujourd'hui Cap-Breton) et les rives du Saint-Laurent.
Après le Traité d'Aix la Chapelle, en 1748, les britanniques, soucieux de garantir leur main-mise sur la Nouvelle-Écosse, y envoyèrent 2 500 colons et fondèrent le port de Halifax, sur la côte sud. Par ailleurs, depuis le traité d'Utrecht, ils avaient exigé des Acadiens un serment d'allégeance à la couronne d'Angleterre. La plupart l'avaient signé, mais en exigeant de pouvoir rester catholiques et de ne pas avoir à combattre les Français. Ils revendiquaient le statut de "Français Neutres".
Les Anglais n'ayant aucune confiance dans les Acadiens malgré le serment envisageaient régulièrement de s'en débarrasser. Sans compter que s'emparer de leurs bonnes terres serait un bonus appréciable. Mettant fin à des décennies de tergiversations, en 1755, Charles Lawrence, lieutenant-gouverneur de Nouvelle Écosse, prit l'initiative de les déporter. Londres n'avait pas donné l'ordre d' expulsion, mais Lawrence ne fut pas désavoué.
Après plusieurs semaines de préparatifs secrets, et l'arrestation de divers Acadiens à certains endroits, le lieutenant-colonel John Winslow, accompagné de 313 soldats britanniques, arriva par bateau le 20 août dans le bassin des Mines. Il se rendit à l'église Saint-Charles et s'y installa, après avoir fait enlever les objets de culte par quelques habitants. Le 21, les soldats construisirent une palissade autour de leur camp, puis une autre le 30 autour du cimetière.
Entre le 31 août et le 2 septembre, Winslow et ses hommes visitèrent les différents hameaux et villages des Mines. Ils observèrent que la moisson était en train de se terminer. Les Acadiens, habitués à la présence anglaise, poursuivaient leurs travaux. Winslow rédigea une proclamation qui leur fut signifiée le 4 septembre :
« Aux habitants du district de la Grand-Prée, rivière des Mines, rivière aux Canards, etc., [...] j’ordonne [...] à tous les habitants, y compris les vieillards, les jeunes gens ainsi que ceux âgés de dix ans, [...] de se réunir à l’église de la Grand-Prée, le vendredi, 5 courant à trois heures de l’après-midi, afin de leur faire part des instructions que nous sommes chargés de leur communiquer. [...] aucune excuse, de quelque nature qu’elle soit, ne sera acceptée et que le défaut d’obéissance aux ordres ci-dessus entraînera la confiscation des biens et effets."
Le capitaine Murray adressa une sommation équivalente aux habitants de Piziquid et alentours.
Le lendemain, vendredi 5 septembre, les hommes et garçons âgés de plus de dix ans de tous les villages des Mines - Grand-Pré, Habitants, Canard, Gaspereau...-, soit 418 personnes, se rendirent donc à l'église. Les soldats britanniques fermérent aussitôt les portes, et Winslow fit lire par un interprète la déclaration suivante :
Journal de Winslow p 178
« Messieurs,
J'ai reçu de Son Excellence le gouverneur Lawrence les instructions du Roi1 que je tiens en main. [...] Le devoir qui m'incombe, quoique nécessaire, est très désagréable à ma nature et à mon caractère, de même qu'il doit vous être pénible[...]
Je vous communique donc, sans hésitation, les ordres et instructions de Sa Majesté, à savoir que toutes vos terres et habitations, bétail de toute sorte et cheptel de toute nature, sont confisqués par la Couronne, ainsi que tous vos autres biens, sauf votre argent et vos meubles, et vous devez être vous-mêmes enlevés de cette Province qui lui appartient. C'est l'ordre péremptoire de Sa Majesté que tous les habitants français de ces régions soient déportés. [...] je veillerai aussi à ce que les familles s'embarquent au complet dans le même vaisseau [..] et j'espère qu'en quelque partie du monde que vous puissiez vous trouver, vous serez de fidèles sujets, un peuple paisible et heureux2. Je dois aussi vous informer que c'est le bon plaisir de Sa Majesté que vous restiez en sécurité sous la surveillance et la direction des troupes que j'ai l'honneur de commander et ainsi je vous déclare prisonniers du roi. »
Le 15 septembre, Winslow établit la liste des Acadiens emprisonnés dans l’église de Saint-Charles, liste dont+ l'original se trouve aujourd'hui à Boston, et dont on peut voir un fac-similé au Musée de Grand’Pré. On y trouve les noms des habitants français de Grand’Pré, Rivière des Mines, Habitant, Rivière-aux-Canards, le nombre de leurs enfants, et le détail de leur bétail.
Expulser des milliers de personnes demandait une lourde logistique. Il fallut attendre plusieurs semaines l'arrivée progressive de tous les bateaux nécessaires pour transporter les habitants des paroisses Saint Charles de Grand-Pré, Saint-Joseph de la Rivière aux Canards, Sainte-Famille et Assomption de Piziquid. Les femmes et les enfants furent chargés de fournir la nourriture aux prisonniers. Pour empêcher que les habitants qui avaient pu s'enfuir ne puissent revenir s'installer après le départ de la flotte, Winslow fit brûler les hameaux et les champs3. A Beaubassin au fond de la baie Française et à Port Royal sur la rivière Dauphin, la situation des acadiens était la même... (Deux ans plus tard, un officier britannique décrivit les villages acadiens de Port Royal en ruines et les poiriers et pommiers abandonnés croulant sous le poids des fruits...)
Le 10 septembre, Winslow note dans son journal :
« J'ai remarqué ce matin une agitation inaccoutumée qui me cause de l'inquiétude. J'ai réuni mes officiers, il fut décidé à l'unanimité de séparer les prisonniers... Nous avons convenu de faire monter 50 prisonniers sur chacun des cinq vaisseaux arrivés de Boston et de commencer par les jeunes gens. [...] Selon mes ordres, tous les habitants français furent rassemblés, les jeunes gens à gauche. J'ordonnai au capitaine Adams, aidé d'un lieutenant et de 80 officiers et soldats, de faire sortir des rangs 141 jeunes hommes et de les escorter jusqu'aux transports. J'ordonnai aux prisonniers de marcher. Tous répondirent qu'ils ne partiraient pas sans leurs pères. [...] J'ordonnai alors à toute la troupe de mettre la baïonnette au canon et de s'avancer sur les Français. [...] Ils s'avançaient en priant, en chantant, en se lamentant et sur tout le parcours d'un mile et demi, les femmes et les enfants venus au-devant d'eux, priaient à genoux et pleuraient à chaudes larmes. J'ordonnai ensuite à ceux qui restaient de choisir parmi eux 109 hommes mariés qui devaient être embarqués après les jeunes gens [...] Ainsi se termina cette pénible tâche qui donna lieu à des scènes navrantes...»
Les familles de Grand-Pré commencèrent à embarquer à leur tour le 8 octobre. Elles le firent, note Winslow, "à contrecœur, les femmes en grande détresse emportant leurs enfants dans leurs bras. D'autres portant leurs parents décrépits dans leurs charrettes et tous leurs biens. Se déplaçant dans une grande confusion [...] scène de malheur et de détresse5."
C'est dans ce contexte que mourut le vieux Jacques LEBLANC (mon sosa 1232), alors âgé de 75 ans, petit-fils de Daniel le pionnier et de Françoise GAUDET par leur fils René, certainement terrassé de chagrin alors que ses frères et sœurs, ses 13 enfants, ses nombreux petits-enfants et petits-neveux, étaient sommés de monter à bord de bateaux différents, avant d'être éparpillés sur des milliers de kilomètres. Car malgré la promesse de Winslow, dans la confusion des embarquements, bien des familles se retrouvèrent séparées, et les milliers d'Acadiens expulsés de leurs terres de Grand-Pré, Piziquid, Beaubassin ou Port Royal, furent envoyés vers différentes colonies de la Nouvelle Angleterre : Massachussetts, Pennsylvanie, Virginie, Caroline du Nord, Connecticut, Maryland... L'objectif de Lawrence était non seulement d'expulser les Acadiens de Nouvelle Écosse, mais également de les disperser, pour les empêcher de se regrouper et de reconstruire leurs communautés.
Le cas des enfants de Jean Baptiste DUON (sosa 624) et Agnès HEBERT (S 625) de Port Royal illustre bien cet éparpillement :
Agnès, veuve depuis 1746, avait 59 ans lors du Grand Dérangement, 11 enfants âgés de 16 à 40 ans, et un certain nombre de petits-enfants. Elle se retrouva brutalement et définitivement séparée de toute sa famille, excepté son fils Louis Basile, 27 ans, et sa plus jeune fille, Rosalie, 16 ans, transportés comme elle à New York.
Lorsque les rafles avaient commencé à Port-Royal, ses fils Honoré, 38 ans, Charles, 21 ans, et Claude,18 ans, étaient parvenus à s'enfuir dans les bois (où ils survécurent dans des conditions terribles de famine et de maladie avec des centaines d'autres acadiens en fuite pendant quelques années, avant d'être repris et emprisonnés par les Anglais).
Agnès vit ses autres enfants embarqués sur des bateaux qui allaient partir :
- pour la Virginie, avec l'aîné, Jean Baptiste, 40 ans, Pierre, 35 ans, Euphroisine, 30 ans, et Cyprien (sosa 312), 25 ans
-
pour Boston : avec Jeanne, 36 ans, et Abel, 32 ans
Pourtant, ceci n'était que le début d'une dispersion qui allait mener les enfants et petits-enfants d'Agnès bien plus loin encore (Québec, Louisiane, Angleterre, Martinique, France, etc...), et elle ne les revit jamais...
Les départs vers l'exil s'échelonnèrent de fin octobre au 20 décembre, et le voyage fut effroyable. Il faut dire que les bateaux affrétés n'étaient pas du tout adaptés à des passagers humains; la plupart servaient normalement au transport de bétail ou de marchandises, et malgré quelques modifications en prévision de la déportation, ils ne permettaient pas aux prisonniers de se tenir debout. De plus, l'air était irrespirable et vicié dans les cales surchargées de passagers (les capitaines britanniques étant rémunérés à la quantité d'acadiens embarqués n'avaient donc pas hésité à enfreindre les règlementations de l'époque), et la nourriture insuffisante. La maladie, le manque d'hygiène, la malnutrition et le désespoir firent des ravages. D'autant que si l'embarquement avait commencé le 10 septembre, les bateaux tardèrent des semaines avant de prendre la mer, et certains prisonniers y passèrent donc plusieurs mois 4.
Pour aggraver encore la détresse des déportés, la flotte partie fin octobre essuya une grosse tempête peu après le départ, obligeant certains bâtiments à faire relâche à Boston, le temps de réparer les avaries. Les autorités locales qui montèrent inspecter les bâtiments constatèrent la surpopulation, la présence de malades et le manque de provisions, ce qui n'empêcha pas les bateaux de reprendre leur route vers le sud...
Ce furent donc des prisonniers épuisés, affaiblis, souvent malades, qui arrivèrent à leurs destinations au fil des mois. Un certain nombre étaient morts pendant le voyage. D'autres moururent peu après l'arrivée, comme à Philadelphie où, sur les 454 acadiens débarqués en novembre, 237 furent rapidement emportés par la variole.
Les Anglais n'avaient pas pris la peine d'avertir leurs colonies de Nouvelle Angleterre de l'envoi de ces prisonniers. Les capitaines des navires étaient simplement chargés de remettre une lettre explicative aux autorités locales en débarquant... L'arrivée soudaine de ces exilés faméliques, malades, en haillons, étrangers et d'une autre religion (catholiques et considérés comme plus français que neutres), fut donc vue d'un très mauvais œil. Dans plusieurs colonies, on tergiversa des jours voire des semaines avant de les autoriser à débarquer, les laissant souffrir encore de la faim et du froid (novembre/décembre en Amérique du Nord...), toujours entassés sur les bateaux...
- Entre la fin novembre et le 4 décembre, 4 bâtiments chargés de 900 Acadiens arrivèrent au Maryland. Une fois répartis dans différents villages de l'intérieur, il leur fut interdit de quitter la colonie.
Parmi ces malheureux passagers se trouvaient :
-
Marie Josèphe LEBLANC, 50 ans, fille du vieux Jacques mort de chagrin en octobre à Grand Pré, avec mari et enfants, et avec son frère Jacques6, 47 ans, leur soeur Madeleine, 43 ans, leur soeur Elisabeth, 28 ans
-
Anne LE PRINCE (sosa 1239 et 1255), veuve RIVET, 70 ans, avec son fils Michel RIVET et sa seconde femme , son fils Etienne avec sa famille, le mari de sa fille Anne décédée en Acadie en 1750, et les enfants de celle-ci, et sa petite-fille Françoise, 22 ans, fille de Marie Rose (sosa 619 et 627). Par contre, Marie-Rose fut envoyée en Virginie avec ses autres enfants, Jean,8 ans, Marie Joseph,6 ans, Anne (sosa), 16 ans, Marguerite (sosa) 20 ans
- En Pennsylvanie, les Acadiens qui survécurent à la variole furent rassemblés dans un quartier misérable de Philadelphie. Comme dans d'autres colonies, les enfants et jeunes adolescents furent séparés de leurs parents afin de les assimiler à la culture anglaise. Les adultes furent généralement employés comme domestiques.
C'est là que fut transportée Catherine LEBLANC, 30 ans, autre fille du vieux Jacques.
- Le Massachussetts était une colonie puritaine à l'intolérance religieuse extrême : Boston refusait toute présence de Quakers, de juifs, de catholiques ( tout prêtre catholique pénétrant dans la colonie serait condamné à mort)... Les pauvres, les indigents, les esclaves, y étaient réprimés violemment.
L'arrivée des "papistes" fut donc très mal acceptée. Là aussi, les enfants, employés comme domestiques dans des familles britanniques ou mis en apprentissage, furent volontairement séparés de leurs parents. La pratique de la religion catholique était interdite, et les Acadiens étaient assignés à résidence. Les débuts de la Guerre de Sept Ans au printemps 1756 aggravèrent encore leur situation, car les bostoniens craignaient qu'ils ne pactisent avec l'ennemi français et ne s'enfuient pour les rejoindre...
A Boston furent envoyés :
-
Jean TRAHAN, (sosa 630) , âgé de 58 ans, petit fils de Guillaume (lien) et de Madeleine BRUN, installé en Acadie à la Rivière aux Canards; je ne sais pas si sa femme Marie HEBERT l'accompagnait ou si elle était déjà décédée, ou si elle a été envoyée ailleurs. En tout cas il fut séparé de sa fille Marie Isabelle (dite aussi Elisabeth), 29 ans (ma sosa 315), envoyée en Virginie avec son (premier) mari et son fils de 6 ans
- Marguerite DAIGRE, 31 ans, Marie-Josèphe 26 ans, filles d'Olivier (sosa 628) et Françoise GRANGER (sosa 629), qui eux seront déportés en Virginie avec leurs autres enfants Honoré (sosa 314), 29 ans, Françoise 24 ans, Olivier 23 ans, Simon Pierre, 19 ans, Jean Charles 14 ans, Paul 13 ans.
A New-York, Agnès HEBERT (sosa 625), qui avait déjà perdu presque toute sa famille au départ de la Nouvelle Écosse, fut séparée de sa fille Rosalie DUON, qui n'avait que 16 ans et dut rejoindre une famille locale.
Et enfin, en Virginie, où furent envoyés la plupart de mes Sosas, le gouverneur refusa absolument de les accueillir. Après leur avoir fait attendre une décision pendant des mois, les autorités de Virginie décidèrent finalement de rendre la pareille aux autorités anglaises, et d'expédier les pauvres expulsés survivants en Angleterre, sans prévenir la Couronne. C'est ainsi que le 10 mai 1756, quatre vaisseaux transportant 1044 Acadiens cinglèrent vers l'Europe, et après une pénible traversée, accostèrent à Falmouth, Liverpool, Bristol, et Portsmouth (puis Southampton).
10 de mes Sosas subirent ce pénible destin (sans compter leurs nombreux proches et tous les autres) :
Françoise GRANGER, 55 ans, Olivier DAIGRE, 52 ans, Rose RIVET, 48 ans, "Marie" Josèphe TRAHAN, 44 ans, Honoré DAIGRE 29 ans, Elisabeth TRAHAN, 29 ans, Cyprien DUON, 25 ans, Charles LEBLANC 21 ans, Marguerite LANDRY 20 ans, Anne LANDRY 16 ans
En tout, outre mes ancêtres directs et leurs enfants, près de 7 000 Acadiens furent déportés de Nouvelle Ecosse pendant le dernier trimestre de 1755. Beaucoup moururent dès les premières semaines, et la plupart des survivants connurent misère et dénuement pendant de nombreuses années*** , et encore bien des vicissitudes. Ils furent de fait les premières victimes de la Guerre de Sept Ans, qui allait commencer officiellement le 29 août 1756 et bouleverser définitivement Europe et Amérique. Le Traité de Paris en 1763, en les libérant du joug britannique, accentua leur éparpillement, et la diaspora acadienne a depuis semé des descendants un peu partout sur la planète...
======
Notes :
1) En fait, c'était un mensonge, les instructions venaient de Lawrence
2) Ben voyons...
3) "depriveing those who shall escape of all meam of shelter or support by burning their houses and destroying everything that may afford them the means of subsistance in the countrey." (Instructions du 11 août 1755. Journal de Winslow. N. S. H. S. vol. III, p. 80.) ("privant ceux qui s'enfuiront de tous moyens d'abri ou d'aide en brûlant leurs maisons et en détruisant tout ce qui pourrait leur fournir des moyens de subsistance dans la région")
4) Grand Pré, 20 décembre 1755: le capitaine Phins Osgood écrit au Colonnel Winslow: "This serves to inform you that the French which you left under my care are all removed. The last of them sailed this afternoon, in two schooners, viz., the Race Horse, John Banks, master, with 112 persons. Ranger, Nathan Monrow, master, with 112 persons. Banks for Boston. Monrow for Virginia." (NSHS#3, p. 192.) ("Ceci pour vous informer que les Français que vous avez laissés à mes soins sont tous partis. Les derniers d'entre eux ont pris la mer cet après midi, dans deux schooners, le Race Horse, capitaine John Banks, avec 112 personnes; le Ranger, capitaine Nathan Monrow, avec 112 personnes. Banks parti pour Boston, Monrow pour la Virginie.")
5) "very sullenly and unwillingly, the women in great distress carrying off their children in their arms. Others carrying their decrepit parents in their carts and all their goods. Moving in great confusion and [it] appears as a scene of woe and distress."
6) En 1767, Honoré LEBLANC déclare Catherine envoyée au Maryland, et Jacques envoyé en Pennsylvanie; à voir où sont l'un et l'autre quelques années plus tard, c'est visiblement l'inverse : en 1763, Jacques est à Oxford, Pennsylvanie, et en 1762, Catherine est à Philadelphie. Il y a quelques erreurs dans la déclaration de leur frère Honoré à Belle-Isle. Il faut dire que les faits dataient de 15 ans, et les nouvelles circulaient difficilement. Il est même remarquable que les Acadiens de Belle Isle aient eu tant d'informations sur le devenir de leurs familles dispersées
- Certains de ceux qui étaient en France dépendaient encore des Secours de l’État en 1794
========
Sources principales :
- Journal de Winslow : Nova Scotia Archives LIEN :
-The Collections of The Nova Scotia Historical Society (NSHS) et en particulier Les bateaux de la Déportation
- L’accueil des exilés acadiens suite au Grand-Dérangement dans la colonie du Massachusetts de 1755 à 1775 Adeline Vasquez-Parra in International Journal of Canadian Studies Revue internationale d’études canadiennes :
Tous mes Acadiens de première génération sont déjà installés en Acadie lors du recensement de 1671. Tous, sauf un !
En effet, on ne trouve la première trace de Jean (Baptiste)* DUON en Acadie que le 27 février 1713 - soit tout juste un mois et demi avant la signature du traité d'Utrecht marquant la perte définitive de l'Acadie par la France -, lorqu'il épouse Jeanne HEBERT à Port-Royal; il a 29 ans, elle 17.
Si lui est récemment arrivé sur ces terres américaines, sa jeune femme représente la 4° génération acadienne par sa grand-mère Marie GAUDET fille du pionnier Jean GAUDET, et la 3° par son grand-père Etienne HEBERT arrivé à Port Royal avant 1650.
Au recensement de 1714, Jean Baptiste apparaît sous le sobriquet de "Lyonnais" ("Lionnois"). Et c'est bien là une énigme : comment et pourquoi ce DUON s'est-il décidé un jour à émigrer en Acadie, 50 à 60 ans après la plupart des autres pionniers ? D'autant plus que, alors que la plupart des premiers acadiens étaient originaires surtout de l'Ouest de la France (Saintonge, Poitou...) et travaillaient comme laboureurs, tonneliers, maréchal-ferrand, chirurgien..., métiers indispensables à l'installation d'une colonie, lui appartenait à une famille de soyeux de St Étienne en Forez et de Lyon.
Son arrière grand père Jean DUON l'aîné (mon sosa 4992) était "marchand tissotier*" à la Metare près de Saint Etienne.
Son grand-père, Mathieu DUON (S 2496), "marchand de Saint Etienne", avait épousé Catherine PEYRIEU (S 2497), fille de Gabriel, également marchand tissotier, le 26 mai 1635 .
Son père, Jean Louis DUON (S 1248), était maître passementier*, tout comme ses oncles Jean Baptiste et Jean le Cadet. Jean Louis avait quitté St Etienne pour Lyon à l'âge de 37 ans, deux ans avant de se remarier, le 22 juin 1683, avec Jeanne CLEMENSON (S 1249). Jean Baptiste sera le premier né du couple, le 31 octobre 1684, baptisé le lendemain paroisse St Vincent. Son parrain sera son oncle Jean DUON, " marchand de soies de St Nizier, petite rue Mercière", mari de Françoise BROCHAY, fille de "feu Jean BROCHAY marchand maître teinturier de soie à Lyon".
Toute la famille de Jean (Baptiste) DUON vivait donc de la soie, et l'on se mariait entre fils et filles de maîtres passementiers, veloutiers, teinturiers en soie, guimpiers, dans une parfaite endogamie sociale... Son frère Mathieu (né en 1699) ne faillira pas à la tradition : il sera "maître fabricant d'étoffes de soie", puis "maître veloutier" ; sa soeur Simone épousera en 1729 Alexis MAYOUD, "maître boutonnier".
Alors, pourquoi donc Jean Baptiste décide-t-il un jour d'abandonner un avenir tout tracé dans la soierie lyonnaise pour traverser l'océan et aller se construire une vie totalement différente, entre mer et forêt, dans une ébauche de pays??? Ses parents sont toujours vivants lors de son départ (son père décèdera le 26 octobre 1720, sa mère plus tard). Son frère Mathieu a une douzaine d'années, sa soeur Simone deux ou trois ans... Alors qu'il est le seul jeune adulte de la fratrie, pourquoi n'a-t-il pas pris la succession de son père septuagénaire?
D'autant plus qu'il a très certainement appris le métier de son père. Il est très probablement le "Jean DUON" inscrit comme apprenti passementier en juillet 1698 : il a alors 13 ans et demi, âge classique pour entrer en apprentissage, et c'est le seul Jean de cette tranche d'âge que j'aie relevé à l'époque à Lyon. La formation durait 5 ans, ce qui lui permettait, en tant que fils de maître de devenir maître à son tour dès 18 ans et demi, son statut familial le dispensant du passage par le statut de compagnon.
"Jean DUON est inscript aprentis avec Anthoine CAPLACER(?)Maître de notre art après avoir veu son acte d'aprentissage DUON 5(??)juillet 1698. Receu de LAFAY et MONTAGNON notaire royaux de cette ville par nous le 24° août 1698"
Or curieusement, c'est précisément à cette période-là qu'il va quitter Lyon et la France. Il est tout à fait impensable qu'il soit parti chercher un nouveau débouché pour les passementeries familiales : les Acadiens étaient trop peu nombreux et ne pouvaient pas constituer un marché pour ce type de produits... S'installer à Port-Royal était pour Jean Baptiste une rupture radicale et définitive avec ses origines sociales et son mode de vie. Alors, quid? Etait-ce une question de caractère ou de circonstances? Avait-il, chevillé au corps, un véritable esprit d'aventure, l'envie de découvrir des horizons lointains...? Fuyait-il un conflit familial, un chagrin d'amour?... Avait-il des ennuis avec la justice?... Rêvait-il de grands espaces, ou était-il un fils rebelle en rupture de ban ??? Cette question restera malheureusement sans réponse, une véritable Enigme...
Toujours est-il qu'il a rapidement trouvé sa place dans la colonie de Port-Royal, comme le montre son mariage avec une toute jeune fille issue d'une déjà "vieille" famille locale. De plus, venant d'une famille plutôt aisée et éduquée, une quinzaine d'années après son arrivée, en 1727, il est nommé notaire de Port Royal par le gouverneur Armstrong....
Père de 13 enfants dont 11 deviendront adultes, après plus de 30 ans passés en Acadie, il sera inhumé à Port Royal à l'âge de 61 ans, le 6 mai 1746. Cela lui épargnera le chagrin de voir sa famille totalement éparpillée sur la planète moins de 10 ans plus tard lors de la tragédie qui allait frapper le peuple acadien.
Notes :
- Lors de son baptême et de son mariage, il est appelé Jean, mais Jean Baptiste à son décès, puis, 30 ans plus tard c'est par ce double prénom que le désigne son fils Cyprien. C'était visiblement son prénom d'usage.
Glossaire :
passementier : s. m. (Art. méchaniq.) ouvrier & marchand qui fait & vend des passemens ou dentelles. Les autres ouvrages que peut fabriquer le passementier sont des guipures, des campanes, des crespines, des houpes, des gances, des lacets, des tresses, des aiguillettes, des cordons de chapeaux, des boutons, des cordonnets, des rênes, des guides & autres ouvrages & marchandises semblables. (Diderot et d'Alembert)
tissotier : ancien nom du passementier
veloutier : celui qui fabrique du velours
guimpier : fabricant de fil d'or pour les rubans, galons...
Parmi les toutes premières familles installées à Port Royal figure celle de Guillaume TRAHAN (mon sosa 2468, 2520, 9862). Alors que les origines françaises de bon nombre de pionniers restent floues et sujettes à controverses, on suit clairement la trace de Guillaume dès avant sa venue.
Il est l'un des sept enfants répertoriés de Nicolla TRAHAN et Renée DESLOGES, de Montreuil-Bellay (Indre et Loire). Il se marie1 à St Etienne de Chinon le 13 Juillet 1627 avec Françoise CORBINEAU (S 9863). Vers 1629 naît leur fille Jeanne, puis un autre enfant quelque temps après. Guillaume est maréchal de tranchant, c'est-à-dire qu'il fabrique toutes sortes d'outils tranchants: haches, couteaux, faux, serpettes, faucilles, ciseaux de menuisier, etc., et même des ustensiles de table, comme couteaux, fourchettes, cuillères...
Il mène une vie paisible auprès de ses parents, ses frères François et Nicolas, ses soeurs Renée, Anne et Lucrèce2, sa femme et ses enfants... Mais voilà qu'en 1635, il est (ainsi que quelques autres) condamné pour avoir défriché et coupé du bois dans la forêt de Bourgueil. Ces défrichages semblent avoir été habituels depuis une quarantaine d'années, il n'est visiblement pas le seul ni le premier, mais un coup d'arrêt est soudain donné par les autorités à cette pratique. Selon le jugement de la maîtrise de Chinon,
Les habitants des paroisses St Germain et St Nicolas de Bourgueil, le procureur joinct........ et en outre Messire Léonor d'Etampes......ordonne à trois religieux, deux écuyers, un garde marteau de la forêt de Bourgueil, Guillaume TRAHAN........et quelques autres personnes que ce qui a esté entrepris, usurpé et déffriché par lesdictz deffendeurs des appartenances et dépendances de ladicte fôretz de Bourgueil depuis 40 ans en ladicte conservée par les procès verbaux de visitation et d'arpentaige et prétendus baux à rente que nous avons déclaré nulz et de nul effect, sera réuny en l'avenir au corps de ladicte forêtz de Bourgueil.......faisant inhibition expresse ausdictz deffendeurs et tout aultres de deffricher abattre ne couper aucun bois ........ne changer la nature d'icelle à peine de 500 livres d'amende..... sont condamnés ..... le dict Duberlé en 50 livres d'amende ......le dict TRAHAN 20 livres d'amende et soixante dix livres pour la valleur et estymation du jeune bois qui estoit en deux arpents qu'il a fait arrachez dont partie a esté trouvée en sa maison et oultre en quarante livres pour les domaiges et intêretz.....".3
Condamné à payer un total de 130 livres (une très grosse somme!) pour avoir défriché deux arpents de forêt, Guillaume doit être furieux, sans compter que ce jugement le met probablement dans une situation financière délicate.
Or il se trouve que depuis 16324 le tourangeau Isaac de Razilly s'efforce de développer l'Acadie, avec le soutien de Samuel de Champlain et Richelieu. Et fin 1635, peu après les déboires judiciaires de Guillaume, de Razilly fait recruter dans la région paysans et artisans pour aller travailler dans la toute jeune colonie encore embryonnaire.
Plusieurs habitants de la région vont se décider à partir à l'aventure vers ce continent de tous les possibles. Il s'agit de quatre jeunes couples de laboureurs de Bourgueil, qui n'ont encore qu'un ou deux enfants, ainsi qu'une veuve et ses deux enfants. S'y ajoutent cinq laboureurs célibataires , et, venant de Chinon, un tonnelier, deux tailleurs d'habits, deux laboureurs et un savetier.
Après sa mésaventure au tribunal, on peut imaginer que Guillaume et sa femme n'ont pas hésité longtemps à aller se construire une nouvelle vie au-delà de l'océan, là où défricher ne serait plus interdit mais au contraire encouragé, et où les autorités seraient bien lointaines... Ils se joignent donc, avec leurs deux enfants d'environ 7 et 5 ans et un valet, au groupe qui descend la Loire début 1636 et rejoint un navire de 252 tonneaux, le St Jean, que Claude de RAZILLY (frère d'Isaac) a affrété pour le long voyage.
L'équipage est constitué essentiellement de matelots de la Rivière d'Auray, d'où vient également le capitaine, Pierre SAUVIC. Le navire fait d'abord voile vers Bayonne, où sont recrutés 8 charpentiers et un maître charpentier basques, ainsi que 3 matelots pour renforcer l'équipage.
Puis le Saint Jean remonte sur la Rochelle, où embarquent 4 saulniers plus un maître et sa femme "pour aller faire des marais en la Nouvelle France", ainsi que le reste des passagers : tout d'abord Nicolas Le Creux, lieutenant de de Razilly, avec sa femme, Anne Motin, ses beaux-frères et belle-soeur, une cousine, et une "fille de leur suite" (= servante?). Le Creux a également embauché des "hommes de travail" : divers laboureurs et un fendeur de bois de Dijon, un maître charpentier de moulin et deux autres charpentiers venus de Paris, 3 matelots supplémentaires, un charpentier de Saint-Malo, un maître cannonier de La Rochelle, un vigneron, un maître armurier et serrurier, un maître farinier, un maître jardinier... Embarquent également quelques autres, aux spécificités non détaillées.
Au total, ce sont donc 18 membres d'équipage et 78 passagers (dont 9 enfants) qui quittent La Rochelle le 1er avril 1636 pour le "Nouveau Monde", certains pour s'installer définitivement, d'autres juste pour remplir un engagement de quelques saisons...
Fin mai, après 2 mois de navigation, le Saint Jean jette enfin l'ancre devant la Hève, dans le sud de la péninsule acadienne. Les passagers apprennent alors qu'Isaac de Razilly est mort, et que Charles de Menou, sieur d'Aulnay, qui a pris la relève, souhaite transporter la colonie à Port Royal, sur la côte nord. En effet, à La Hève, les terres cultivables sont rares et pauvres, tandis qu'à Port Royal, les premiers défrichements effectués sont très prometteurs. Le navire va donc permettre de déménager la colonie.
Dès l'été, les gros travaux commencent : construction de 2 moulins (l'un à eau et l'autre à vent), de 5 pinasses, plusieurs chaloupes et 2 petits vaisseaux, 2 fermes, des habitations, granges, étables. On s'emploie à construire des digues et des marais salants... Nul doute que Guillaume a fort à faire à fabriquer les outils nécessaires outre ceux qui ont dû être apportés par le St Jean.
Lui qui, un an plus tôt, s'était fait sévèrement sanctionner pour avoir défriché deux arpents de forêt en France, doit se réjouir de voir ces étendues immenses d'arbres que l'on peut à loisir abattre pour construire bateaux, moulins et maisons...
Vu l'urgence de s'installer avant l'hiver, les premières maisons sont assez grossières, faites d'arbres non équarris, couvertes d'écorce de bouleau ou avec des roseaux. De l'argile mêlée de paille permet d'assurer l'étanchéité des murs. (Plus tard, la construction d'un moulin à scie permettra d'équarrir les arbres et de construire de façon plus raffinée.) Le bois permet également de fabriquer des meubles et de façonner bols, assiettes, cuillers... La forêt et ses ressources sont vitales pour la colonie naissante...
Comme il n'existe pas encore de chemins, les nouveaux colons creusent des embarcations dans des troncs d'arbre et se fabriquent des canots en écorce de bouleau, à l'instar des autochtones...
Il faut aussi rapidement labourer les terres défrichées et préparer les semences pour s'assurer l'autonomie l'année suivante... Bref, après des mois d'inaction depuis le départ de Bourgueuil, c'est l'effervescence dans la petite colonie...
Les années suivantes, tandis que les engagés peu à peu regagnent la France, les quelques familles venues s'installer définitivement s'enracinent dans le nouveau continent.
Vers 1643, Jeanne TRAHAN (ma sosa 4931), 14 ans, la fille de Guillaume venue de France sur le St Jean à l'âge d'environ 7 ans, épouse Jacob BOURGEOIS (S 4930), 22 ans, membre très actif de la colonie, arrivé en Acadie le 6 juillet 1641 sur le Saint-François en provenance de La Rochelle. Il est chirurgien, mais se fera aussi au fil du temps constructeur de navires, commerçant, interprète entre Français et Anglais, et cultivateur... Guillaume sera grand-père dès l'année suivante, et au total, le couple lui donnera 11 petits-enfants.
Le nom de Guillaume TRAHAN apparaît dans différents documents concernant l'histoire de Port Royal, et notamment le 16 août 1654, quand il signe la capitulation en tant que "syndic des habitants".
Françoise et lui n'ont apparemment pas d'autre enfant après leur arrivée en Acadie, mais Françoise est toujours en vie en 1649, puisque dans son testament, le 20 janvier 1649, Charles de Menou, gouverneur de l'Acadie, demande à sa femme de ne pas oublier la femme de Guillaume TRAHAN :
« … Je la suplye davoir soin de Laverdure de sa femme; elle noublira pas la femme Guillaume TRAHAN et le tout autant que nostre bon dieu luy donnera les moiens et des richesses»
En 1666, toutefois, Guillaume est devenu veuf, puisqu'il se remarie avec la jeune Madeleine, fille de Vincent BRUN et de Renée BREAU (ou BRAULT / BRODE), elle-même arrivée en Acadie à l'âge de 3 ans. Il est déjà âgé d'une soixantaine d'années, tandis que la jeune épousée n'a que 21 ans, un de moins que l'aînée des petits-enfants de Guillaume... Cette très grande différence d'âge ne les empêchera pas d'avoir 6 enfants, avant le décès de Guillaume vers 16845.
Guillaume aura donc vécu près de 50 ans en Acadie, entouré de ses chères forêts...
PS : j'ai choisi de centrer cet article sur mon ancêtre Guillaume TRAHAN (dont je descends trois fois, par ses deux épouses), mais la forêt n'était pas seulement une ressource en matériaux pour les Acadiens. Elle fut aussi pour eux à diverses occasions un refuge. Quand les Britanniques arrivaient par la mer pour faire des raids contre les Acadiens, allant dans certains cas jusqu'à tuer les bestiaux, détruire les récoltes et brûler les maisons, comme en septembre 1696 à Beaubassin, la population fuyait dans les bois, où les Anglais n'osaient pas pénétrer. Et plusieurs milliers d'Acadiens s'y cacheront à partir de 1755 pour fuir la déportation.
==========
Notes :
1 acte découvert par Jean Marie GERME. Par contre, son acte de naissance ne nous est pas parvenu, certains registres étant manquants au début du siècle à Montreuil Bellay. Il est sans doute né entre 1607 et 1609.
2 Si l'on a confirmation par leurs actes de mariage que les frères sont devenus adultes, je ne suis pas sûre du devenir des filles
3 cité par Geneviève Massignon dans sa thèse Les Parlers français d'Acadie - Sorbonne - 1962
4 29 mars1632 : traité de St Germain en Laye par lequel l'Angleterre rend la Nouvelle France dont elle s'était emparée en 1629
5 Madeleine, chargée de jeunes enfants à élever, se remariera très rapidement, avec Pierre BEZIER, dit La RIVIERE, et aura avec lui une petite fille, Suzanne (âgée de 5 mois lors du recensement de 1686). Ce second mari sera lui aussi nettement plus âgé qu'elle, puisqu'il décèdera en 1706, à l'âge annoncé de "90 ans"! même si cette estimation est sans doute excessive, il devait être pour le moins sexagénaire lors de son mariage avec Madeleine, tandis qu'elle avait tout juste la quarantaine.
Ma lettre A aurait pu être pour Aboîteaux, car qui dit Acadiens dit Aboîteaux...
A leur arrivée sur les côtes de la Baie Française (aujourd'hui Baie de Fundy) , les futurs colons, outre les immenses forêts canadiennes, découvrirent des marées impressionnantes (celles de Fundy sont les plus hautes du monde : leur marnage* peut atteindre jusqu'à 16 m), qui avaient formé de nombreux marais.
Grâce à l'ingénieux système des aboîteaux qu'ils mirent au point et à un labeur méthodique et harassant, ils allaient mettre ces espaces en valeur. Un aboîteau est une sorte de digue astucieuse, dont le clapet permet à la fois d'empêcher la mer d'envahir les terres à marée haute, et de les laver peu à peu de leur sel, grâce à l'écoulement à marée basse des eaux pluviales ou provenant de la fonte des neiges. C'est une spécifité acadienne.
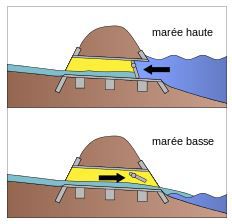 Source Wikimedia Commons
Source Wikimedia Commons
Certes, il fallait attendre deux à trois ans avant de pouvoir cultiver ces terres gagnées sur la mer, mais ensuite, le rendement était magnifique, nettement supérieur à celui obtenu en défrichant la forêt. C'était la puissance des marées qui créait la fertilité de ces terres inondables, car les courants profonds et rapides de la baie, qui peuvent attendre 13 kms/h, drainent et déposent deux fois par jour des quantités formidables de sédiments.
Par ailleurs, une végétation spécifique - avec des plantes halophytes** comme la spartine - poussait sur l'estran et servait de fourrage aux bêtes avant même que les terres ne deviennent cultivables.
La technique des aboîteaux fit des Acadiens des "défricheurs d'eau" et contribua à façonner leur identité collective. En effet, la construction des digues puis leur entretien face aux coups de boutoir des grandes marées et des glaces hivernales, exigeaient un travail colossal et donc imposait la solidarité et la coopération de tous. Cela tissait des liens étroits dans les communautés, où l'on travaillait ensemble entre voisins et toutes générations confondues. Même le gouverneur de l’Acadie, Charles Menou d’Aulnay, participait à la mise en valeur des marais. Ainsi, trois jours avant de se noyer dans le retournement de son canoë à Port Royal, en mai 1650, il était lui aussi occupé à "poser des piquets, tracer les lignes et tendre les cordeaux pour faire un nouvel assèchement de terre, pendant même qu’il pleuvait averse sur lui "...
Après quelques décennies, le succès de ce type d'agriculture et l'expansion démographique de la petite colonie de Port Royal amenèrent les plus dynamiques habitants de la région à rechercher de nouveaux espaces. C'est ainsi que vers 1672, Jacob BOURGEOIS (sosa 4930), quinquagénaire déjà bien établi à Port-Royal, alla avec certains de ses fils et ses gendres fonder un nouvel établissement dans l'isthme de Chinectou, au fond de la baie de Fundy; exactement sur la frontière actuelle du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. Très vite, la fusion de la petite colonie de Jacob avec celle, voisine, du seigneur de la Vallière, constitua l'établissement de Beaubassin qui atteindrait les 3 000 habitants huit décennies plus tard.. Peu après, vers 1675, Pierre TERRIOT, Claude LANDRY, Antoine LANDRY et René LEBLANC (Sosa 2464) allèrent s'installer à la rivière Habitants dans la région des Mines, et en 1682, d'autres familles fondèrent Grand Pré.
Les terres gagnées sur la mer allaient rapidement faire la richesse de ces nouveaux établissements, et dès le début du XVIII° siècle, la région des Mines était la plus peuplée d'Acadie, et Grand-Pré devenu "le grenier de l'Acadie" exportait céréales et autres denrées vers Port Royal et jusqu'en Nouvelle Angleterre.
Les aboîteaux étaient si connus pour être essentiels à la richesse de ces communautés qu'en 1704, lors d'un raid britannique sur la région depuis le Massachussets, les 550 assaillants, non contents de faire des prisonniers, tuer du bétail et incendier des maisons, détruisirent les digues de Grand-Pré, laissant la mer envahir les terres et détruire les cultures. Résilients et obstinés, les Acadiens reconstruisirent leurs aboîteaux patiemment...
Notes :
- Le marnage est la différence de hauteur d'eau entre le niveau de la marée haute et celui de la basse mer qui la suit ou la précède
** plantes halophytes : plantes adaptées aux milieux salés
Un arrêt de la Cour de janvier 1767 imposa donc de reconstituer pour chaque chef de famille acadien installé à Belle Isle "la généalogie aussi exacte et étendue qu'il sera possible de ses pères et mères, du lieu de leurs naissances, de leurs mariages, et de la naissances de leurs enfants, des morts de leurs parents en ligne directe, ascendant et descendant, et en collatérale", et ceci "autant qu'ils pourront s'en souvenir", et en comptant sur l'aide des autres acadiens et de leur représentant, l'abbé LE LOUTRE. Sans doute y avait-il d'ailleurs dans le groupe de réfugiés quelque "défricheteux de parenté", comme les appelle Antonine MAILLET, chargé d'entretenir et transmettre la mémoire collective. Ces déclarations n'étaient pas une mince affaire, puisqu'il s'agissait de compenser grâce à la mémoire orale près d'un siècle et demi de registres paroissiaux perdus.
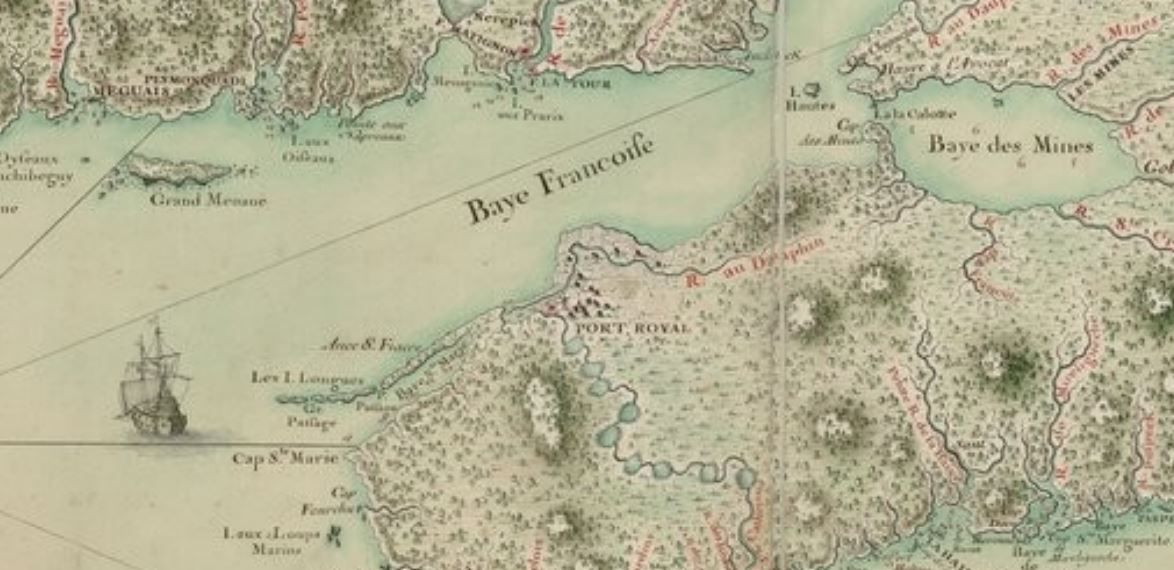 Carte de Port-Royal - 1708
Carte de Port-Royal - 1708
Et c'est ainsi que, le 5 février 1767, "Honoré Le Blanc, acadien demeurant actuellement en cette île au village de Bordustard, paroisse Saint Gerand du Palais" se rend à la convocation des autorités et déclare en présence des témoins "être issu de Daniel LE BLANC son aïeul sorti de France avec sa seconde femme, et Marie Le Blanc, sa fille de son premier mariage et morte sans enfant, et passés tous les trois au Port Royal, chef lieu de l'Acadie, après le traité de Breda du 31 juillet 1661*. " , avant de dérouler la généalogie complète de Daniel et Françoise, la liste de leurs enfants, petits enfants, etc...
Le lendemain, 6 février, c'est au tour d' "Honoré, Olivier et Paul DAIGRE, frères demeurant au village de Chubiguer paroisse du Palais" de faire leur déclaration. Honoré indique "être né à la Rivière aux Canards, paroisse Saint Joseph, le six janvier mil sept cent vingt six, d'Olivier DAIGRE né au Port Royal en 1703 et décédé à Falmouth le 8 décembre 1756 [qui] était fils d'Olivier DAIGRE et de Jeanne BLANCHARD, tous deux décédés au Port Royal; Olivier DAIGRE issu de Jean DAIGRE venu de France, marié au Port Royal à Marie GAUDETet tous deux morts au dit lieu". S'ensuit toute la généalogie descendante de Jean et Marie.
Puis, "le 23 février 1767 a comparu Cyprien DUON, métayer acadien, demeurant au village de Calastrène paroisse de Bangor, lequel [...] a déclaré être né au Port Royal le premier avril 1729 de Jean Baptise DUON sorti de la ville de Lyon en France et marié au dit Port Royal à Agnès HEBERT fille d'Antoine HEBERT et de Jeanne CORPORON, ledit DUON mort au dit lieu. Du mariage de Jean Baptiste DUON et d'Agnès HEBERT sont nés au dit Port Royal..."
Un régal bien sûr pour la généalogiste en herbe que j'étais, même s'il y a quelques erreurs dans ces longues déclarations. Ainsi, le traité de Bréda fut signé le 31 juillet 1667 (et non 1661), par l'Angleterre, la République des Provinces Unies, la France et le Danemark. Curieusement, les déclarants acadiens de 1767 avaient bien retenu le jour et le mois, mais se trompaient sur l'année. Ce traité qui avait rendu l'Acadie à la France (mais sans que soient clairement précisés quels territoires étaient concernés, ce qui était le germe de futurs nouveaux conflits) avait visiblement marqué les esprits. Mais l'Acadie n'ayant cessé de faire des aller retours entre la France et l'Angleterre pendant plusieurs décennies, on peut comprendre les confusions de dates lors de la transmission orale un siècle plus tard.
Par ailleurs, on sait par le recensement de 1671 et par la suite même de la déclaration d'Honoré à Belle Isle ce jour-là que Daniel LEBLANC était déjà arrivé en Acadie en 1650, puisque c'est l'époque à laquelle il épouse Françoise GAUDET à Port Royal, et que plusieurs enfants du couple y naissent dès 1651 : " d'iceux Daniel Le Blanc et sa femme, sont nés René Le Blanc, Jacques Le Blanc, Antoine Le Blanc, Pierre Le Blanc, au dit Port Royal, et de Daniel Le Blanc et femme est aussi né André Le Blanc" .
Mais pour l'essentiel, les déclarations belliloises de 1767 sont une source précieuse et émouvante.
Une autre source très riche pour reconstituer une grande partie de la population du berceau de l'Acadie est le recensement effectué fin 1670-début 1671 à Port Royal, à la demande du gouverneur GRANDFONTAINE, et à destination de Jean-Baptiste COLBERT, contrôleur général des finances de France de Louis XIV.
On trouve en effet dans ce recensement la quasi totalité des patronymes acadiens, dont une bonne part concerne mes ancêtres directs, tels :
AUCOIN BAYOL BLANCHARD
BOUDROT / BOUDREAU
BOURC / BOURG / BOURQUE
BOURGEOIS
BRUN BRAUD/ BRODE
CHEBRAT COLLESON
COMEAU CORPORON / CORBERON
DAIGRE / DAIGLE
GOUGEON GRANGER
GAUDET / GODET
GAUTIER HEBERT LAMBERT
LANDRY LEBLANC LEJEUNE
RAU SAVOIE / SCAVOIS
TERRIAU / TERRIOT / THERIOT / THERIAULT
TRAHAN
il faudra ajouter à mes sosa (LE)PRINCE et DUON / DUHON, arrivés plus tard.
en italique : ceux qui ne se sont pas transmis car portés uniquement par des pionnières.
Par ces patronymes pionniers, je cousine avec pratiquement tous les acadiens de par le monde...:)
Recensement de Port-Royal - 1671 - mes Sosa :
Chirurgien - Jacob BOURGEOIS (S 4930) agé de 50 ans, sa femme Jeanne TRAHAN (S 4931) âgée de 40 ans, leurs enfans 10, deux de mariés, un garçon et une fille, Jeanne, âgée de 27 ans, Charles 25, Germain 21, Marie 19, Guillaume 16, Marguerite 13, Françoise 12, Anne (S 2465)10, Marie 7 ans, Jeanne 4 ans.
Leurs terres Labourables et en valeur en deux endroits : environ 20 arpents plus ou moins. Leurs bestiaux a cornes 33, Leurs brebis 24
Laboureur - Jean GAUDET (S 5002, 5050, 9858, 9918, 10 046 et 10 052) âgé de 96 ans (sic!), sa femme Nicole COLLESON âgée de 64 ans. Leur enfant Jean âgé de 18 ans
(NB : je descends 6 fois de Jean, aux 13° et 14° générations! par sa première épouse, dont l'identité est inconnue. Il a d'ailleurs tant de descendants qu'il a pu être surnommé "l'Abraham de l'Acadie"par le Père Archange Godbout, généalogiste québécois)
Leur terre en labour : trois arpents en deux places. Leurs bêtes à cornes 6 piéces. Leurs brebis, 3 piéces.
Laboureur - Denis GAUDET (S 5026) âgé de 46 ans, sa femme Martine GAUTIER (S 5027) âgée de 52 ans, Leurs enfants 5, et 2 de mariés. La première Anne Gaudet âgée de 25 ans, La seconde Marie (S 2513) âgée de 21 ans, Pierre âgé de 20 ans, Pierre âgé de 27 ans, Marie âgée de 14 ans, tous 5 sans métier excepté laboureurs.
Leur terre en valeur: 6 arpents. Leurs bêtes à cornes: 9 piéces. 13 brebis tant petites que grandes.
Marie GAUDET (S 2501, 2525, 4959, 5023) Veuve de Etienne HEBERT ( S 2500, 2524, 4958, 5022) âgée de 38 ans, ses enfants 10; 2 de mariées : Marie âgée de 20 ans, Marguerite âgée de 19 ans, Les autres a marier, Emmanuel âgé de 17 ans, Etienne âgé de 17 ans, Jean âgé de 13 ans, Françoise 10 ans, Catherine 9, Martine 6 ans, Michel 5 ans, Antoine 1 an.
Ses terres en labour :2 arpents, bêtes a cornes 4, et 5 paires de brebis
Laboureur - Olivier DAIGRE ( S 2512) âgé de 28 ans, sa femme Marie GAUDET (l'aînée) (S 2513), âgée de 20 ans,. Leurs enfants 3: Jean âgé de 4 ans, Jacques 2 ans, Bernard 1 an
Leurs terres en Labour deux arpents, bêtes à cornes 6 paires et 6 brebis.
Laboureur - Jean BLANCHARD (S 5028) âgé de 60 ans, sa femme Radegonde LAMBERT (S 5029) âgée de 42 ans, Leurs enfants 6, 3 de mariés : Martin Blanchard âgé de 24 ans, Magdeleine Blanchard âgée de 28 ans, Anne âgée de 26 ans
Les non mariés : Guillaume (S 2514) âgé de 21 ans, Bernard âgé de 18 ans, Marie âgée de 15 ans
Leurs terres en labour : 5 arpents. Leurs bestiaux à cornes : 12, et brebis 9
Laboureur - Jean TERRIAU (S 4948, 5012, 5036) âgé de 70 ans, sa femme Perrine RAU âgée de 60 ans. Leurs enfans 7. Ceux qui sont mariés, Claude Terriau, âgé de 34 ans, Jean âgé de 32 ans, Bonaventure (S 2474, 2506, 2518) âgé de 30 ans, Germain 25 ans, Jeanne âgée de 27 ans, Catherine âgée de 21 ans, Le non marié Pierre âgé de 16 ans
Leurs bestiaux a cornes 6, et 1 brebis; terres labourables 5 arpents.
Laboureur - François SCAVOIS (S 5006) âgé de 50 ans, sa femme Catherine LEJEUNE (S 5007) âgée de 38 ans. Leurs enfants 9, 1 fille de mariée, Françoise (S 2503) âgée de 18 ans, Les non mariés, Germain âgé de 17 ans, Marie âgée de 14 ans, Jeanne âgée de 13 ans, Catherine âgée de 9 ans, François 8, Barnabé âgé de six ans, Andrée âgée de 4 ans, Marie âgée d'1 an 1/2
bestiaux a cornes 4 piéces, terres labourables 6 arpents
Laboureur - Jean CORPORON (S 2502) âgé de 25 ans, sa femme Françoise SCAVOIS (S 2503) âgée de 18 ans, Leurs enfants : 1 fille de 6 semaines qui n'a point encore esté nommée sur les Sts fonds
On remarque que ce tout jeune couple a encore peu de moyens; Jean est arrivé depuis peu en Acadie
bête a cornes :1 vache, et 1 brebis, point de terre labourable
Laboureur - Vincent BRUN (S 4938, 5042) âgé de soixante ans, sa femme Renée BRODE (S 4939, 5043) âgée de 55 ans, Leurs enfants 5 tant mariés que non mariés, 3 de mariés, Magdeleine BRUN (S 2469, 2521) âgée de 25 ans, Andrée âgée de 24 ans, Françoise âgée de 18 ans, Les non mariés : Bastien âgé de 15 ans, Marie âgée de 12 ans
Leurs bêtes à cornes 10 piéces et 4 brebis, terre labourable 5 arpents
Maréchal - Guillaume TRAHAN (S 2468, 2520, 9862) âgé de 60 ans ou environ, sa femme Magdeleine BRUN ( S 2469, 2521) âgée de 25 ans, Leurs enfants 3. Guillaume (S 1234) âgé de quatre ans, Jean Charles (S 1260) âgé de 3 ans, Alexandre âgé d'1 an
Leurs bestiaux à cornes 8, et 10 brebis, Leurs terres en labour: 5 arpents
Laboureur - Bonaventure TERRIAU (S 2474, 2506, 2518) âgé de 27 ans, sa femme Jeanne BOUDROT (S 2475, 2507, 2519) âgée de 26 ans. Leurs enfants : 1 fille Marie 4 ans
Leurs bêtes à cornes 6 piéces, et 6 brebis, Leurs terres en labour : 2 arpents
Laboureur - Michel BOUDROT (S 4950, 5014, 5038, 5044) âgé de 71 ans, sa femme Michelle AUCOIN (S 4951, 5015, 5039, 5045) âgée de 53 ans. Leurs enfants : 11, 3 de mariés, Françoise âgée de 29 ans, Jeanne (S 2475, 2507, 2519) âgée de 26 ans, Marguerite âgée de 20 ans, Les non mariés Charles (S 2522) âgé de 22 ans, Marie âgée de 18 ans, Jean âgé de 16 ans, Abraham âgé de 14 ans. Michel âgé de 12 ans, Olivier âgé de 10 ans, Claude âgé de 8 ans, François âgé de 5 ans
Leurs bêtes à cornes 20 et 12 brebis, Leurs terres labourables 8 arpents
Laboureur - Antoine BOURC (S 5046) âgé de 62 ans, sa femme Antoinette LANDRY (S 5047) âgée de 53 ans, Leurs enfants, 11, 4 de mariés dont s'ensuivent les noms: Marie âgée de 26 ans, Francois âgé de 27 ans, Jean âgé de 24 ans, Bernard âgé de 22 ans. Les non mariés : Martin âgé de 21 ans, Jeanne âgée de 18 ans, Renée (S 2523) âgée de 16 ans, Huguette âgée de 14 ans, Jeanne 12 ans, Abraham âgé de 9 ans, Marguerite 4 ans
Leurs bêtes à cornes 12, et 8 brebis. Leurs terres labourables, 4 arpents
Matelot - Laurent GRANGER (S 2516) âgé de 34 ans, sa femme Marie LANDRY (S 2517) âgée de 24 ans. Leurs enfants 2, Marguerite âgée de 3 ans, Pierre âgé de 9 mois
Leurs bêtes à cornes 5, et 6 brebis. Leurs terres labourables 4 arpents
Laboureur - Daniel LEBLANC (S 4928) âgé de 45 ans, sa femme Françoise GAUDET (S 4929) âgée de 48 ans. Leurs enfants, 7, 1 fille de mariée Françoise âgée de 18 ans, Les non mariés, Jacques âgé de 20 ans, Etienne âgé de 15 ans, René (S 2464) âgé de 14 ans, André âgé de 12 ans, Antoine âgé de 9 ans, Pierre âgé de 7 ans
Leurs bestiaux à cornes 18, et brebis 26. Leurs terres en Labour 10 arpents en 2 places.
Laboureur - Antoine GOUGEON (S 5030) âgé de 45 ans, sa femme Jeanne CHEBRAT (S 5031) âgée de 45 ans, 1 enfant : Huguette (S 2515) âgée de 14 ans
Leurs bestiaux à cornes 20 piéces, et 17 brebis. Leurs terres labourables et en Labour 10 arpents
Tonnelier - Pierre COMMEAU (S 2526, 4954, 5018) âgé de 75 ans, sa femme Rose BAYOL (S 2527, 4955, 5019) âgée de 40 ans, leurs enfants 9, 1 de marié, Etienne, âgé de 21 ans, les non mariés, Pierre Commeau âgé de 18 ans. Françoise âgée de 15 ans, Jean âgé de 14 ans, Pierre âgé de 13 ans, Antoine âgé de 10 ans, Jeanne (S 1263) âgée de 9 ans, Marie (S 2477, 2509) âgée de 7 ans, Jean âgé de 6 ans
Leurs bêtes à cornes, 16 piéces et 22 . Leurs terres labourables 6 arpents
Laboureur - René LANDRY l'aîné (S 5034) âgé de 53 ans, sa femme Perrine BOURC (S 5035) âgée de 45 ans. Leurs enfans 7, 4 de mariés, à savoir Henriette PELLETRET (d'un premier mariage de Perrine) âgée de 30 ans, Jeanne âgée de 28 ans, Marie âgée de 25 ans, Marie (S 2517) âgée de 23 ans. Les non mariés : Magdeleine âgée de 15 ans, Pierre âgé de 13 ans, Claude âgé de 8 ans
Leurs bestiaux à cornes 10, et 6 brebis. Leurs terres en labour 12 arpents en 2 places
Un chirurgien (à l'époque, une sorte de barbier amélioré, capable de faire certains soins), un maréchal ferrant, un tonnelier, un matelot (mais qui cultivait la terre et avait vaches et brebis), et une majorité de laboureurs : voilà donc en 1671 mes ancêtres acadiens établis à Port Royal.
La colonie comptait également un tisserand ("texier"), deux armuriers, trois autres tonneliers, un maçon, un taillandier, deux charpentiers, un tailleur, et quelques autres laboureurs...Toute une communauté rurale apte à vivre en grande partie de ses propres ressources...
Tout en me réjouissant de cet "inventaire" si précieux, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée émue pour le cordelier Laurent MOLINS, passant de ferme en ferme le long de la rivière au Dauphin dans son habit de gros drap gris, en plein hiver, dans la neige, pour questionner les habitants, sans doute accueilli dans mainte maison avec une boisson chaude et de la bienveillance, mais parfois vertement éconduit, comme chez le tailleur Pierre MELANSON, qui "a refusé de donner son âge et le nombre de ses bestiaux et terres, et sa femme [lui] a répondu [s'il était] fou de courir les rues pour des choses de même (= pareilles)", ou Etienne ROBICHAUT, qui "ne [l]'a pas voulu voir. Il a sorti de chez lui et a dit a sa femme qu'elle [lui] dise qu'il ne [lui] voulait point donner le compte de ses bestiaux et terres", ou encore le tonnelier Pierre LA NOUE, qui lui "a fait réponse lorsqu [il lui a] demandé son âge qu'il se portait bien et qu'il ne le voulait pas donner"...
sources :
- Déclarations généalogiques de Belle Isle en Mer - 1767 - AD du Morbihan
- Recensements de l'Acadie 1671 - 1752 : Archives du Canada : Dépôt des papiers publics des colonies; état civil et recensements : Série G 1 : Recensements et documents divers : C-2572 https://heritage.canadiana.ca/view/oocihm.lac_reel_c2572/2?r=0&s=1
Mais revenons à la chronologie de mes découvertes, car les recherches généalogiques sont une sorte de machine à remonter le temps, et j'ai donc commencé à faire la connaissance de mes acadiens par la fin, par leur installation dans "mon" île...
 Claude Picard : l’arrivée des Acadiens en 1765 à Belle Isle. (© Citadelle Vauban)
Claude Picard : l’arrivée des Acadiens en 1765 à Belle Isle. (© Citadelle Vauban)
A l'automne 1765, 363 personnes de tous âges, débarquent à Belle Isle en Mer, après des années de péripéties, pour démarrer une nouvelle vie. Ce sont des "réfugiés acadiens". Sur ces 78 familles, 5 sont celles de mes ancêtres directs. Mais les autres sont formées de frères, cousins, neveux... Tous sont liés par d'étroits liens de parenté et forment une sorte de clan : Les LE BLANC arrivent à 57, les GRANGER à 46, les TRAHAN à 49, les TERRIOT à 27 et les DAIGRE à 21, de sorte que sur les 363 personnes arrivées à Belle-Île, 200 correspondent à seulement 5 patronymes.

Dans le récapitulatif de ces familles, on trouve 9 de mes Sosa, répartis ainsi :
Famille 11 :
Honoré Leblanc (mon sosa 616) , né à Pigiguit (Acadie) le 1er novembre 1710, veuf, père de Charles (S 308), (55 ans). Ses enfants Paul et Joseph.
Venant de Liverpool et Morlaix, installés à Bordustard (Le Palais).Famille 12 :
Charles Leblanc (Sosa 308) , né à Pigiguit en août 1734 (31 ans), fils d’Honoré (Sosa 616). Son épouse Anne Landry (sosa 309) née à la Rivière-aux-Canards (Acadie) le 24 février 1739 (26 ans). Leurs enfants : Claude-Marie et Marie.
Venant de Liverpool et Morlaix, installés à Bordrouant (Bangor).Famille 56 :
Cyprien Duon (sosa 312), né à Port-Royal (Acadie) le 18 avril 1730 ( 35 ans). Son épouse Marguerite Landry (sosa 313), née à la Rivière-aux-Canards le >15 janvier 1735 (30 ans), fille de Marie-Rose Rivet (sosa 619 et 627, implexe) veuve Landry. ( 58 ans)
Leurs enfants : Jean-Baptiste, Marie et un orphelin, Jean Vincent, neveu de Cyprien.
Venant de Liverpool et Morlaix, installés à Calastren (Bangor).Famille 70 :
Marie Rose Rivet (sosa 619 et 627, implexe) , veuve de René Landry, née à Pigiguit le 18 juillet 170 (58 ans) . Mère d’Anne (Sosa 309) (26 ans) et de >Marguerite (Sosa 313) (30 ans). Ses autres enfants : Jean et Magdeleine, Marie-Josèphe.
Venant de Liverpool et Morlaix, installés à Bordustar (Le Palais).Famille 25 :
Honoré Daigre (sosa 314), né à la Rivière-aux-Canards le 6 janvier 1726 (39 ans), veuf, sa 3ème épouse Élisabeth Trahan (sosa 315), née à la Rivière-aux-Canards le 1er janvier 1726 (39 ans), également veuve. Mariés à Falmouth le 29 septembre 1762 Sa mère Françoise Granger (sosa 629), née à Port-Royal en 1700 ( 65 ans).
Leurs enfants : Pierre, Jean, Joseph, Jean-François et Marie Terriot, (fille d'Élisabeth).
Viennent de Falmouth, de Morlaix et Tréguier, installés à Chubiguer (Le Palais).
Le 2 novembre 1765, le baron de Warren, gouverneur de l'île, écrivit à un ami : "Voilà enfin, mon cher marquis, tous les Acadiens arrivés au nombre de 77 familles. Les derniers sont arrivés avant-hier sur deux bateaux plats, le premier qui est entré dans notre port coulait bas d'eaux et le second a pensé périr sur les roches sous la citadelle ! Je vous avoue que j'aurais été furieusement touché s'il était arrivé quelques accidents à ces honnêtes gens dont je regarde leur émigration dans l'île comme le plus grand bien qui pouvait arriver dans Belle-Ile, au service du Roi et pour les intérêts de la Province...
Mais que venaient donc faire ces "acadiens", nés dans la lointaine Amérique, sur cette île ? Et en quoi pouvaient-ils présenter un intérêt pour le roi de France et la Province de Bretagne?
Nous verrons dans de prochains articles toutes les tragédies qui les ont conduits d'Acadie en France après moult détours, mais voyons pour l'instant les tenants et les aboutissants de leur installation à venir.
Je ne comprendrais rien à toute une partie de mon histoire ancestrale sans quelques informations sur la Guerre de 7 ans, cette première "guerre mondiale" de fait (car les combats se déroulèrent en Europe, Amérique du Nord et Inde) qui dura de 1756 à 1763. Elle opposa la France et la Grande Bretagne, chacune étant alliée à d'autres puissances européennes.
Dès 1755 les Acadiens en avaient été les premières victimes (article G à venir). La France y perdit notamment son empire colonial en Amérique du Nord. Et la petite île de Belle Isle elle aussi paya un lourd prix : après une grande bataille navale* auprès de ses côtes en novembre 1759 qui consacra la débâcle de la flotte française, elle subit le 7 avril 1761 l'attaque d' une flotte anglaise forte de 130 bâtiments et de 18 000 hommes ; le chevalier de Sainte Croix à la tête d'une petite garnison de 3 200 hommes, après une rude bataille, ne put guère que se replier dans la citadelle Vauban. Le siège dura jusqu'au 2 juin, mais il fallut finalement capituler, et l'île devint anglaise...Les Bellilois durent fuir sur le continent en abandonnant leurs maigres biens, ou travailler pour les Anglais.
Le Traité de Paris qui mit fin à la guerre fut signé le 10 février 1763. Entre autres, la France abandonnait la plus grande partie de ses possessions américaines; et renonçait définitivement à l'Acadie. Par ailleurs, elle rendait Minorque aux britanniques, en échange de ... Belle-Île.
Mais pendant les deux années d'occupation anglaise, l'île avait été totalement pillée, le bétail tué, les champs abandonnés étaient en friche, la plupart des maisons détruites, même leurs poutres avaient été volées pour pallier le manque de bois, etc...
Il fallait rapidement repeupler l'île et reconstruire son économie. Le Receveur du Domaine de Belle-Isle, François de Kermarquer, était de Morlaix. Il avait donc appris l'arrivée des prisonniers acadiens rendus par le roi d'Angleterre (toujours suite au Traité de Paris) et provisoirement installés à Morlaix et Saint Malo. Offre fut alors faite auxdits acadiens d'aller s'installer à Belle-Isle. Un tel projet faisait d'une pierre deux coups : repeupler l'île ravagée et donner un établissement à des réfugiés à la charge du roi.
Afin de voir si ce projet pouvait convenir à la petite communauté, trois chefs de famille acadiens, Honoré LE BLANC (mon sosa 616), Joseph TRAHAN et Simon GRANGER, vinrent à Belle Isle en juillet 1763, quelques semaines à peine après leur arrivée sur le sol français. Le baron de WARREN témoigne de la réussite de ce premier contact :"Ils ont paru très contents de ma réception et s'en sont retournés le 27. Comme ils sont gens fort industrieux et habiles cultivateurs, je serais enchanté de les voir arriver: ce serait un bon boulevard contre ceux qui les ont maltraités." *
Les États de Bretagne ratifièrent le projet, confirmé par le duc de Choiseul, ministre de Louis XV. Il fut alors procédé à l'afféagement de l'île, véritable révolution agraire, tout à fait inédite : l'île, domaine royal, allait être divisée en lots attribués aux familles acadiennes et belliloises, et ces cultivateurs, à condition de travailler les terres pendant 10 ans, en deviendraient pleinement propriétaires!
L'abbé LE LOUTRE, ancien missionnaire en Acadie auprès des autochtones MicMac, se chargea de défendre les intérêts des Acadiens Il fallut beaucoup de talent, de discussions et tractations diverses, pour faire accepter aux Bellilois, soutenus par leurs curés, la future arrivée de ces "étrangers" qui ne parlaient pas breton, et aux acadiens le fait d'être répartis dans toute l'île et non regroupés en une seule paroisse comme ils le souhaitaient.
Il fallut acheter 78 paires de bœufs, 78 chevaux, des attelages et jougs, courroies, charrettes et charrues, brouettes, ustensiles et outils - comme « 234 faucilles à raison de 3 par famille »-, etc. Il fallut aussi s’occuper de l'arpentage des terrains, de la construction des maisons - acquisition des matériaux, et recrutement des maçons venus du continent, car les Acadiens ne savaient construire qu'en bois-. Les plans des maisons furent définis avec précision par les États de Bretagne : c'étaient de très petites maisons, de 27 mètres carrés au sol, aux ouvertures basses et étroites, construites avec le schiste local, et couvertes soit de lande - c'est à dire d'ajoncs séchés mis en bottes - soit d'ardoises. Toutes les maisons devaient être identiques et pouvoir être agrandies plus tard en longères.
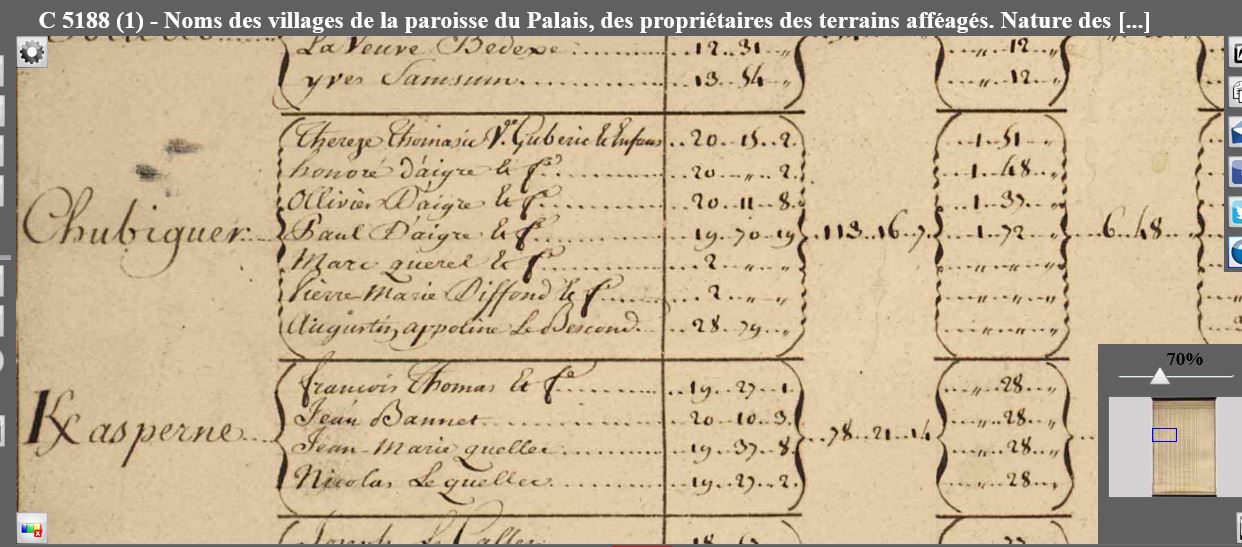
En septembre 1765, Simon GRANGER et Honoré LE BLANC revinrent dans l'île pour préparer l'arrivée des familles, qui va se faire en 4 vagues, le 2 septembre, le 1er , le 18 et le 30 octobre. Les maisons n'étant pas encore construites, les Acadiens furent logés provisoirement dans des entrepôts à grains, sur la paroisse de Palais.
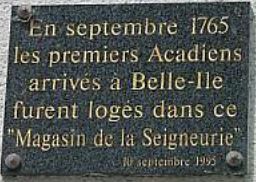 Logement provisoire des Acadiens à leur arrivée à Palais
Logement provisoire des Acadiens à leur arrivée à Palais
En décembre 1766, les contrats d’afféagement étaient tous signés, et Joseph Simon GRANGER, Jean MELANSON et Honoré Daigre (sosa 314) concluaient ainsi une lettre de remerciement aux États de Bretagne :
Nous ne cesserons de présenter nos vœux et nos prières pour la conservation et prospérité de vos illustres personnes, et serons avec toute la soumission possible et le respect le plus profond, Nos seigneurs, vos humbles et très obéissants serviteurs...
En juillet 1767 le baron de Warren écrivait : "Ces honnêtes citoyens ont presque fini tous leurs établissements : leurs maisons sont couvertes, leurs écuries bâties et leurs terres travaillées. Ainsi j’espère qu’à la récolte de l'année prochaine, ils commenceront à recueillir les fruits de leurs travaux..."
Voici donc comment mes Acadiens trouvèrent une nouvelle patrie à Belle Isle en Mer après des années d'errance.
Mettant le point final à cette installation, le 12 janvier 1767, un arrêt de la Cour ordonna la reconstitution de l'état-civil des familles acadiennes établies à Belle Isle. Les registres paroissiaux acadiens avaient en effet été détruits ou perdus lors de la déportation, et il était urgent d'y remédier. Dans les semaines qui suivirent fut donc organisée la collecte de la mémoire généalogique acadienne. sous l'égide de l'abbé LELOUTRE et d'un notaire d'Auray.
Découvrir ces "généalogies acadiennes" établies par mes ancêtres en 1767 allait me faire faire une grande avancée dans mes recherches, et enfin quitter mon île pour faire mes premiers pas en Acadie...
Notes :
- cité par Jean Marie FONTENEAU in Cahiers de la société historique acadienne vol 30 N°1 mars 1999
** les Cardinaux : bataille navale qui opposa Français et Anglais le 20 novembre 1759, dont le bilan fut clairement à l'avantage des seconds, puisque la marine française perdit 6 bâtiments et eut 2 000 hommes tués (300 côté britannique), et de plus les vaisseaux français qui se réfugièrent dans les estuaires de la Vilaine et de la Charente, y furent bloqués par les britanniques pendant plus de deux ans
=================
Sources :
- Jean Marie FONTENEAU in Cahiers de la société historique acadienne vol 30 N°1 mars 1999
- Christophe CERINO : Les Acadiens à Belle-Île-en-Mer : une expérience originale d’intégration en milieu insulaire à la fin du XVIIIe siècle
Une des branches de ma famille était donc "acadienne". Mais qu'est-ce que ça voulait dire? et comment avait-elle atterri sur une petite île bretonne de 85 km² ?
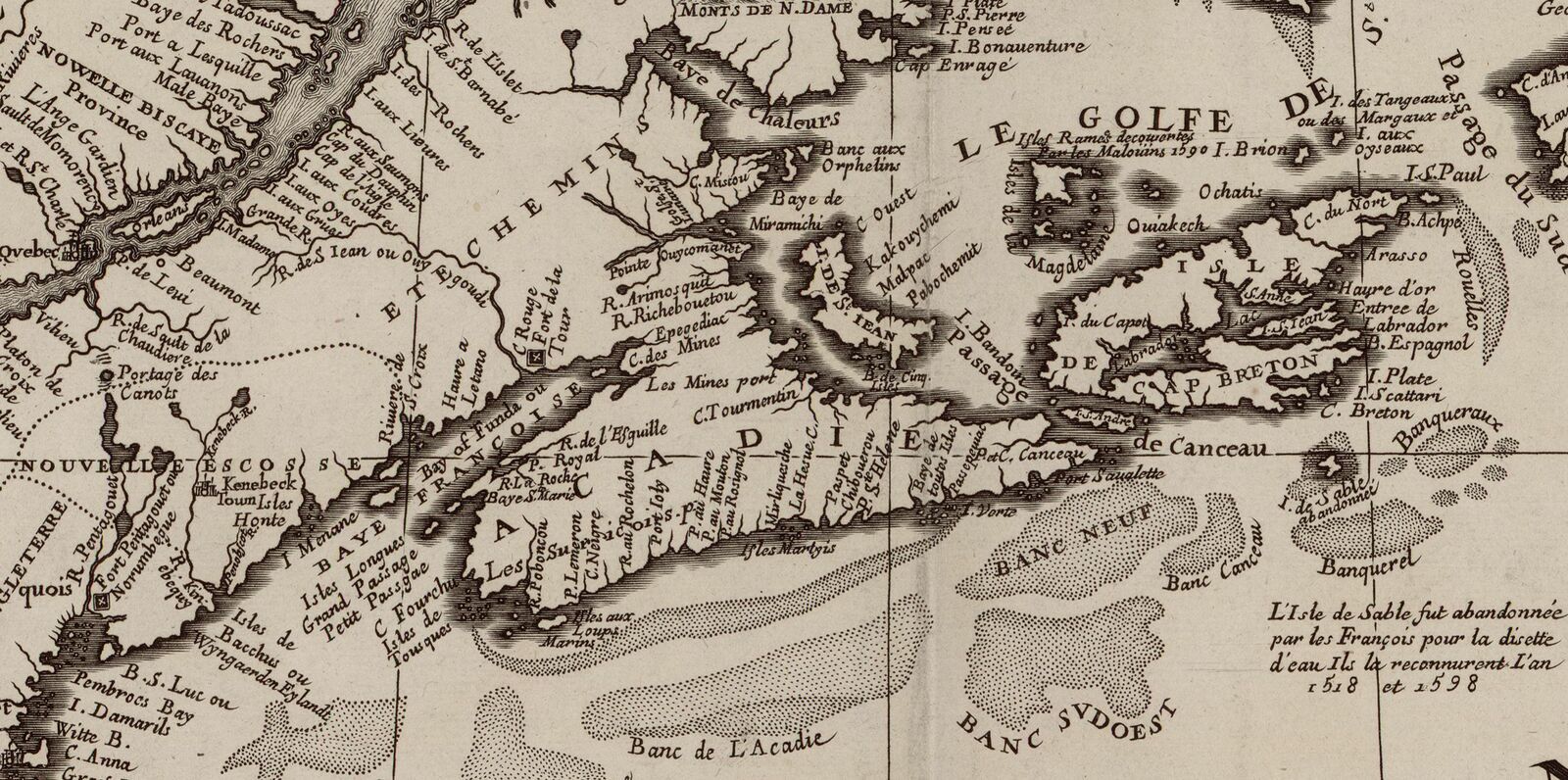 Partie Orientale du Canada - Vincenzo Coronelli - Source gallica.bnf.fr
Partie Orientale du Canada - Vincenzo Coronelli - Source gallica.bnf.fr
Quand j'ai questionné mon père sur ses souvenirs à ce sujet, il a commencé par me dire qu'enfant, il s'ennuyait lorsque sa grand-mère belliloise racontait les histoires du passé avec les autres vieilles du village, et que donc il n'écoutait pas... Tout juste a-t-il fini par grommeler qu'il avait entendu dire "qu'on venait du Canada"... Mais je n'ai rien pu en tirer de plus. Mon arrière-grand-mère et mon grand-père étant morts, la transmission familiale avait cessé. J'ai dû reconstituer l'histoire grâce aux archives puis à diverses lectures (difficile d'imaginer aujourd'hui ce que c'était , avant l'explosion d'internet, que de faire ce genre de recherches, qui s'opèrent aujourd'hui en deux clics).
Ne serait-ce que pouvoir situer géographiquement l'Acadie était une gageure. D'autant que l'Acadie en tant que telle n'existe plus depuis 3 siècles... Elle n'a d'ailleurs jamais constitué un pays. Il s'agissait d'une colonie de la Nouvelle France, au même titre que le Canada, la Louisiane... C'était une sorte de puzzle, de pointillé d'établissements le long des côtes de ce qui allait devenir définitivement la Nouvelle Écosse lors du traité d'Utrecht de 1713, et du futur Nouveau Brunswick.
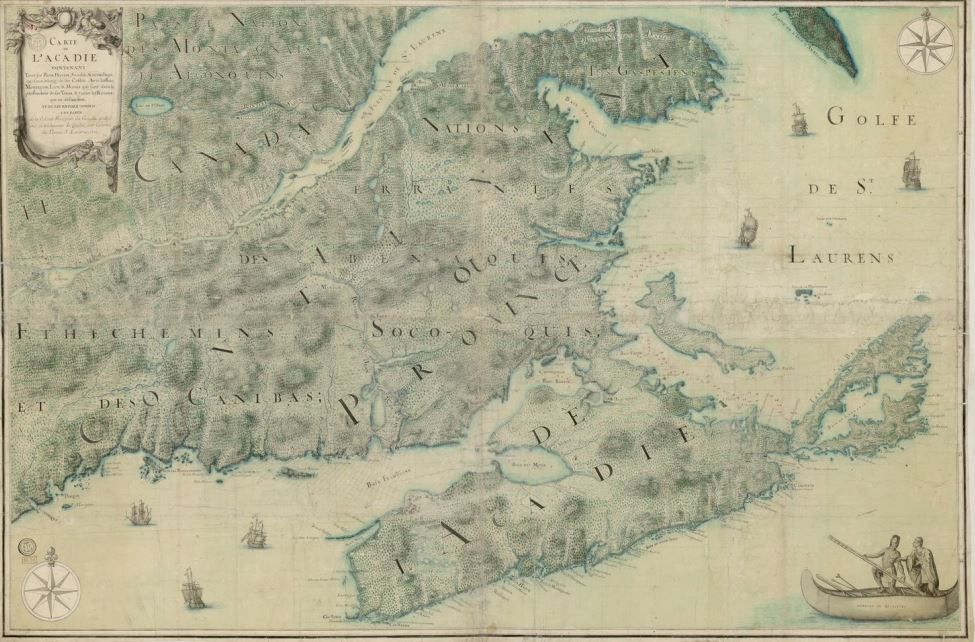 Carte de l'Acadie - 1702 - Source gallica.bnf.fr
Carte de l'Acadie - 1702 - Source gallica.bnf.fr
D'ailleurs, à l'époque où ils vivaient en Acadie, ses habitants ne se définissaient pas comme "Acadiens", mais comme "Français", ou "sujets du roi de France", puis , à partir de 1713, après la perte définitive de l'Acadie originelle par la France au profit de la Grande Bretagne, comme "Français neutres"... C'est paradoxalement au moment même où il durent quitter l'Acadie géographique, à partir de 1755, qu'ils furent définis officiellement comme "Acadiens" (souvent écrit "Accadiens"), constituant un groupe devenu différent des Français par ses particularités.
Le berceau historique de l'Acadie (celui qui concerne mes ancêtres) se situe sur la côte est du Canada, car non, ce n'est pas le Québec qui borde l'Atlantique mais les "Provinces Maritimes" - Nouveau Brunswick, Nouvelle Ecosse et Ile du Prince Edouard .
Après de probables incursions normandes dès le XI° siècle, puis la venue de l'explorateur vénitien Jean CABOT en 1497, la région de l'actuelle Nouvelle Ecosse (Nova Scotia en anglais) fut explorée en 1604/1605 par Pierre DUGUA de MONS, accompagné de Jean de POUTRINCOURT et de Samuel de CHAMPLAIN (géographe et cartographe de l'expédition). Ainsi furent nommés La Hève, le cap Nègre, la baie Sainte-Marie, le cap Sable, la baie Française, Port-Royal, le fleuve Saint-Jean, la rivière Sainte-Croix, etc, et commença le peuplement de l'Acadie par les Européens.
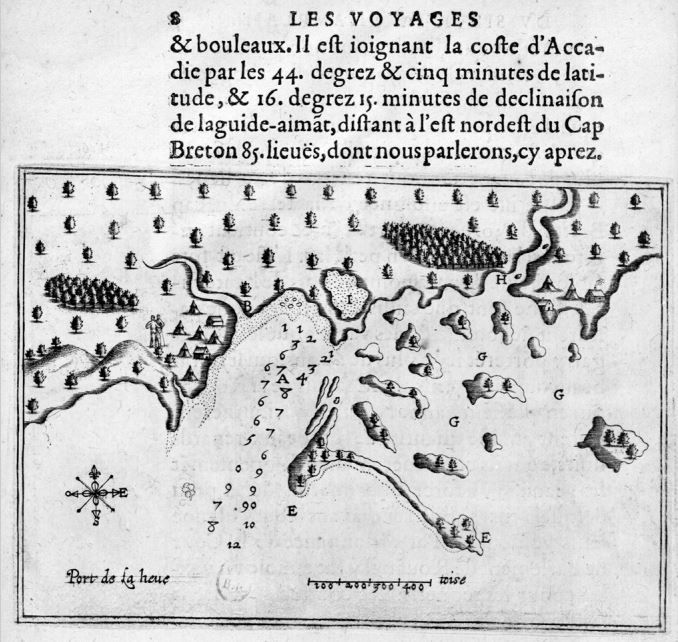 Port de La Heve - Illustrations des Voyages de Champlain. 1613. Source gallica.bnf.fr
Port de La Heve - Illustrations des Voyages de Champlain. 1613. Source gallica.bnf.fr
Peuplement d'abord sporadique : les Français installèrent quelques postes à divers endroits de la côte, avec des succès limités, dus notamment aux difficultés d'adaptation au climat, aux luttes intestines franco-françaises, et aux fréquentes attaques anglaises.
La colonisation commença à s'organiser en 1632, quand le gouverneur Isaac de Razilly amèna les premières familles françaises en Acadie. Toutefois, tandis que les Britanniques organisaient une colonisation à grande échelle du sous continent, la France n'envoya finalement que peu de colons (815 en tout selon certains comptages) au cours du XVII° siècle (essentiellement de 1632 à 1670), puis plus du tout à partir de 1713.
Ceci explique qu'en peu de générations, les Acadiens de Nouvelle Ecosse furent tous liés par des liens de parenté et manifestèrent une forte solidarité lors des épreuves qui allaient les frapper. Mais également que la disproportion démographique entre les deux peuplements et l'abandon de fait par la France de sa colonie ne pouvaient qu'aboutir à un désastre pour l'Acadie.
Le ver était dans le fruit dès l'origine : de 1604 à 1713, le berceau de l'Acadie changea 9 fois d'allégeance. Car l'Acadie voyait ses frontières constamment contestées, et, immédiatement devenue un enjeu du séculaire conflit franco-britannique, se trouvait ballotée d'un camp à l'autre au gré des traités de (pseudo) paix. J'ignorais, quand au lycée j'entendais parler avec un certain ennui des traités de Saint-Germain-en-Laye (1632), de Breda (1667), de Ryswick (1697) ou d'Utrecht (1713), que mes propres ancêtres en avaient vu chaque fois leur quotidien bouleversé...
Dans le cadre de notre dossier sur la mémoire, l'historien Gilles Havard retrace dans un entretien au HuffPost l'histoire méconnue de la Nouvelle-France, qui fut en réalité une "Amérique franco-indienne".
Par Pierre Tremblay
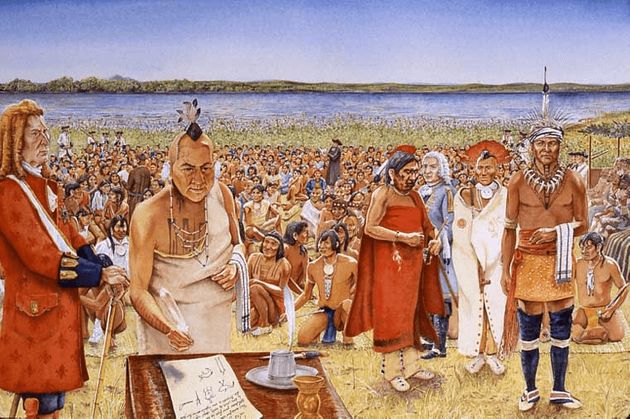 Signature du Traité de Grande Paix à Montréal en 1701
Signature du Traité de Grande Paix à Montréal en 1701
DOSSIER MÉMOIRE - Il suffit d’entrer dans une librairie française pour cerner l’angle mort. Dirigez-vous vers le rayon “histoire”, puis auscultez la section “Amériques”, si elle existe. À coup sûr, vous découvrirez maints ouvrages sur l’histoire contemporaine des États-Unis. La vie de Barack Obama, la crise des missiles de Cuba ou le 11 septembre 2001, jusque dans leurs moindres détails.
Mais difficile d’élargir ce spectre états-unien. Le Canada, le Québec? La section “guides de voyages” risque d’être plus fournie. Et la Nouvelle-France? Presque un trou noir. Dans l’Hexagone, l’histoire française de l’Amérique du Nord, qui s’est pourtant écrite sur un territoire colossal s’étendant de la Louisiane au Labrador, aux 17e et 18e siècles, est aujourd’hui presque oubliée.
Cet article fait partie de notre dossier “La mémoire en mouvement”. Alors qu’Emmanuel Macron appelle à la création d’une liste de personnalités pour mieux représenter “la diversité de notre identité nationale”, Le HuffPost se plonge dans l’histoire de France et dans l’actualité pour interroger notre mémoire collective. La “Nouvelle-Orléans” et son “frenchquarter”, l’accent des “cousins québécois”... “Notre mémoire collective semble se résigner à n’entrevoir l’histoire des colonies françaises d’Amérique du Nord qu’à travers ces images fugaces et évanescentes”, explique l’historien Gilles Havard, en introduction de son “Histoire de l’Amérique française” (Flammarion) co-écrite avec Cécile Vidal, directrice d’études à l’EHESS.
“Par comparaison avec celle des îles à sucre, cette histoire occupe une faible place dans les programmes scolaires et elle reste peu enseignée à l’université”, rappelle-t-il.
Dans un long entretien au HuffPost, ce spécialiste de la Nouvelle-France et directeur de recherche au CNRS retrace ce pan méconnu de l’histoire française, en accordant une attention particulière aux relations franco-amérindiennes, fil rouge de ses recherches depuis une vingtaine d’années. Plongée dans une histoire complexe faite d’alliances, de guerres, de commerce et de métissages.
Ces derniers mois, les Français ont abondamment discuté de leur mémoire collective, mais l’histoire et les figures de l’Amérique du Nord française sont absentes de ces débats. Pourquoi ?
Le principal facteur, c’est que cette portion de l’empire français a disparu lors de la Guerre de Sept ans, en 1763, et donc avant la Révolution française, événement fondateur de notre histoire et identité nationale. Tout cela apparaît donc très lointain. C’est aussi l’histoire d’un échec. Les Français ont été battus par les Britanniques et on pourrait dire, même si c’est un peu simpliste, que l’amour propre national a pu freiner l’intérêt pour cette période.
Et puis c’est une histoire éclipsée par celle des États-Unis, première puissance mondiale. Côté américain, l’idéologie de la “Destinée manifeste” postule que l’histoire du continent commence avec l’arrivée des anglo-américains. Ce qui a précédé est considéré comme inférieur d’un point de vue civilisationnel. Le passé français et celui des autochtones sont donc perçus comme un prologue anecdotique.
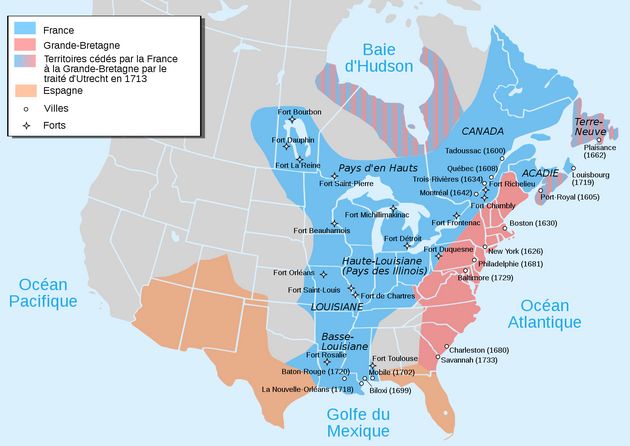 Carte de la Nouvelle-France (en bleu) vers 1755
Carte de la Nouvelle-France (en bleu) vers 1755
Vous écrivez que l’étude de l’Amérique française nécessite d’abord de “redéfinir les concepts souvent galvaudés de colonisation et d’impérialisme”. C’est-à-dire ?
Cette histoire nous amène à mieux réfléchir au phénomène colonial dans sa diversité et sa complexité. Par exemple, la colonisation de la Nouvelle-France, ça ne signifie pas immédiatement la soumission des Autochtones, ni nécessairement la confrontation.
La Nouvelle-France était peu peuplée (3000 colons en 1663, autour de 80.000 en 1760). Elle a donc existé grâce aux liens noués avec les Amérindiens. Ces derniers trouvaient aussi un intérêt dans ces alliances, pour mieux faire la guerre aux autres peuples autochtones ou résister à l’expansion des Britanniques, plus avides de leurs terres.
C’est pour cela que vous dites que l’Amérique française fut en fait une “Amérique franco-indienne” ?
Oui. Il y a bien un empire qui se construit, mais il repose sur des formes d’adaptation aux Autochtones, plus que d’imposition des normes coloniales. Le projet consiste à franciser et évangéliser les Amérindiens, mais c’est parfois le contraire qui se produit.
Il faut donc éviter l’histoire téléologique et anachronique en considérant que les autochtones sont immédiatement des victimes de l’histoire coloniale. Ce serait leur enlever leur marge de manœuvre, leur capacité à être des acteurs historiques. En revanche, à la longue, surtout au 19e siècle (époque britannique puis canadienne ou américaine), les Autochtones ont bien été soumis et refoulés dans des territoires exigus, devenant en quelque sorte des étrangers sur leurs terres.
L’arrivée des Français, et plus largement des Européens, va même provoquer une “tempête démographique” chez les Amérindiens...
En effet. C’est la plus grande tragédie de l’histoire des Amériques. Les Autochtones ont subi de plein fouet le choc microbien : ils n’étaient pas immunisés contre la grippe ou la variole. C’est, de loin, la principale cause de mortalité liée à la colonisation. Des groupes pouvaient perdre jusqu’à 90 % de leur population.
Si Jacques Cartier est passé avant lui, c’est Samuel de Champlain qui démarre l’entreprise coloniale en 1603. Quel est le projet au départ ?
Au 16e siècle, les pêcheurs normands, bretons et basques viennent pêcher la morue dans le golfe du Saint-Laurent. Mais bientôt, c’est un autre produit qui intéresse les Français : la peau de castor, qui sert à fabriquer des chapeaux en Europe. La monarchie va alors accorder des monopoles de traite à des entrepreneurs en échange de l’obligation de s’établir sur place et d’installer des colons.
Lors de ce voyage, une première alliance naît d’une rencontre fortuite avec des Amérindiens à Tadoussac (Québec), alors que des guerriers algonquins, montagnais et malécites célèbrent une victoire contre leurs ennemis, les Iroquois. Comment en arrive-t-on à ce rapprochement?
Les Français connaissaient déjà ces Autochtones. Mais cette rencontre est l’occasion de fonder une alliance durable. L’amitié des Autochtones est indispensable aux Français s’ils veulent circuler et s’implanter en Amérique du Nord. Leur alliance avec ces peuples est fondée sur le commerce et la guerre contre un ennemi commun. En s’alliant avec les Montagnais, les Hurons-Wendat et les Algonquins, les Français sont ainsi conduits à combattre les Iroquois.
Les Amérindiens trouvent aussi leur intérêt dans la traite des fourrures, car ils reçoivent en échange, par exemple, des textiles et des objets en fer (haches, marmites).
En 1701, cette politique d’alliance atteint son paroxysme avec la Grande Paix de Montréal, un traité hors normes entre les Français et une quarantaine de nations amérindiennes, dont les Iroquois. Peut-on parler alors d’un rapport de nation à nation?
Oui, ce sont des rapports diplomatiques tels qu’ils peuvent exister au même moment entre États européens. Mais les Français s’adaptent aux Autochtones : les discours de leurs chefs sont traduits par des interprètes français, on brandit des colliers de wampum – faits de perles de coquillages – pour appuyer sa parole, on fume le calumet… Les ambassadeurs autochtones s’adaptent eux aussi aux Français, qui leur demandent d’inscrire leur marque sur le traité de paix. Ils y dessinent alors des animaux totémiques.
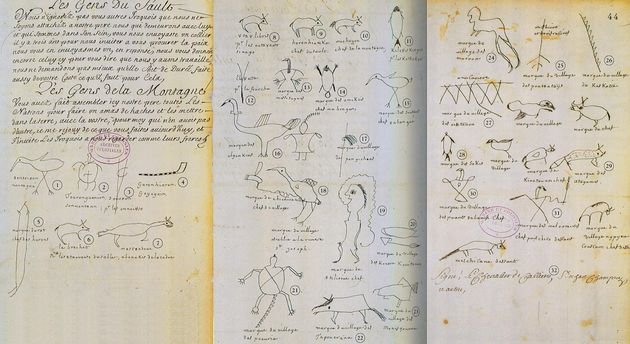 Extrait du traité de 1701 avec les pictogrammes des nations
Extrait du traité de 1701 avec les pictogrammes des nations
Dans “L’Amérique fantôme” (Flammarion) et “Empire et métissages” (Septentrion), vous sortez de l’ombre les “coureurs de bois”, peut-être les acteurs les plus aboutis de cette Amérique franco-indienne. Qui étaient-ils?
Ce sont des colons français, tous des hommes, qui circulaient dans l’intérieur du continent nord-américain pour collecter des fourrures auprès des Amérindiens. Sur place, certains épousent des Amérindiennes à la mode autochtone. Les enfants qui naissent de ces unions deviennent, pour la plupart, de petits Autochtones, élevés par leur mère. Les patronymes français que l’on trouve aujourd’hui dans les réserves indiennes du Dakota ou du Montana témoignent de ces interactions.
C’est ainsi que le “rêve de Champlain”, pour reprendre les mots de l’historien David Hackett Fischer, prend forme? Lui qui disait aux Hurons en 1633 : “Nos jeunes hommes marieront vos filles, et nous ne formerons plus qu’un peuple”?
Le “rêve” de Champlain n’est pas un rêve de métissage, mais plutôt de francisation des Autochtones. Si des femmes amérindiennes se marient à des colons, leurs enfants, espère Champlain, deviendront de petits Français. Mais ce projet, relancé à l’époque de Colbert, va échouer. Au 18e siècle, cette politique officielle d’intermariage est abandonnée. Un discours mixophobe se développe alors.
Cela ne veut pas dire non plus que les tensions et les conflits étaient inexistants en Nouvelle-France...
Non, en plus des guerres contre les Iroquois, les Français, toujours avec des alliés autochtones, sont engagés autour de 1730 dans une politique de destruction des Renards (peuple des Grands Lacs) et des Natchez (en Basse-Louisiane), parce que ces groupes se montrent belliqueux. Des Natchez sont d’ailleurs déportés comme esclaves à Saint-Domingue, et leur société est en bonne partie détruite.
Même si c’était dans une moindre mesure que les Antilles, la Nouvelle-France a aussi connu l’esclavage. À ce sujet, vous faites la distinction entre la Basse-Louisiane et le reste de la colonie...
Oui, la Louisiane, comme Saint-Domingue (Haïti), constituait à partir des années 1720 une “société esclavagiste”, c’est-à-dire que son économie reposait sur le travail des esclaves africains, exploités dans des plantations de tabac ou d’indigo. En revanche, dans la vallée du Saint-Laurent (Canada), les esclaves représentaient environ 5 % de la population. Ils étaient pour la plupart des domestiques, en ville. Il s’agissait en grande majorité d’Autochtones, et
secondairement d’Africains.
La Nouvelle-France fut l’un des “laboratoires” où se sont développées la culture et l’identité françaises.Gilles Havard, historienL’histoire de l’Amérique française semble s’écrire beaucoup à partir des archives coloniales et plus difficilement à partir de sources autochtones, qui ne maîtrisaient pas l’écriture. Comment, en tant qu’historien des relations franco-amérindiennes, se prémunir de ce biais?
C’est la grande difficulté : faire ressortir le point de vue et les logiques des Amérindiens, avec des sources qui, pour la plupart, sont coloniales. Il faut donc les croiser avec des ethnographies produites plus tardivement par des anthropologues, qui ont enquêté auprès d’Autochtones ayant connu les modes de vie traditionnels, ainsi qu’avec les traditions orales autochtones.
Trouvez-vous dommage l’absence de toute cette histoire dans les débats sur la mémoire ?
Oui, car la Nouvelle-France fut l’un des “laboratoires” où se sont développées la culture et l’identité françaises. Dans les écrits de missionnaires ou d’autres colons tel le baron de Lahontan, on trouve, à travers le portrait (en partie fantasmé) du “Bon Sauvage”, une critique de l’absolutisme, du dogmatisme religieux et de la propriété, et la valorisation des valeurs d’égalité, de liberté et de félicité. Tout cela a nourri la philosophie des Lumières.
A contrario, à travers d’autres descriptions moins favorables dudit “Sauvage” (il serait “débauché”, “oisif”, “païen”, “insubordonné”, “polygame”), on essentialise l’identité française en traçant un portrait normatif et prescriptif du Français idéal. Il doit être chrétien, obéissant, laborieux, vivre au sein d’une famille restreinte, être alphabétisé, etc. On prépare ainsi un modèle d’unification culturelle qui verra finalement le jour sous la Révolution française.
Dans cette histoire, auriez-vous des exemples de personnages historiques pour mieux représenter “la diversité” dans notre espace public, comme le veut Emmanuel Macron ?
Il faudrait, je crois, se tourner du côté des Amérindiens. Le chef Huron-Wendat Kondiaronk, par exemple, fut le grand artisan de la Grande paix de Montréal de 1701. Chicagou, un chef Illinois, est venu faire valoir les revendications des siens jusqu’à la Cour de France, en 1725. Les femmes, individuellement, sont moins présentes dans les sources, sauf s’il s’agit d’Amérindiennes converties au catholicisme, la plus connue étant l’Iroquoise Kateri Tekakwitha, canonisée en 2012. Côté africain, je pense à Samba, un esclave bambara qui se révolte à La Nouvelle-Orléans en 1731.
Mais je ne crois pas qu’on retiendra ces individus pour nommer des rues ou pour des statues. L’enjeu politique en France semble faible. Les Autochtones et les descendants d’esclaves noirs en Louisiane sont devenus des citoyens américains ou canadiens. L’histoire de l’Amérique française semble trop déconnectée de la France contemporaine pour que cela intéresse vraiment le gouvernement. Mais j’espère me tromper.
Acadie Nouvelle3 décembre 2017
Pour nombre d’entre eux, partis de diverses provinces françaises au XVIIe siècle, il est très difficile de savoir d’où ils étaient originaires et la première difficulté est le manque d’archives originelles les concernant, celles-ci ayant disparu lors du Grand Dérangement, archives qui auraient indiqué leur provenance.
Sur le premier recensement d’Acadie de 1671, document original conservé aux Archives d’outre-mer à Aix-en-Provence, nous ne trouvons ni mention du lieu d’origine, ni les noms de leurs parents restés en France.
Les origines qui ont pu être retrouvées pour un petit nombre de migrants qui étaient inscrits sur des rôles de navire ou avaient passé des contrats d’engagements chez un notaire. Certains renseignements ont ainsi de pouvoir confirmer des origines: par exemple, Guillaume Trahan de Bourgueil en Anjou et son épouse Françoise Corbineau partis sur le Saint-Jean en 1636, avec leur fille Jeanne (future épouse de Jacques Bourgeois, pionnier d’Acadie bien connu). Ils s’étaient mariés à Chinon le 13 juillet 1627 (Source: Jean-Marie Germe, 1986). Également plus facile pour les personnages historiques pour lesquels il y avait quelques indices comme Nicolas Denys de Tours, Charles de Menou à Charnizay ou Françoise-Marie Jacquelin à Nogent-le-Rotrou, dont les baptêmes ou l’origine ont été retrouvés et publiés par M. Germe dans les bulletins AGCF.
Des similitudes de noms ne peuvent suffire à inscrire leurs origines avec certitude. On retrouve les patronymes acadiens dans beaucoup de départements français. Ainsi en 1963, une hypothèse, dans une étude linguistique, a été émise proposant, sur des ressemblances de noms, qu’une grande partie des migrants acadiens étaient du Loudunais (Généralité de Tours jusqu’à la Révolution). Cette hypothèse a très vite été reprise comme certitude, certains n’hésitant pas ensuite à accommoder l’Histoire. Ainsi on peut lire encore de nos jours que Théophraste Renaudot, dans la Gazette de France en 1632, aurait relaté le départ des Loudunais avec Razilly parti d’Auray en Bretagne en 1632!
Lorsqu’on lit la Gazette de France originale du 14 juillet 1632, sauf erreur, on peut noter qu’Isaac de Razilly (Commandeur de l’Île Bouchard en Touraine ) est parti d’Auray en Bretagne avec 300 hommes d’élite et 3 capucins, mais dont la provenance n’est pas mentionnée.
Deux filles Brin baptisées à la Chaussée en Loudunais, seraient ainsi, selon cette hypothèse, les filles Brun recensées en Acadie en 1671. Or, il n’y a pas de document qui atteste d’un lien avec l’Acadie; les noms de leurs mères sont différents ainsi que le lieu-dit de résidence. Comment pouvoir être certains qu’elles sont sœurs et que ce sont les mêmes que celles recensées en Acadie?
Un Etienne Rebecheau est recensé à la Chaussée, mais ne quittera jamais la Chaussée où il baptise des enfants et y décède le 24 février 1718. Par conséquent, il ne peut pas être Etienne Robichaud recensé en Acadie en 1671 dont on ne sait rien. Est-il né en France, est-il né en Acadie?
L’origine d’Antoine Bourc, qui figure également sur le Recensement d’Acadie de 1671, est toujours inconnue, et ce malgré l’installation d’une plaque à son nom dans une église. Comme pour les autres pionniers, personne ne connaît les noms de ses parents.
Deux baptêmes en 1627 ont été trouvés au nom de Jeanne Chebrat, l’un à Poitiers (Poitou) l’autre à la Chaussée (Anjou à l’époque). Mais personne ne connaît les noms des parents de Jeanne Chebrat recensée en Acadie, donc il est impossible de dire si l’une d’elles est la migrante. Il en existe peut-être d’autres ailleurs en France.
Pour l’Acadie, pour annoncer une origine française à leurs descendants, il ne faut se fier qu’aux archives retrouvées qui la confirment.
Marie-Christine Chaillou (Poitiers)
Les Amitiés Généalogiques Canadiennes-Françaises
Présentation
Présentation
Les migrants du XVIIème siècle
Les Acadiens en Poitou : ceux qui repartent, ceux qui restent
Les Acadiens à Châtellerault
Combien d'Acadiens ?
Les premiers historiens de la colonie acadienne
Plans issus de l'ouvrage du général Papuchon
La Ligne acadienne : avant l'arrivée des Acadiens
Le plan et l'arpenteur
La Ligne acadienne : après les départs
Les pouvoirs publics et les Acadiens
Autour de la Ligne acadienneTous les documents ici présentés sont issus des fonds des Archives départementales de la Vienne.
On ne trouvera parmi eux aucun document ayant directement trait aux départs d’habitants du Poitou vers l’Acadie, dès les années 1630 pour les plus précoces. Ces départs étant liés à des initiatives individuelles, les traces qu’ils ont pu laisser dans les documents sont souvent ténues et indirectes : pour les retrouver, il est nécessaire de reconstituer des parcours individuels, à partir de sources qui pourront se trouver tant outre-atlantique (documents relatifs aux migrants, mais après leur arrivée en Acadie) qu’en France, dans les départements côtiers (archives des lieux d’embarquement), ou encore dans les lieux d’origine des migrants. Ainsi les registres paroissiaux, où l’on peut retrouver les actes de baptême ou mariage de personnes ayant émigré ultérieurement en Acadie : un exemple d’un tel acte de baptême est présenté ici.
Tous les autres documents présentés ont donc été produits après l’arrivée des réfugiés acadiens en France et, plus précisément, dans le cadre de leur accueil dans le Poitou, à partir de 1773. En effet, les conditions et les modalités de cet accueil ont cette fois mobilisé fortement les autorités, générant une abondante documentation.
Cette documentation se retrouve aujourd’hui en particulier dans un fonds d’archives communément appelé « chartrier de La Roche de Bran », du nom du château proche de Poitiers où il était conservé au moment de sa remise aux Archives départementales de la Vienne. Ce fonds contient notamment les archives de la seigneurie de Monthoiron, et en particulier les documents relatifs à la tentative d’implantation des Acadiens sur ces terres. Les autres documents présentés proviennent principalement :
- des archives de l’évêché de Poitiers, qui a fourni une partie des terres nécessaires à l’établissement des Acadiens ;
- des minutes (actes originaux) du notaire Vincent Amirault, qui a réalisé en 1793 l’arpentage des parcelles de la colonie ;
- du cadastre napoléonien de Châtellerault, où de nombreux Acadiens ont séjourné à leur arrivée en Poitou ;
- des archives de l’administration du canton de Monthoiron pendant la Révolution.
Après avoir délaissé Port-Royal, à la suite du ralentissement de la traite, le vice-amiral de l’Acadie Charles de Biencourt de Saint-Just s’installe à la Baie Courante et au Cap Nègre dès l’hiver 1617-1618.
La Baie Courante (ou Anse Courante) est parsemée d’îles dangereuses à cause des rochers à fleur d’eau et des courants de marées très violents[1].
Extrait. Description des côtes, points, ports et îles de la Nouvelle-France, par Samuel de Champlain. 1607.
Cap Fourchu (A), Anse Courante (B), Cap de Sable (C) et Cap Nègre (D).
(Source : Bibliothèque numérique Mondiale. Library of Congress. G3321.P5 1607. C4)
C’est le silence à Port-Royal
Avec les vingt-cinq hommes de sa troupe, écrit Adrien Huguet, Charles de Biencourt en arrive à mener une existence errante et lamentable dans la société des Souriquois dont il partage les occupations périlleuses, les fatigues et les privations.
Sa colonie décimée ne reçoit plus d’autres recrues que des matelots évadés des cales des terre-neuviers, des volontaires en rupture de bord, débarqués aux ports Canseau et de La Hève. Ces hommes introduisent à Port-Royal des habitudes nouvelles, plus indépendantes, plus vagabondes, moins laborieuses, moins tempérantes, moins réservées dans les rapports avec les filles sauvages, poursuit Huguet.
Miné par la misère et l’épuisement, Biencourt meurt en 1623 à l’âge de 31 ans.
(Source : Adrien Huguet, « Jean de Poutrincourt 1557-1615. Campagnes, voyages et aventure d’un colonisateur sous Henri IV » dans Mémoires, Société des Antiquaires de Picardie, Amiens, tome XLIV, 1932, p. 479)
Entre 1613 et 1621, de multiples opérations commerciales sont effectuées entre Samuel Georges et Jean Macain, marchands rochelais, et Charles de Biencourt.
Pour cette période, deux engagés sont recrutés par David Lomeron, marchand, secrétaire de Charles de Biencourt, écuyer, sieur de Poutrincourt, baron de Saint-Just, « grand Sagamos des Souriquois et Étchemins et pays adjacents », vice-amiral et lieutenant général en toute la Nouvelle-France, demeurant à la Baie Courante.
Le 11 janvier 1620[2], le chaudronnier rochelais Daniel Maridain se présente dans l’étude du notaire protestant Paul Chesneau, de La Rochelle, pour convenir de ses conditions d’engagement. Il promet de s’embarquer, dans six semaines, avec Lomeron dans le navire qu’il équipera pour aller retrouver le sieur de Biencourt à la Baie Courante.
Fait étonnant, il est engagé, non pas à titre de chaudronnier, mais plutôt pour faire la traite de pelleteries avec les Sauvages et l’entretien de toutes les armes qui seront dans le navire; de plus, il obéira à ce qui lui sera commandé par le sieur de Biencourt. Pour ce faire, Maridain apportera avec lui tous les outils et instruments nécessaires. Il sera nourri et logé de son départ jusqu’à son retour en France pour un salaire de 120lt. Même salaire, si de Biencourt requiert les services de Maridain pour l’hivernement de 1620-1621.
Le 16 janvier suivant[3], c’est au tour du chirurgien et pharmacien rochelais Pierre Debrie d’imiter Daniel Maridain. Cette fois, le nom du navire est mentionné. Ainsi, Debrie promet de s’embarquer « du premier beau temps que Dieu donnera » dans le navire Le Plaisir, de La Rochelle, pour aller avec Lomeron et l’équipage au voyage de la Nouvelle-France. Il sera tenu de servir et faire la fonction de pharmacien et chirurgien et s’emploiera à tout ce qui lui sera commandé par Lomeron et, en Nouvelle-France, par le sieur de Biencourt qui en aura charge à la Baie Courante. Il sera nourri et logé pendant son séjour au salaire de 135lt incluant son coffre. Il reconnaît avoir déjà reçu la somme de 75lt de Lomeron. Le reste lui sera payé à son retour en France.
Il est accordé que si de Biencourt désire que Debrie hiverne (1620-1621), il lui sera payé pour son « hivernation » et nourriture la somme de 195lt. Par contre, si Debrie retourne à La Rochelle à l’automne, il ne sera pas tenu de laisser ses médicaments au chirurgien sur place.
Voici le contrat d’engagement de Pierre Debrie en 1620.
Pacte Debrie-Lomeron
Personnellement établit David Lomeron, secrétaire de Charles de Biencourt, écuyer, sieur de Poutrincourt, baron de Saint-Just, grand Sagamos des Souriquois et Etchemins et pays adjacents, vice-amiral et lieutenant général de Monseigneur l’amiral en toute la Nouvelle-France, demeurant à la Baie Courante en ladite Nouvelle-France, d’une part. Et Pierre Debrie, chirurgien et pharmacien, demeurant en cette ville, d’autre part. Entre lesquelles parties a volontairement été fait et passé ce qui s’en suit. C’est à savoir que ledit Debrie a promis de s’embarquer du premier beau temps que Dieu donnera dans le navire nomme Le Plaisir, de cette dite ville, pour aller avec ledit Lomeron et l’équipage que ledit Lomeron y mettra audit voyage de la Nouvelle-France et y servir et faire par ledit Debrie la fonction de pharmacien et chirurgien tant allant, séjournant que retournant. Et encore s’employer à tout ce qui lui sera commandé par ledit Lomeron ou qui de lui aura charge. Et étant de par de-là aussi à tout ce qui lui sera commandé par ledit sieur de Poutrincourt, ou qui de lui aura charge. Ce fait, s’en retourner de par de-là dans ledit navire et ce, tant pour et moyennant la somme de cent trente-et-cinq livres tournois pour son coffre, salaire et loyer. Sur quoi, ledit Debrie a confessé avoir eu et reçu aujourd’hui, auparavant ces présentes, dudit Lomeron audit nom la somme de soixante-et-quinze livres de laquelle il se contente et en quitte ledit Lomeron qui a promis et sera tenu de bailler et payer le restant, montant soixante livres, audit Debrie incontinent après que ledit navire sera de retour en cette ville de La Rochelle, à port de Salut et bon sauvement pour tout délai. Que outre moyennant que ledit Lomeron a promis et sera tenu de nourrir et héberger ledit Debrie sans diminution du susdit prix aussi tant allant, séjournant que retournant. Et est accordé entre les parties que si ledit sieur de Poutrincourt désire que ledit Debrie hiverne de par de-là avec lui, icelui Debrie sera tenu comme il a promis d’y demeurer jusqu’à l’année prochaine moyennant qu’aussi outre sa dite nourriture, il lui sera payé pour sa dite hivernation, par ledit] sieur de Poutrincourt, la somme de cent quatre-vingt-quinze livres lorsqu’il s’en voudra retourner de par deçà où il sera conduit aussi aux dépens dudit sieur de Poutrincourt et dans le vaisseau qu’il enverra l’année prochaine de par deçà. Et où ledit Debrie s’en retournerait sans hiverner, il ne sera tenu de laisser aucun de ses médicaments ou ferrements au chirurgien qui est de par de-là, sinon en le payant de la juste valeur desdits médicaments ou ferrements. Et pour l’effet et exécution des présentes, lesdites parties ont élu leur domicile en cette ville; savoir ledit Lomeron, audit nom, au logis de la Fontaine, rue du Minage, et ledit Debrie en la maison de Balthazar Debrie, maître apothicaire, demeurant en cette ville, son frère, pour y recevoir de part et d’autre tous commandements, actes et exploits de justice nécessaire qu’il promet avoir pour agréable et tant être de même effet, force et vertu que si fait étaient à sa personne ou domicile ordinaire irrévocablement. Ce stipulant les parties et pour ce faire icelles défense en leur endroit sans venir au contraire à peine de tous dépens, dommages et intérêts. Elles ont obligé l’une à l’autre tous et chacune leurs biens meubles et immeubles présents et à venir quelconques. Et outre ledit Debrie à tenir prison comme pour deniers royaux. Renonçant &. Fait à La Rochelle, en l’étude dudit notaire après-midi, le seizième de janvier mille six cent vingt. Présents Jean Guillemard et Paul Coignard, clerc, demeurant en ladite Rochelle. Signatures.
Extrait. Contrat d’engagement de Pierre Debrie pour la Nouvelle-France. 16 janvier 1620.
(Source : AD17. Notaire Paul Chesneau, 3E249, fol. 11v, 12r)
Qui sont ces engagés de 1620 ?
Pierre Debrie Daniel Maridain
Les deux engagés sont originaires de La Rochelle (Aunis).
Les engagés protestants rochelais Pierre Debrie et Daniel Maridain quittent La Rochelle, probablement en mars, pour la Baie Courante, en Nouvelle-France (Acadie), à bord du navire Le Plaisir (80 tx).
Le navire Le Plaisir fait voile pour la deuxième fois en Nouvelle-France, à la suite d’un contrat de charte-partie du 28 novembre 1619, souscrit par David Lomeron au nom du sieur de Biencourt. Le contrat est déclaré résolu par un acquit du 29 octobre 1620[4].
Que sont-ils devenus ?
Les deux engagés (100 %) retournent en France dès leur engagement terminé ou peu après : Debrie (1620) et Maridain (1621).
DEBRIE, Pierre
Demeurant à La Rochelle (Aunis), Pierre Debrie s’engage à David Lomeron, le 16 janvier 1620, pour aller travailler en Nouvelle-France, pour quelques mois, à titre de chirurgien et pharmacien, pour un salaire de 135 livres (avance de 75 livres). Il signe. Il est le frère de Balthazar Debrie, maître apothicaire rochelais. Il quitte La Rochelle, probablement en mars 1620, à bord du navire Le Plaisir (80 tx) à destination de la Baie Courante (Nouvelle-France). Semble être reparti en France à l’automne 1620.
Est-ce lui qui épouse Anne Imbert, le 1er février 1603, dans la salle Saint-Yon à La Rochelle ?
Extrait. Engagement de Pierre Debrie. 16 janvier 1620.
(Source : AD17. Notaire Paul Chesneau. 3E249, fol. 11v, 12r)
MARIDAIN, Daniel
Demeurant à La Rochelle (Aunis), le chaudronnier Daniel Maridain s’engage à David Lomeron, le 11 janvier 1620, pour aller travailler en Nouvelle-France, pour quelques mois, pour faire la traite des pelleteries et l’entretien d’armes pour un salaire de 120 livres (aucune avance). Ne signe pas. Il quitte La Rochelle, probablement en mars 1620, à bord du navire Le Plaisir (80 tx) à destination de la Baie Courante (Nouvelle-France). Semble revenir en France qu’à l’automne 1621, car le 25 septembre 1620, David Lomeron remet la somme de 30 livres à Marguerite Hastier, épouse de Maridain, en déduction de son salaire.
Le 29 janvier 1605, Daniel Maridain avait épousé Marguerite Hastier, dans la salle Saint-Yon à La Rochelle.
La flotte de 1670 à destination de Québec et Percé est composée de cinq navires : quatre de La Rochelle (L’Hélène, L’Hirondelle, La Nouvelle-France et Le Saint-Pierre) et un de Dieppe (Le Saint-Jean-Baptiste).
La frégate L’Hélène (100 tx) est le sujet du présent article
En 1606, la levée d’engagés pour la Nouvelle-France (Acadie) est l’affaire de Pierre Dugua de Monts, mais aussi des marchands rochelais Samuel Georges et Jean Macain.
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du roi et son lieutenant général au pays de la Nouvelle-France, Pierre Dugua de Monts rentre en France, en septembre 1605, où il apprend que plusieurs marchands s’efforcent de faire annuler son monopole. Il décide donc de rester en France pour mieux défendre les intérêts de sa compagnie.
Avec l’appui des marchands rochelais Samuel Georges et Jean Macain, Dugua expédie le navire Le Jonas (150 tx) pour l’Acadie. Parti de La Rochelle le 13 mai, le navire est chargé d’approvisionnement et une cinquantaine de colons, dont vingt-quatre engagés, sous le commandement de Jean de Biencourt, baron de Poutrincourt et de Saint-Just.
Des vingt-quatre engagés connus, un seul est recruté à La Rochelle et les vingt-trois autres sont enrôlés à Paris.
C’est dans l’étude du notaire rochelais Jacques Cousseau que se présente Élie Petit, le 25 février 1606[1], pour convenir de ses conditions d’engagement avec les marchands Samuel Georges et Jean Macain. Ainsi, il promet de s’embarquer dans un navire pour aller au pays de Canada servir de chaussetier et de chaunier, pour une année, à ceux à qui il sera employé moyennant un salaire de 96lt dont 32lt lui sont avancées.
Macain et Georges vont défrayer les dépenses d’Élie Petit au Canada ainsi que ses frais de retour à La Rochelle dans un navire de 1607. Ils promettent aussi de faire nourrir, coucher et loger Petit et lui fournir tous les outils nécessaires à son métier.
Voici le contrat d’engagement d’Élie Petit en 1606.
...
La flotte de 1606 à destination de l’Acadie est composée de cinq navires[1].
Le navire Le Jonas (150 tx) est le sujet du présent article. Il est la propriété des marchands rochelais Samuel Georges et Jean Macain qui fournissent l’équipage[2].
Nommé l’un des pairs de La Rochelle en 1603, Jean Macain avait épousé, le 15 décembre 1591, Anne Georges, sœur de son associé. Les deux beaux-frères protestants se livrent, depuis le début du XVIIe siècle, à de nombreuses opérations commerciales avec la Nouvelle-France[3]. Le 25 février 1606[4], ils ont engagé Élie Petit, chaussetier et chaunier, de La Rochelle.
De l’île Sainte-Croix à Port-Royal
Au printemps de 1605, Pierre Dugua de Monts décide de déplacer son habitation de l’île Sainte-Croix vers Port-Royal, près de l’actuelle petite ville d’Annapolis Royal (Nouvelle-Écosse).
Il choisit François Gravé du Pont pour diriger les pêcheries et nomme Jean de Biencourt, baron de Poutrincourt et de Saint-Just, un gentilhomme picard, gouverneur de Port-Royal.
Poutrincourt demande à Dugua de lui accorder des terres à Port-Royal, se proposant de vivre là et d’y établir sa famille et sa fortune. Il acquiesce et, le 25 février 1606, Henri IV accorde à Poutrincourt « la seigneurie de Port-Royal et terres adjacentes ». En échange, il doit y installer une colonie dans les deux années qui suivent.
Le 19 décembre 1605, en vue de l’expédition de 1606, Dugua de Monts signe un contrat avec les rochelais Georges et Macain et avec d’autres marchands de Rouen et de Saint-Malo[5].
À Paris, Dugua presse le départ de Poutrincourt, qui tarde un peu à aller se mettre en possession du pays et territoires qui lui ont été concédés[6]. En mars, Poutrincourt rencontre son ami Marc Lescarbot, avocat au Parlement, et l’invite à joindre son expédition en Acadie.
Poutrincourt recrute une cinquante de colons dont plusieurs personnes de qualité, des artisans et journaliers aussi : menuisiers, charpentiers de navire, maçons, tailleurs de pierres, serruriers, taillandiers, couturiers, scieurs d’ais, matelots, etc. Selon Gervais Carpin[7], il est resté vingt-trois contrats d’engagement d’artisans d’une durée d’une année, signés chez le notaire parisien Rémond en présence de Pierre Dugua « gentilhomme ordinaire de la chambre du roi et son lieutenant général en la Nouvelle-France ». Les contrats mentionnent qu’ils doivent rejoindre La Rochelle à la fin du mois de mars pour leur embarquement.
Poutrincourt est aussi à la recherche de prêtres, mais c’est la Semaine sainte et ils sont tous occupés aux confessions ! Il s’en présente aucun, les uns s’excusant sur les incommodités de la mer et du long voyage, les autres remettant l’affaire après Pâques[8]. Le temps presse, il faut se rendre à La Rochelle.
Le Vendredi Saint, Lescarbot se rend vers Orléans, où il remplit, le dimanche, son devoir pascal et arrive à La Rochelle le 3 avril[9]. Le jeune avocat va quitter sa mère patrie pour la première fois. Entre Orléans et La Rochelle, un touchant et sincère adieu sort de sa plume de poète. Il compose un long poème combinant une nostalgie de l’Ancien Monde et l’anticipation du Nouveau[10]. Son Adieu à la France est imprimé le lendemain de son arrivée à La Rochelle, puis à Rouen.
Les préparatifs
À La Rochelle, nos voyageurs y trouvent le navire Le Jonas, prêt à sortir « hors des chaînes » de la ville pour attendre le vent. Il est chargé de bétail : des vaches, des porcs, un mouton, des poules, des pigeons ainsi que des chiens et… bien malgré soi, on emmène des rats[11].
Étant dans l’octave de Pâques, ils patientent en profitant des abstinences du récent carême[12]. Ils font bonne chère, « si bonne chère, écrit Lescarbot, qu’il nous tardait que nous fussions sur mer pour faire diète[13]. » On fête… un peu trop !
Fait étrange que ces tintamarres, constate Lescarbot, dans une ville réformée comme La Rochelle…où chacun marche droit pour ne pas encourir la censure soit du maire, soit des ministres de la ville. Quelques ouvriers sont faits prisonniers, gardés à l’Hôtel de ville jusqu’à leur départ. N’eut été de l’expédition, ils auraient été châtiés !
Le 1er avril[14], le capitaine Guillaume Foucques emprunte la somme de 42lt du marchand rochelais Jean Perrin pour s’acheter des marchandises pour le voyage.
Étant chargé, le navire Le Jonas est prêt à sortir de la rade. Le départ est prévu le 8 ou le 9 avril, mais… Par malheur, le capitaine Foucques le laisse sans hommes, ni lui-même, ni son pilote, puis un grand vent du sud-est s’élève pendant la nuit et casse le câble… le navire est entraîné hors du port et va se briser contre une des murailles de la ville, adossant la tour de la Chaîne[15]. Par chance, au même moment, la mer monte et l’empêche de couler !
Le navire est sauvé, mais il faut le réparer. Les pertes sont énormes. L’expédition est compromise. On demande l’aide des ouvriers soit à tirer à la pompe ou pousser au cabestan ou autre chose, mais peu d’entre-eux se mettent au travail. Quelques-uns se plaignent et quittent. Il faut embaucher un nouvel équipage.
Immobilisé, le capitaine Foucques parle sérieusement de rompre son engagement et de se mettre au service de marchands concurrents des Macain et Georges, écrit Adrien Huguet[16]. Sur le port, il reçoit des offres alléchantes dans l’espoir de se détacher de l’expédition de Dugua de Monts.
Cet esclandre retarde le départ de plus d’un mois ! Il faut décharger et recharger le navire. Pendant ce temps, Lescarbot se promène dans la ville et particulièrement aux Cordeliers. Comme l’a fait Poutrincourt à Paris, Lescarbot profite de son séjour rochelais pour trouver un homme d’église afin d’administrer les sacrements pendant le voyage. Étant dans une ville maritime, il croit qu’un curé ou vicaire prendrait plaisir à voguer sur les flots. En vain ! Il se fait dire qu’il « faudrait des gens qui fussent poussés de grand zèle et piété pour aller en tels voyages et serait bon de s’adresser aux pères Jésuites[17]. »
Faute de temps, le navire va partir sans missionnaire et lorsqu’on arrivera en Acadie, on apprendra que le seul prêtre qu’y avait laissé Dugua de Monts est décédé. C’est donc sans aucun prêtre que se fera l’hivernement de 1606-1607[18].
Le départ
Le 11 mai, à la faveur d’un petit vent d’est, le navire Le Jonas prend la mer et aborde à La Palice. Le lendemain, il mouille à Chef de Baie (lieu où les navires s’abritent des vents). Enfin, le samedi 13 mai, veille de la Pentecôte, il fait voile…
Juste avant de partir, le 12 mai[19], le marinier Jean Launay reconnaît avoir reçu la somme de 45lt du marchand rochelais Élie Leroy.
De l’équipage, nous connaissons :
Guillaume Foucques, maître et capitaine
Olivier Fleuriot, pilote, de Saint-Malo (Bretagne)
Jean Launay, marinier, de Le Conquet (Bretagne)Des passagers, nous connaissons :
Jean de Biencourt, baron de Poutrincourt et de Saint-Just, gouverneur
François Addenin, soldat, domestique
Charles de Biencourt de Poutrincourt, fils de Jean
Du Boullay, ancien capitaine de régiment
Étienne, maître-chirurgien
Robert Gravé, fils de François Gravé du Pont
Daniel Hay, charpentier
Jean Hay, charpentier
Louis Hébert, apothicaire, de Paris (Île-de-France)
Marc Lescarbot, avocat, de Vervins (Île-de-France)
Jean Ralluau, secrétaire de Dugua de Monts
Charles Turgis de Saint-Étienne de La Tour, fils
Claude Turgis de Saint-Étienne et de La Tour, pèreDes engagés, nous connaissons :
Simon Barguin, compagnon-charpentier, de Reims (Champagnie)
Léonard Bidon
François Bonin
Olivier Bresson
Claude Desbry
Michel Destrez, compagnon-menuisier, de Magny-en-Vexin (Île-de-France)
Jean Duval, serrurier, de Normandie
Antoine Esnault, compagnon-menuisier, natif de Montdidier (Picardie)
Michel Genson, compagnon-menuisier, de Troyes (Champagne)
Guillaume Gérault
François Guittard, taillandier, de Paris (Île-de-France)
Jean Hanin
Toussain Husson
Husson Jabart
Élie Petit, chaussetier, de La Rochelle
Poileus
Jean Pussot, compagnon-charpentier, de Reims (Champagne)
Guillaume Richard, compagnon-charpentier, de Lusignan (Poitou)
Pierre RondeauÀ bord du navire, Marc Lescarbot passe par toute une gamme d’émotions pour un homme si peu familier avec les voyages maritimes. Face à l’océan, il a peur. Il le confesse avec franchise.
Le 16 mai, les voiles blanches d’une flottille de treize navires flamands allant en Espagne distraient, pour un instant, l’horizon du navire. En vue des Açores, un navire inconnu, dont l’équipage composé de matelots anglais et flamands, se disant terre-neuvier, se montre courtois et s’informe de son itinéraire[20].
Jusqu’au 18 juin, le navire surmonte quelques tempêtes causées par des vents contraires… étant partit trop tard, écrit Lescarbot. À cela, il faut ajouter des froidures et des brouillards intenses rendant la traversée difficile.
Des volées d’oiseaux annoncent les environs du banc de Terre-Neuve. Pour s’en assurer, le soir du 22 juin, à la seconde tentative, la sonde est jetée et on trouve fond à trente-six brasses. Après avoir reconnu le Banc, on poursuit la route à l’ouest. On met les voiles bas, la veille de la Saint-Jean-Baptiste, et la journée se passe à la pêcherie des morues avec mille réjouissances pendant lesquelles un des charpentiers de navire tombe à la mer ! Il est sauvé sans pour autant subir le mécontentement du capitaine. Pendant la nuit du 29 juin, un des matelots tombe à la mer sauvé par un cordage !
Dès le matin du 4 juillet, les matelots du dernier quart de travail reconnaissent les îles de Saint-Pierre encore lointaines. Le 7 juillet, avec joie, on découvre à tribord une côte de terre longue à perte de vue [Cap Breton]. « Les plus hardis, raconte Lescarbot, montaient à la hune pour mieux voir tant nous étions désireux de cette terre […] Nos chiens mettaient le museau hors le bord pour mieux flairer l’air terrestre[21]. »
Le 8 juillet apparaît la baie de Canseau, mais des brumes s’élèvent forçant le navire à louvoyer, sans avancer, contrarié des vents d’ouest et sud-ouest[22]. Sur les deux heures de l’après-midi, le samedi 15 juillet, le brouillard se dissipe, le ciel s’éclaircit et la côte se distingue à quatre lieues de terre[23].
Deux chaloupes, voiles déployées, s’approchent du navire. L’une chargée de sauvages, un élan peint à leur voile, l’autre de Français malouins faisant la pêche au port de Canseau[24]. Par eux, on apprend que Gravé du Pont avait quitté Port-Royal vingt jours avant, désespéré de voir arriver un navire de France. Il décida de regagner Honfleur par ses propres moyens. Il avait laissé la garde de l’habitation à deux hommes[25], nommés La Taille et Miquelet.
Le 17 juillet, le navire est encore pris de brumes et de vent contraire pendant deux jours. Le calme revenu, le soir du 19 juillet, se baignant dans la mer, un charpentier de navire ayant trop bu d’eau de vie est surpris… « le froid de la marine combattant contre l’échauffement de cet esprit de vin », écrit Lescarbot[26]. Voyant leur compagnon en danger, quelques matelots se jettent à l’eau pour le secourir, mais il se moque d’eux ! D’autres matelots sont appelés en renfort qui, dans cette confusion, se nuisent l’un l’autre et se mirent en danger ! Au cri de Poutrincourt, le charpentier Jean Hay prend le cordage qu’on lui montre et est tiré vers le haut, puis sauvé. Il tomba malade et cru mourir !
Le dimanche 23 juillet, le navire entre dans le port Rossignol et en après-midi, de beau soleil, il mouille au port au Mouton. Dix-sept hommes débarquent pour se réapprovisionner d’eau douce et de bois. Après avoir doublé le Cap de Sable, le 25 juillet, le navire Le Jonas jette l’ancre à l’entrée de Port-Royal. Deux coups de canon sont tirés afin de saluer le port et avertir les Français qui y demeurent[27].
Enfin, le 27 juillet, après une traversée de onze semaines, le navire entre dans le port, non sans difficulté, car le vent ralenti sa marche. La joie est grande, tant chez les passagers que chez les colons.
Le lendemain de leur débarquement, tous se mettent à l’ouvrage; quelques-uns au labourage et à la culture de la terre, écrit Lescarbot, d’autres à nettoyer les chambres. Comme la colonie ne compte aucune femme, les hommes doivent se partager les menus travaux ménagers[28].
Alors que les colons s’affairent à leur besogne, les hommes de bord qui avait quitté Le Jonas au port de Canseau pour venir le long de la côte rencontrent sur leur route Gravé du Pont qui rebroussa chemin pour retourner à Port-Royal, où il arrive le 31 juillet.
Pendant un mois, les réjouissances succèdent aux réjouissances. Poutrincourt fait mettre un muid de vin « sur le cul ». L’un de ceux qu’on lui avait baillé pour sa bouche, raconte Lescarbot[29], et permission de boire à tout venant tant qu’il y en aura !
Le retour
Le 20 août, il est temps de trousser bagage. Le 25, après maintes canonnades, le navire Le Jonas lève l’ancre pour aller à l’embouchure du port en attendant un vent favorable. Le 28 août, le navire appareille. Gravé du Pont dit adieu à ses amis et prend place dans le navire avec ses cinquante hommes. Pour l’occasion, Marc Lescarbot salue les partants d’un poème de 124 vers, Adieu aux Français retournant de la Nouvelle-France en la France Gaulloise.
La présente partie fait suite à la première intitulée «La colonie française de l'Acadie, 1604-1755». Après la déportation, l'Acadie a pu revivre et se transformer dans une forme autre que coloniale ou celle d'un État autonome ou souverain. L'Acadie contemporaine ne forme pas un État, mais elle existe néanmoins. C'est la suite de l'Histoire des Acadiens qui est présentée ici: la Nouvelle Acadie, celle d'après la déportation de 1755,et de ce qu'elle deviendra avec le retour des Acadiens dans les Maritimes (voir les cartes sur l'évolution des établissements acadiens). Mais la Nouvelle Acadien n'est pas géographique, elle est culturelle et historique.
L'examen détaillé des généalogies et des résultats économiques des habitations des quartiers de Kourou, de Sinnamary et d'Iracoubo entre 1772 et 1853montre que les colons Acadiens, venus en Guyane dans le cadre de la désastreuse "expédition de Kourou" de 1764, ont plutôt bien réussi leur implantation, contrairement aux conclusions avancées par la plupart des spécialistes de la période. Ce constat nous amène à relancer le débat sur l'émergence de véritables cultures paysannes, via la société d'habitation, parallèlement ou en dehors de la société de plantation.